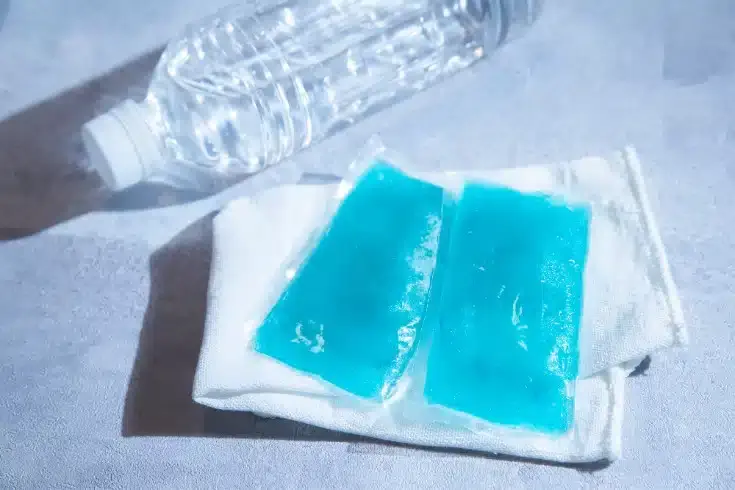Explication des réglementations clés sur les salaires, les heures de travail et les congés dans le droit du travail japonais

En gérant une entreprise au Japon, une compréhension approfondie du droit du travail, en particulier des réglementations relatives au paiement des salaires, aux heures de travail et aux congés, constitue un élément fondamental de la gestion des risques juridiques d’une entreprise, bien au-delà des simples enjeux de gestion des ressources humaines. Ces réglementations sont conçues pour protéger la stabilité de la vie et la santé des travailleurs, et leur respect est une obligation légale imposée aux entreprises. La Loi sur les normes du travail japonaise (Japanese Labor Standards Act) établit des règles détaillées allant de principes stricts sur les méthodes de paiement des salaires, aux réglementations complexes sur les limites du travail en heures supplémentaires avec une structure hiérarchisée, en passant par les obligations de l’employeur pour garantir l’acquisition des congés payés annuels, ainsi que des dispositions spéciales pour protéger certains travailleurs tels que les femmes et les mineurs. Ces règles ont un impact direct sur l’exploitation quotidienne des entreprises, la conception des systèmes de rémunération et le contenu des contrats de travail. Cet article explique ces thèmes importants d’un point de vue professionnel et pratique, en se basant sur les lois japonaises et les principaux cas de jurisprudence.
Les principes fondamentaux du paiement des salaires sous le droit japonais
L’article 24 de la Loi sur les normes du travail japonaise établit cinq principes fondamentaux concernant le paiement des salaires dans le but de garantir la stabilité de la vie des travailleurs. Ces principes, connus sous le nom de “cinq principes du paiement des salaires”, forment la base des pratiques de paiement des salaires au Japon. Bien qu’ils constituent des exigences légales strictes, des dispositions d’exception ont été mises en place pour s’adapter aux pratiques commerciales modernes. Cependant, pour appliquer ces exceptions, il est essentiel de respecter les procédures strictes établies par la loi, et non de se contenter d’un accord verbal.
Le principe du paiement en monnaie
Premièrement, les salaires doivent être payés en monnaie légale japonaise, c’est-à-dire en espèces. Cela interdit le paiement en nature (par exemple, en produits fabriqués par l’entreprise), dont la valeur peut être instable ou difficile à convertir, afin d’assurer que les travailleurs reçoivent une contrepartie de valeur stable.
Il existe une exception importante à ce principe. La plus courante est le transfert sur un compte bancaire avec le consentement individuel du travailleur. Lorsque cette méthode est utilisée, l’employeur doit s’assurer que le travailleur peut retirer l’argent en espèces à la date de paiement spécifiée. De plus, suite à des réformes législatives récentes, le paiement des salaires sur le compte d’un prestataire de services de paiement désigné par le ministre de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, avec le consentement du travailleur, est également possible, ce qu’on appelle le “paiement numérique”. Dans tous les cas, le consentement clair de chaque travailleur est essentiel, et il n’est pas permis à l’employeur de déterminer unilatéralement la méthode de paiement.
Le principe du paiement direct
Deuxièmement, les salaires doivent être payés directement au travailleur sans intermédiaire. Ce principe vise à prévenir l’exploitation intermédiaire des salaires par des tiers. Par conséquent, même les parents ou les représentants légaux du travailleur ne sont généralement pas autorisés à recevoir les salaires en son nom. Cependant, si le travailleur est incapable de recevoir son salaire en raison d’une maladie ou d’une autre raison, il peut être permis à un membre de la famille ou à une autre personne d’agir en tant que “messager” pour recevoir le salaire, ce qui est différent d’agir en tant que représentant.
Le principe du paiement intégral
Troisièmement, l’intégralité du salaire doit être payée. Il est interdit à l’employeur de déduire unilatéralement des dommages-intérêts ou autres du salaire (compensation). Cependant, il existe des exceptions à ce principe. Les retenues telles que l’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation, les cotisations de sécurité sociale, etc., qui sont définies par d’autres lois, peuvent être légalement déduites. De plus, pour déduire des éléments tels que le loyer d’un logement de fonction ou les cotisations syndicales, qui ne sont pas basés sur la loi, il est nécessaire de conclure un accord écrit (un accord collectif) avec le syndicat représentant la majorité des travailleurs ou avec un représentant de la majorité des travailleurs. Des cas récents de jurisprudence ont également déterminé que, en plus de cet accord collectif, il est nécessaire d’avoir une disposition de base dans le règlement intérieur concernant les déductions, ce qui souligne la nécessité d’une procédure stricte.
Les principes du paiement au moins une fois par mois et du paiement à une date fixe
Les quatrième et cinquième principes stipulent que les salaires doivent être payés “au moins une fois par mois” et “à une date fixe”. Ces deux principes visent à assurer aux travailleurs un revenu régulier et prévisible, contribuant ainsi à la stabilité de leur vie. “Une date fixe” doit être spécifiquement déterminée, comme “le 25 de chaque mois”, et des désignations telles que “entre le 20 et le 25 de chaque mois” ou “le troisième vendredi de chaque mois”, qui peuvent varier considérablement d’un mois à l’autre, ne sont pas autorisées.
Ces principes ne s’appliquent pas aux salaires versés de manière ponctuelle, tels que les bonus ou les indemnités de départ.
Heures supplémentaires, travail le week-end et de nuit, et majoration salariale sous le droit japonais
La Loi sur les normes du travail au Japon (日本の労働基準法) vise à protéger la santé des travailleurs en imposant des limites strictes sur les heures de travail. En principe, la durée du travail ne doit pas excéder 8 heures par jour et 40 heures par semaine (Article 32 de la Loi sur les normes du travail au Japon). Faire travailler un employé au-delà de ces heures légales ou pendant les jours de repos légaux est considéré, en vertu de la loi, comme une mesure exceptionnelle.
Le « 36 Accord » : Prérequis pour le travail en heures supplémentaires au Japon
Pour permettre aux employés de travailler au-delà des heures légales de travail ou pendant les jours de repos légaux, l’employeur doit conclure un accord écrit avec le syndicat représentant la majorité des travailleurs de l’établissement, ou à défaut, avec un représentant de la majorité des travailleurs. Cet accord doit ensuite être déclaré à l’inspection du travail compétente. Cet accord est communément appelé « 36 Accord (San Roku Kyoutei) » en référence à l’article 36 de la Loi japonaise sur les normes du travail. Ces dernières années, il est recommandé de soumettre ces déclarations via le système de demande électronique du gouvernement, « e-Gov », ce qui permet également à la société mère de déclarer en ligne pour plusieurs établissements simultanément.
Régulation des heures supplémentaires au Japon
La réforme législative de 2019 (ère Reiwa 1) a introduit des limites strictes, assorties de sanctions, sur les heures supplémentaires pouvant être étendues par l’accord dit de l’article 36. Cette réglementation est une mesure cruciale pour prévenir des problèmes graves tels que les décès dus au surmenage. Elle est structurée en deux étapes. En principe, la limite des heures supplémentaires est fixée à 45 heures par mois et 360 heures par an.
Ensuite, uniquement en cas de circonstances exceptionnelles telles qu’une augmentation soudaine du volume de travail, il est permis de dépasser cette limite principale en établissant une « clause spéciale » dans l’accord de l’article 36. Cependant, même lors de l’application de cette clause spéciale, les limites absolues suivantes sont établies par la loi :
- Les heures supplémentaires ne doivent pas dépasser 720 heures par an.
- La somme des heures supplémentaires et des heures de travail les jours de repos doit être inférieure à 100 heures par mois.
- La moyenne de la somme des heures supplémentaires et des heures de travail les jours de repos, sur une période continue de 2, 3, 4, 5 ou 6 mois, ne doit pas dépasser 80 heures par mois.
- Il est permis de dépasser 45 heures d’heures supplémentaires par mois jusqu’à 6 fois par an.
Ces limites s’appliquent à toutes les entreprises, qu’elles soient grandes ou petites. De plus, bien que leur application ait été différée pour les secteurs de la construction, de la conduite automobile et pour les médecins, avec des critères légèrement différents, ils seront soumis à ces limites à partir d’avril 2024 (ère Reiwa 6).
Taux de majoration salariale
Selon l’article 37 de la Loi sur les normes du travail japonaise, les employeurs ont l’obligation de payer un salaire majoré pour les heures supplémentaires, le travail effectué pendant les jours de repos et le travail de nuit, en plus du salaire habituel. Les taux de majoration légaux minimums sont les suivants :
- Heures supplémentaires (travail effectué au-delà des heures de travail légales) : au moins 25%
- Travail pendant les jours de repos (travail effectué pendant les jours de repos légaux) : au moins 35%
- Travail de nuit (en principe, de 22 heures à 5 heures du matin) : au moins 25%
- Heures supplémentaires dépassant 60 heures par mois : au moins 50%
Ce taux de majoration élevé pour les heures supplémentaires au-delà de 60 heures par mois fonctionne comme un incitatif financier pour décourager les longues heures de travail supplémentaires. Ces réglementations ne doivent pas être perçues simplement comme une collection de chiffres individuels, mais plutôt comme un système intégré conçu pour limiter de manière multidimensionnelle le travail excessivement long. La régulation des heures maximales limite physiquement le temps de travail, tandis que les taux de majoration salariale imposent une charge économique, créant ainsi une structure qui favorise globalement la réduction des heures de travail.
Les exigences légales du système de paiement forfaitaire des heures supplémentaires en droit japonais
De nombreuses entreprises au Japon introduisent un système où une partie du salaire est payée à l’avance pour un certain nombre d’heures supplémentaires, connu sous le nom de “paiement forfaitaire des heures supplémentaires”. Cependant, pour que ce système soit légalement valide, il doit répondre à des exigences très strictes. Les tribunaux exigent de manière constante le critère de “distinction claire”. Cela signifie que la partie du salaire correspondant à la rémunération des heures de travail normales et la partie correspondant à la rémunération majorée pour les heures supplémentaires doivent être clairement différenciables en termes de montant.
Un cas de jurisprudence clé à cet égard est l’affaire International Automobile (décision de la Cour suprême du 30 mars 2020). Dans cette affaire, la Cour suprême a clarifié que le simple fait d’avoir des intitulés distincts sur un bulletin de salaire n’est pas suffisant, et a souligné l’importance de déterminer si le paiement a réellement le caractère d’une rémunération majorée. Le système de rémunération en question déduisait le montant des majorations payées (correspondant au paiement forfaitaire des heures supplémentaires) lors du calcul de la commission. La Cour suprême a jugé que ce mécanisme ne faisait en réalité que modifier le nom d’une partie de la commission qui aurait dû être payée, sans que le paiement forfaitaire des heures supplémentaires ne représente une rémunération majorée réelle. En conséquence, le système n’a pas satisfait au critère de distinction claire et a été jugé invalide.
Cette jurisprudence montre la ferme intention du pouvoir judiciaire de ne pas permettre aux employeurs de concevoir des systèmes de rémunération formels et artificiels pour éviter de payer des rémunérations majorées. Pour que le système de paiement forfaitaire des heures supplémentaires soit valablement mis en œuvre, il est essentiel que cette indemnité soit indépendante des autres éléments de rémunération et fonctionne purement comme une contrepartie pour les heures supplémentaires et autres travaux similaires.
| Caractéristiques | Exemples valides | Exemples susceptibles d’être invalidés | Fondement juridique & Explications |
| Affichage sur le bulletin de salaire | Salaire de base : 300 000 yens Indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires (pour 20 heures) : 50 000 yens | Salaire mensuel : 350 000 yens (incluant l’indemnité forfaitaire pour 20 heures d’heures supplémentaires) | Dans les exemples valides, le salaire de base et l’indemnité sont clairement différenciés en termes de montant. Dans les exemples invalides, il est impossible de distinguer quelle partie est le salaire de base et quelle partie est l’indemnité. |
| Méthode de calcul | Le nombre d’heures et le montant de l’indemnité forfaitaire pour les heures supplémentaires sont clairement indiqués dans le contrat de travail ou le règlement intérieur. | Le calcul de la commission est basé sur “le montant de la commission correspondant aux résultats de vente, moins le montant de l’indemnité forfaitaire pour les heures supplémentaires payée”. | L’exemple invalide montre que l’indemnité forfaitaire pour les heures supplémentaires est compensée en réduisant d’autres salaires (comme la commission), ce qui signifie qu’elle n’a pas de substance réelle en tant que rémunération majorée. Cela correspond à la logique de l’invalidité établie dans le jugement de l’affaire International Automobile. |
| Relation avec les heures supplémentaires réelles | Si le nombre réel d’heures supplémentaires dépasse le temps couvert par l’indemnité forfaitaire, la différence est payée séparément. | Peu importe le nombre réel d’heures supplémentaires, un montant fixe de salaire est toujours payé et aucun ajustement n’est effectué pour les heures excédentaires. | L’indemnité forfaitaire pour les heures supplémentaires n’est qu’un paiement anticipé de la rémunération majorée. Ne pas payer la différence lorsque les heures supplémentaires réelles dépassent le montant forfaitaire viole également le principe du paiement intégral. |
Le cadre légal des congés payés annuels sous le droit japonais
Les congés payés annuels sont un système de vacances rémunérées établi par l’article 39 de la Loi sur les normes du travail japonaise (Japanese Labor Standards Act), dans le but de permettre aux travailleurs de récupérer de la fatigue physique et mentale et de garantir une vie équilibrée.
Critères d’attribution et nombre de jours
Le droit à des congés payés annuels est accordé à tous les travailleurs qui remplissent les deux conditions suivantes :
- Avoir travaillé de manière continue pendant 6 mois à compter de la date d’embauche.
- Avoir été présent au moins 80 % des jours ouvrables pendant ces 6 mois.
Lorsque ces conditions sont remplies, le travailleur a droit à 10 jours ouvrables de congés payés annuels. Par la suite, le nombre de jours de congés attribués augmente en fonction de l’ancienneté, atteignant un maximum de 20 jours après plus de 6 ans et 6 mois de service. Les droits aux congés payés attribués sont valables pendant 2 ans.
L’obligation de désignation de la période pour les congés annuels payés
La réforme législative de 2019 (ère Reiwa 1) a imposé une nouvelle obligation aux employeurs au Japon. Il s’agit de l’obligation de garantir que les travailleurs auxquels sont octroyés au moins 10 jours de congés annuels payés prennent au moins 5 jours de ces congés dans l’année suivant la date d’attribution. Si un travailleur prend de sa propre initiative plus de 5 jours de congé, il n’y a pas de problème. Cependant, pour les travailleurs qui n’ont pas pris les 5 jours de congé, l’employeur doit, après avoir consulté l’employé, désigner la période de prise de congé. Cette mesure vise à éliminer les hésitations à prendre des congés et à encourager leur utilisation.
Le droit de détermination du moment des congés par le salarié et le droit de modification du moment des congés par l’employeur sous le droit japonais
Le cœur juridique de l’application des congés payés annuels réside dans la relation entre deux droits : le “droit de détermination du moment des congés” par le salarié et le “droit de modification du moment des congés” par l’employeur. Le principe est que le salarié a le droit de déterminer à sa guise le moment de prendre ses congés, ce qui est connu sous le nom de “droit de détermination du moment”. Lorsque le salarié spécifie “je veux prendre congé ce jour-là” et en fait la demande, le congé est légalement établi à ce moment-là.
En revanche, l’employeur ne peut exercer son “droit de modification du moment” que dans des circonstances très limitées. Ce droit permet à l’employeur de demander le changement du moment des congés à une autre période uniquement si accorder des congés à la période spécifiée par le salarié “entrave le fonctionnement normal de l’entreprise”.
La nature de ce droit a été définie par l’affaire de l’administration forestière de Shiraishi (décision de la Cour suprême du 2 mars 1973). Dans ce jugement, la Cour suprême a statué que les congés payés annuels ne sont pas une “demande” nécessitant l'”approbation” de l’employeur, mais un “droit constitutif” établi par la déclaration unilatérale du salarié (détermination du moment). Par conséquent, à moins que l’employeur n’exerce son droit de modification du moment, le congé est confirmé pour la date spécifiée par le salarié. De plus, ce jugement a établi un principe important selon lequel l’objectif de l’utilisation des congés est à la discrétion du salarié et que l’employeur n’est pas autorisé à refuser l’octroi de congés ou à exercer son droit de modification du moment sur la base de cet objectif.
Cette relation juridique est intentionnellement conçue de manière asymétrique. Un droit puissant est accordé au salarié, tandis que l’employeur ne dispose que d’un droit de défense limité. Par conséquent, les pratiques opérationnelles qui imposent l'”approbation” du supérieur pour la prise de congés ou qui demandent la “raison” des congés sont juridiquement inappropriées et comportent des risques de non-conformité. Dans la gestion d’entreprise, il ne s’agit pas de chercher des raisons de refuser les congés, mais plutôt de planifier la gestion des opérations, comme la sécurisation du personnel de remplacement, afin de permettre aux salariés de prendre leurs congés en toute fluidité.
| Droit | Titulaire du droit | Nature du droit | Conditions d’exercice |
| Droit de détermination du moment des congés par le salarié | Salarié | Droit constitutif permettant d’établir les congés en spécifiant unilatéralement la date | Disposer de jours de congés payés annuels non utilisés |
| Droit de modification du moment des congés par l’employeur | Employeur | Droit exceptionnel permettant de demander la modification du moment des congés spécifié par le salarié | L’employeur doit prouver que l’octroi des congés à la période spécifiée “entrave le fonctionnement normal de l’entreprise” |
Suspension d’activité imposée par l’employeur et indemnité de chômage technique en droit japonais
Lorsqu’une entreprise doit suspendre l’activité de ses salariés pour des raisons de gestion, un système est en place pour protéger la vie des travailleurs. L’article 26 de la Loi sur les normes du travail japonaise stipule que si un employeur suspend l’activité d’un travailleur pour des raisons qui lui sont imputables, il doit verser à ce travailleur une indemnité de chômage technique d’au moins 60 % de son salaire moyen.
La question la plus importante pour déterminer si cette obligation s’applique est l’interprétation de l’expression “raisons imputables à l’employeur”. Ce concept est interprété très largement en droit du travail. Il inclut non seulement les actes intentionnels ou les négligences de l’employeur, mais aussi les suspensions d’activité dues à des obstacles dans la gestion ou l’administration de l’employeur. Par exemple, une pénurie de matières premières, une réduction des commandes due à des difficultés financières de la société mère ou une panne de machine sont considérées comme des raisons imputables à l’employeur, même si l’employeur lui-même n’est pas directement en faute.
Un cas jurisprudentiel important qui soutient cette interprétation large est l’affaire Northwest Airlines (décision de la Cour suprême du Japon du 17 juillet 1987). Dans cette décision, qui concernait une suspension d’activité due à une grève, la Cour a indiqué que l’objectif de l’article 26 de la Loi sur les normes du travail était plus large que les causes de responsabilité civile et englobait tous les obstacles à la gestion de l’employeur. L’obligation légale de paiement est écartée uniquement dans les cas de force majeure réelle, tels que les tremblements de terre ou les typhons, qui se produisent en dehors de l’entreprise et que l’employeur ne peut éviter malgré toute l’attention requise.
Derrière cette interprétation de la loi se trouve l’idée de la répartition des risques associés à la gestion d’une entreprise. Les risques inhérents à la gestion d’une entreprise, tels que les fluctuations du marché ou les circonstances des partenaires commerciaux, doivent en principe être supportés par l’employeur. C’est une décision politique qui reflète cette vision. Par conséquent, tant que la raison de la suspension d’activité se produit dans la “sphère de contrôle” de l’employeur, même si elle est causée par des facteurs externes, l’employeur est tenu de payer une indemnité de chômage technique minimale pour garantir la vie des travailleurs.
Dispositions de protection des femmes et des mineurs sous le droit japonais
La Loi sur les normes du travail au Japon (日本の労働基準法) prend en compte le contexte historique et les caractéristiques physiques pour offrir des dispositions de protection spéciales aux travailleuses et aux travailleurs mineurs, jugés particulièrement vulnérables.
Protection de la maternité pour les travailleuses
Pour préserver la santé des travailleuses enceintes et celles ayant récemment accouché (désignées légalement sous le terme de « femmes enceintes ou accouchées »), des mesures spécifiques sont mises en place. Tout d’abord, le congé prénatal et postnatal (selon l’article 65 de la Loi sur les normes du travail au Japon) est garanti. Le congé prénatal peut débuter 6 semaines avant la date prévue de l’accouchement (ou 14 semaines en cas de grossesse multiple), à la demande de la travailleuse. Quant au congé postnatal, il commence le lendemain de l’accouchement et s’étend sur 8 semaines, durant lesquelles l’employeur ne peut faire travailler la salariée, qu’elle en fasse la demande ou non. Les 6 premières semaines après l’accouchement sont considérées comme une période de repos absolu pour la récupération de la mère et l’employeur ne peut permettre le travail, même si la travailleuse le souhaite. Cependant, après ces 6 semaines, si la travailleuse le demande et qu’un médecin atteste de l’absence de contre-indication, elle peut reprendre des activités professionnelles limitées.
De plus, le travail des femmes enceintes ou accouchées est soumis à diverses restrictions. L’employeur ne doit pas les affecter à des tâches impliquant la manipulation de charges lourdes ou l’exposition à des gaz nocifs (conformément à l’article 64-3 de la Loi sur les normes du travail au Japon). En outre, si la travailleuse en fait la demande, il est interdit de lui imposer des heures supplémentaires, du travail les jours de repos ou de nuit (selon l’article 66 de la Loi sur les normes du travail au Japon). Ces dispositions protectrices se divisent en obligations conditionnelles, déclenchées par une demande de la travailleuse (comme l’exemption de travail supplémentaire), et en obligations absolues que l’employeur doit respecter indépendamment de toute demande (comme le repos postnatal de 6 semaines). Les entreprises doivent comprendre précisément ces différences et établir un système de gestion du travail approprié pour chacune d’elles.
Protection des mineurs
Les travailleurs de moins de 18 ans (légalement désignés comme « mineurs ») sont soumis à des réglementations particulièrement strictes pour assurer leur développement sain, tant physique que mental.
En principe, il est interdit de faire travailler les mineurs en heures supplémentaires ou les jours de repos, et le travail de nuit (de 22 heures à 5 heures du matin) est également prohibé (selon les articles 60 et 61 de la Loi sur les normes du travail au Japon). De même, les activités dangereuses telles que la conduite de grues ou les travaux en hauteur, ainsi que le travail dans les mines, sont totalement interdits (conformément aux articles 62 et 63 de la Loi sur les normes du travail au Japon).
Des règles spéciales s’appliquent également aux contrats de travail. Les tuteurs légaux ne peuvent pas conclure de contrat de travail à la place des mineurs ; le contrat doit être établi directement avec le mineur lui-même (selon l’article 58 de la Loi sur les normes du travail au Japon). De plus, le salaire doit être payé directement et en totalité au mineur, et il est interdit aux tuteurs légaux de le percevoir à sa place (conformément à l’article 59 de la Loi sur les normes du travail au Japon). Ces dispositions sont des mesures de protection cruciales pour prévenir l’exploitation économique des mineurs et les contraindre à un travail contre leur gré.
Résumé
Comme nous l’avons examiné dans cet article, les réglementations relatives aux salaires, aux heures de travail, aux congés et à la protection de certains travailleurs sous le droit du travail japonais sont extrêmement détaillées et stratifiées. Ces règles ne sont pas de simples directives, mais des obligations légales strictes qui entraînent des sanctions pénales et des responsabilités civiles en cas de non-respect. En particulier, les récentes réformes législatives telles que la limitation des heures supplémentaires et l’obligation d’acquérir des congés payés annuels exigent des employeurs une gestion du personnel plus proactive qu’auparavant. De plus, les tendances jurisprudentielles concernant les indemnités de travail supplémentaire fixes et les allocations de chômage suggèrent que de simples mesures formelles sont insuffisantes et que la substance réelle du système est mise en question. Comprendre et respecter ces réglementations complexes est un fondement essentiel pour établir des relations de travail saines et assurer la croissance durable d’une entreprise.
Le cabinet d’avocats Monolith a une solide expérience dans la fourniture de conseils et de soutien riches sur le droit du travail japonais, y compris les thèmes abordés dans cet article, à un large éventail de clients, tant nationaux qu’internationaux. Notre cabinet compte plusieurs avocats anglophones qualifiés à l’étranger, ce qui nous permet de combler les écarts entre les pratiques commerciales internationales et les réglementations japonaises, et d’offrir des solutions précises et pratiques aux défis spécifiques auxquels nos clients sont confrontés. Nous vous proposons un soutien juridique spécialisé pour naviguer dans cet environnement réglementaire complexe.
Category: General Corporate