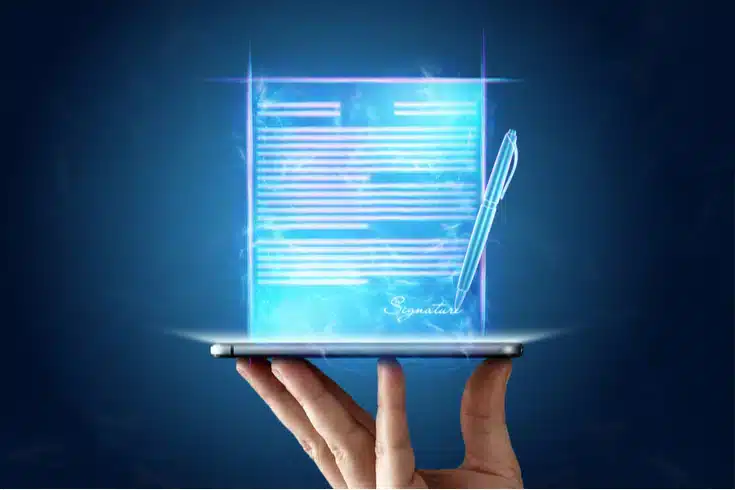Considérations juridiques sur les responsabilités et obligations des membres exécutifs dans une société à responsabilité limitée japonaise

En vertu du système juridique des sociétés au Japon, la Godo Kaisha (GK), ou société à responsabilité limitée, est largement utilisée par les entrepreneurs nationaux et internationaux en raison de la simplicité de ses procédures de création et de la grande latitude permise par ses statuts. Contrairement à la Kabushiki Kaisha (KK), ou société par actions, qui repose sur le principe de séparation entre la propriété (actionnaires) et la gestion (directeurs), la Godo Kaisha est fondée sur le principe que les investisseurs, appelés “membres”, gèrent eux-mêmes l’entreprise. Au cœur de cette gestion se trouve le “membre exécutant les opérations”. Ce membre exécutant dispose d’un large éventail de pouvoirs pour diriger les affaires de la société, mais ces pouvoirs s’accompagnent de graves obligations et responsabilités légales. Comprendre ces obligations est essentiel pour la gestion saine et la gestion des risques d’une Godo Kaisha. Cet article explique en détail, d’un point de vue juridique, les principales obligations incombant aux membres exécutant les opérations d’une Godo Kaisha selon la loi japonaise sur les sociétés, à savoir le devoir de diligence, le devoir de loyauté, l’interdiction de concurrence, les restrictions sur les transactions en conflit d’intérêts, et la responsabilité pour négligence dans l’exécution de ces devoirs. Ces dispositions constituent un cadre fondamental pour réglementer le comportement des membres exécutant les opérations et protéger la société ainsi que ses parties prenantes.
Les devoirs fondamentaux des exécutants de tâches d’entreprise en droit japonais : le devoir de diligence et le devoir de loyauté
Les deux obligations fondamentales qui forment la base de toutes les actions des exécutants de tâches d’entreprise sont le “devoir de diligence” et le “devoir de loyauté”. Ces devoirs sont au cœur de la relation de confiance entre les exécutants de tâches d’entreprise et la société, et sont clairement définis par la loi japonaise sur les sociétés.
Premièrement, les exécutants de tâches d’entreprise ont un “devoir de diligence d’un bon gestionnaire” envers la société, c’est-à-dire un devoir de diligence. Ce devoir est établi par l’article 593, paragraphe 1, de la loi japonaise sur les sociétés. Le devoir de diligence signifie que les exécutants de tâches d’entreprise doivent exécuter leurs fonctions avec le niveau de soin normalement attendu, objectivement, en fonction de leur position et de la nature de leurs tâches. Par exemple, si une société effectue un investissement majeur sans effectuer une étude de marché adéquate ou des prévisions de revenus suffisantes, en se basant sur un jugement personnel, et que cela entraîne par la suite de lourdes pertes pour la société, ou si elle néglige de vérifier la solvabilité d’un partenaire commercial, rendant ainsi les comptes clients irrécouvrables, cela pourrait constituer une violation du devoir de diligence.
Deuxièmement, les exécutants de tâches d’entreprise ont un “devoir de loyauté” envers la société. Ce devoir est imposé par l’article 593, paragraphe 2, de la loi japonaise sur les sociétés, qui applique par analogie les dispositions relatives aux directeurs de sociétés par actions (article 355 de la même loi). Le devoir de loyauté signifie que les exécutants de tâches d’entreprise doivent respecter les lois et les statuts et exécuter fidèlement leurs fonctions dans l’intérêt de la société dans son ensemble. Cela signifie que les exécutants de tâches d’entreprise ne doivent pas privilégier leurs intérêts personnels ou ceux de tiers au détriment de ceux de la société.
Ces devoirs de diligence et de loyauté sont les plus fondamentaux parmi les obligations des exécutants de tâches d’entreprise et ne peuvent être ni annulés ni atténués par les dispositions des statuts. Les obligations spécifiques telles que l’interdiction de concurrence et les restrictions sur les transactions en conflit d’intérêts, qui seront discutées plus loin, peuvent être comprises comme des concrétisations de ces devoirs de diligence et de loyauté dans des situations spécifiques. Par conséquent, les actes qui violent ces dispositions spécifiques constituent inévitablement une violation du devoir de diligence ou du devoir de loyauté et servent de fondement juridique pour engager la responsabilité des exécutants de tâches d’entreprise.
Interdiction de concurrence : Protection des opportunités d’affaires des entreprises au Japon
Afin de prévenir l’exploitation des opportunités d’affaires de l’entreprise par les employés chargés de l’exécution des tâches, le droit des sociétés japonais impose des règles strictes concernant l’interdiction de concurrence. Cela représente l’une des régulations essentielles concrétisant le devoir de loyauté des employés exécutants.
Selon l’article 594, paragraphe 1 de la loi japonaise sur les sociétés, les employés chargés de l’exécution des tâches ne peuvent, en principe, se livrer à certaines activités concurrentielles sans l’approbation de tous les autres employés . Les “transactions concurrentielles” visées par cette régulation se déclinent en deux catégories. La première est “d’effectuer des transactions appartenant à la même catégorie que celles de l’entreprise pour son propre compte ou celui d’un tiers” . Cela interdit aux employés exécutants de réaliser des transactions qui sont en concurrence substantielle avec les affaires de l’entreprise, que ce soit pour leur propre compte ou celui d’autrui. La seconde catégorie est “de devenir directeur, exécutif ou employé chargé de l’exécution des tâches d’une entreprise ayant pour objet une activité similaire à celle de l’entreprise” . Cela limite la participation à la gestion d’une entreprise concurrente.
La caractéristique la plus importante de cette disposition est que l’exigence d’approbation repose, en principe, sur “l’unanimité de tous les autres employés” . Comparée à la possibilité pour les directeurs d’une société par actions d’obtenir une approbation par un vote majoritaire au conseil d’administration ou en assemblée générale, cette exigence est extrêmement stricte. Cette rigueur reflète la nature coopérative des sociétés en nom collectif et est basée sur une forte relation de confiance entre les membres. Si même un seul employé s’oppose, l’activité concurrentielle n’est pas autorisée.
Cependant, le droit des sociétés au Japon accorde une grande flexibilité aux sociétés en nom collectif, et ce principe strict peut être modifié par des dispositions spécifiques dans les statuts . Par exemple, les statuts peuvent assouplir l’exigence d’approbation en stipulant “l’approbation de la majorité des autres employés” . Par conséquent, pour comprendre les règles spécifiques concernant la concurrence par les employés exécutants, il est nécessaire de vérifier non seulement les articles de la loi sur les sociétés, mais aussi les statuts de l’entreprise concernée.
Si un employé chargé de l’exécution des tâches viole cette disposition et effectue une transaction concurrentielle, la transaction elle-même reste valide pour protéger la sécurité des transactions . Cependant, l’employé fautif est responsable des dommages-intérêts envers l’entreprise. À cet égard, l’article 594, paragraphe 2 de la loi sur les sociétés japonaises établit une disposition importante pour alléger le fardeau de la preuve pour l’entreprise. En effet, le montant du profit réalisé par l’employé exécutant ou un tiers grâce à la transaction concurrentielle est présumé être le montant du dommage subi par l’entreprise . Cela permet à l’entreprise de réclamer des dommages-intérêts basés sur le profit obtenu par le contrevenant sans avoir à prouver le montant spécifique des dommages.
Restrictions sur les transactions en conflit d’intérêts : la collision entre les intérêts de l’entreprise et ceux des employés au Japon
Afin de réguler les transactions où les employés chargés de l’exécution des opérations pourraient privilégier leurs propres intérêts au détriment de ceux de l’entreprise, le droit des sociétés japonais établit des “restrictions sur les transactions en conflit d’intérêts”. C’est un autre dispositif crucial pour assurer le devoir de loyauté que ces employés doivent à l’entreprise.
L’article 595, paragraphe 1, du droit des sociétés japonais stipule que, lorsqu’un employé chargé de l’exécution des opérations effectue une transaction en conflit d’intérêts, il doit, en principe, obtenir l’approbation de la majorité des autres employés. Cette réglementation est moins stricte que celle des transactions concurrentes, qui requiert l’unanimité, car elle ne demande que la majorité. Cela suggère que le législateur considère que les transactions en conflit d’intérêts, qui concernent principalement l’équité des prix et des conditions dans des transactions individuelles, présentent un risque de nature différente par rapport aux transactions concurrentes, qui représentent une menace sérieuse et constante pour l’activité même de l’entreprise.
Les transactions en conflit d’intérêts visées par cette réglementation se classent principalement en deux catégories. La première est la “transaction directe”. Il s’agit de cas où un employé chargé de l’exécution des opérations conclut un contrat directement avec la société, soit pour lui-même, soit pour un tiers. Par exemple, cela inclut les situations où un employé vend un bien immobilier qu’il possède personnellement à l’entreprise ou emprunte de l’argent à l’entreprise.
La seconde catégorie est la “transaction indirecte”. Cela concerne les transactions entre l’entreprise et un tiers qui ne sont pas des employés chargés de l’exécution des opérations, mais où les intérêts de l’entreprise et de l’employé sont substantiellement en conflit. Un exemple typique serait lorsque l’entreprise se porte garante pour une dette personnelle de l’employé ou établit une sûreté sur les actifs de l’entreprise pour garantir la dette de l’employé.
Comme pour la réglementation des transactions concurrentes, les exigences d’approbation pour les transactions en conflit d’intérêts peuvent être modifiées par des dispositions spécifiques dans les statuts de l’entreprise. Par exemple, il est possible de renforcer les exigences d’approbation pour les transactions plus importantes ou de dispenser de l’approbation pour les transactions mineures, en fonction de la situation réelle de l’entreprise.
Si une transaction en conflit d’intérêts est effectuée sans approbation, la validité de cette transaction peut varier selon que la contrepartie est un tiers ou non, mais elle est généralement interprétée comme étant valide, dans l’intérêt de la sécurité des transactions. Cependant, l’employé chargé de l’exécution des opérations qui néglige d’obtenir l’approbation peut être tenu responsable de la négligence de ses fonctions si l’entreprise subit des dommages. En outre, l’article 595, paragraphe 2, du droit des sociétés japonais précise que les dispositions interdisant les contrats auto-conclus et la double représentation établies par l’article 108 du code civil japonais ne s’appliquent pas aux transactions en conflit d’intérêts qui ont reçu une approbation appropriée. Cela permet à l’employé chargé de l’exécution des opérations de conclure un contrat au nom de l’entreprise tout en étant partie à la transaction, à condition que la procédure d’approbation ait été suivie.
Comparaison des obligations entre la société en commandite simple et la société par actions au Japon
Pour mieux comprendre les obligations spécifiques des associés gérants d’une société en commandite simple (Gōdō Kaisha), il est utile de les comparer avec celles des directeurs d’une société par actions (Kabushiki Kaisha), la forme d’entreprise la plus courante au Japon. Bien que les obligations des deux soient similaires, des différences importantes existent en raison de la structure organisationnelle sous-jacente, notamment en ce qui concerne les procédures d’approbation.
La différence fondamentale réside dans la relation entre l’entreprise et ses gestionnaires. Dans une société par actions, les propriétaires (actionnaires) et les gestionnaires (directeurs) sont généralement séparés, et la relation entre les directeurs et la société est légalement considérée comme un mandat. En revanche, dans une société en commandite simple, les associés qui sont les investisseurs gèrent l’entreprise, intégrant ainsi la propriété et la gestion. La relation entre les associés gérants et la société est régie non pas par un contrat de mandat, mais par les statuts de la société, qui sont un contrat entre les associés.
Cette différence structurelle a un impact direct sur les exigences d’approbation pour les transactions concurrentes et les conflits d’intérêts. Le tableau suivant résume les principales différences entre les exigences d’approbation pour les associés gérants d’une société en commandite simple et les directeurs d’une société par actions.
| Élément de comparaison | Société en commandite simple (Associés gérants) | Société par actions (Sans conseil d’administration) | Société par actions (Avec conseil d’administration) |
| Organe d’approbation pour les transactions concurrentes | Tous les autres associés (en principe) | Assemblée générale des actionnaires | Conseil d’administration |
| Exigences d’approbation pour les transactions concurrentes | Unanimité de tous (en principe) | Résolution ordinaire | Majorité des voix |
| Organe d’approbation pour les conflits d’intérêts | Majorité des autres associés (en principe) | Assemblée générale des actionnaires | Conseil d’administration |
| Exigences d’approbation pour les conflits d’intérêts | Majorité des voix (en principe) | Résolution ordinaire | Majorité des voix |
| Modification par les statuts | Possible | Impossible (changement de l’organe d’approbation non autorisé) | Impossible (changement de l’organe d’approbation non autorisé) |
| Article de loi de référence | Loi sur les sociétés, articles 594 et 595 | Loi sur les sociétés, article 356 | Loi sur les sociétés, articles 365 et 356 |
Comme le montre ce tableau, la caractéristique la plus distinctive d’une société en commandite simple est la possibilité de modifier les statuts. Dans une société par actions, les organes d’approbation pour les transactions concurrentes et les conflits d’intérêts sont fixés par la loi et ne peuvent être modifiés par les statuts. Cependant, dans une société en commandite simple, ces questions de gouvernance cruciales peuvent être conçues librement pour s’adapter à la situation spécifique de l’entreprise à travers les statuts. Par exemple, une petite entreprise avec une relation de confiance très forte entre les associés peut maintenir des règles strictes conformément aux principes de la loi, tandis qu’une entreprise avec de nombreux associés et nécessitant des décisions plus rapides peut assouplir les exigences d’approbation. Cette flexibilité est à la fois l’attrait d’une société en commandite simple et la raison pour laquelle l’examen minutieux des statuts est essentiel lors de l’évaluation de la gouvernance d’une entreprise.
Responsabilité pour négligence des tâches : conséquences juridiques d’une violation des obligations sous le droit japonais
Lorsqu’un employé chargé de l’exécution des tâches viole les devoirs de diligence et de loyauté, l’obligation d’éviter les conflits d’intérêts ou les transactions concurrentes, il peut être tenu responsable légalement. Cette responsabilité est appelée “responsabilité pour négligence des tâches”, et le droit des sociétés japonais établit deux types de responsabilités : celle envers la société et celle envers les tiers.
Pour commencer, la responsabilité envers la société est définie à l’article 596 du droit des sociétés japonais. Selon cet article, un employé chargé de l’exécution des tâches est responsable de compenser les dommages causés à la société par sa négligence dans l’exécution de ses tâches. Si plusieurs employés sont impliqués conjointement dans la négligence des tâches, ils sont solidairement responsables. L’expression “négligence dans l’exécution des tâches” inclut toutes les actions qui violent les devoirs de diligence et de loyauté, comme causer un préjudice à la société en effectuant des transactions concurrentes ou des transactions avec conflit d’intérêts sans autorisation.
Ensuite, la responsabilité envers les tiers est définie à l’article 597 du droit des sociétés japonais. Cette responsabilité survient lorsque l’employé chargé de l’exécution des tâches cause un dommage à un tiers (clients, créanciers, etc.) dans l’exercice de ses fonctions. Cependant, contrairement à la responsabilité envers la société, les conditions pour reconnaître cette responsabilité sont plus strictes. L’article stipule que l’employé n’est responsable des dommages envers les tiers que s’il y a “malveillance ou négligence grave”. Une simple négligence (légère) n’entraîne pas de responsabilité directe de l’employé envers les tiers.
La différence dans ces conditions de responsabilité reflète l’intention de la loi. Dans les relations internes à la société, les employés chargés de l’exécution des tâches doivent assumer un haut degré de diligence, et même une légère négligence peut entraîner une responsabilité. Cela permet de maintenir la discipline interne. D’autre part, dans les relations avec les tiers externes, il est nécessaire de protéger les employés afin qu’ils puissent prendre des décisions rapides et audacieuses sans craindre excessivement les risques associés aux décisions de gestion normales. Si même une légère négligence pouvait exposer à des risques de poursuites de la part de tiers, cela pourrait inhiber la gestion de l’entreprise. Par conséquent, la loi reconnaît la responsabilité personnelle envers les tiers uniquement dans des cas extrêmement graves, tels que la volonté délibérée de causer un dommage (malveillance) ou une négligence si flagrante qu’une personne normale ne la commettrait pas (négligence grave). Cette conception équilibrée du système est une base juridique importante pour promouvoir une gestion d’entreprise saine.
Résumé
Tel que détaillé dans cet article, les membres exécutifs d’une société à responsabilité limitée par actions (Gōdō Kaisha) jouent un rôle crucial dans la gestion de l’entreprise, tout en étant soumis à des obligations générales telles que le devoir de diligence et de loyauté en vertu de la loi japonaise sur les sociétés. De plus, pour protéger les intérêts de la société, des restrictions spécifiques sont imposées concernant les activités concurrentes et les transactions en conflit d’intérêts, qui nécessitent généralement l’approbation des autres membres. En cas de violation de ces obligations et de préjudice causé à la société ou à des tiers, les membres exécutifs peuvent être tenus personnellement responsables pour négligence dans l’exercice de leurs fonctions. En particulier, les sociétés à responsabilité limitée par actions permettent une large autonomie dans leurs statuts, il est donc essentiel de consulter les statuts de la société concernée pour comprendre les règles spécifiques qui s’appliquent, en plus des dispositions légales.
Le cabinet d’avocats Monolith possède une vaste expérience dans la fourniture de services juridiques relatifs à la gouvernance des sociétés à responsabilité limitée par actions et à la responsabilité de leurs dirigeants, ayant servi de nombreux clients au Japon. Notre cabinet compte plusieurs experts qui, en plus d’être qualifiés comme avocats au Japon, possèdent des qualifications d’avocats étrangers et sont anglophones, ce qui nous permet d’expliquer avec précision les dispositions complexes de la loi japonaise sur les sociétés dans un contexte commercial international et de fournir des conseils pratiques. De la création d’une société à responsabilité limitée par actions, à la conception de ses statuts, en passant par l’établissement d’un système de conformité pour l’exécution des opérations, jusqu’à la gestion des conflits éventuels, nous sommes prêts à soutenir vigoureusement votre entreprise du point de vue juridique.
Category: General Corporate