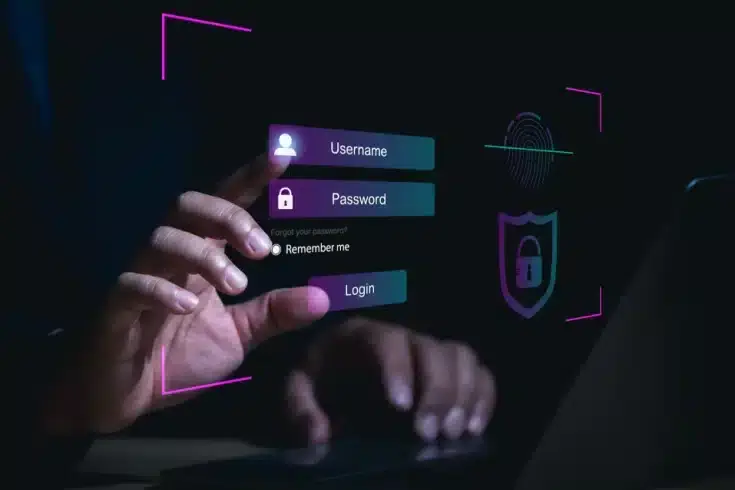Les 9 types d'œuvres protégées par le droit d'auteur japonais expliqués à travers des cas de jurisprudence

Dans le marché sophistiqué du Japon, la compréhension des droits de propriété intellectuelle est un enjeu managérial indispensable. Alors que de nombreux droits tels que les brevets et les marques nécessitent un enregistrement, le droit d’auteur naît automatiquement avec la création de l’œuvre. Cette caractéristique est avantageuse du point de vue de la protection des droits, mais elle implique également un risque constant de violation involontaire des droits d’autrui si l’on ne comprend pas précisément ce qui constitue une « œuvre » protégée. Par conséquent, saisir la définition et les catégories d’œuvres est crucial tant pour la gestion des risques que pour la protection des actifs intellectuels de votre entreprise. L’article 2, paragraphe 1, point 1 de la loi japonaise sur le droit d’auteur (Japanese Copyright Law) définit une œuvre comme « une expression créative d’idées ou de sentiments qui relève des domaines de la littérature, de la science, des arts ou de la musique ». Cette définition repose sur quatre critères : l’idée ou le sentiment, la créativité, l’expression et le domaine culturel. Pour compléter cette définition abstraite, la loi japonaise sur le droit d’auteur énumère des exemples spécifiques de types d’œuvres protégées. Cet article examine en détail les neuf principaux types d’œuvres énumérés à l’article 10, paragraphe 1 de la loi japonaise sur le droit d’auteur, en expliquant comment chacun est interprété légalement et les problèmes qui peuvent survenir dans des scénarios commerciaux réels, en s’appuyant sur des cas juridiques importants.
Définition de l’« œuvre » selon la loi japonaise sur le droit d’auteur
Pour bénéficier de la protection du droit d’auteur, une création doit d’abord répondre à la définition d’« œuvre » énoncée à l’article 2, paragraphe 1, point 1 de la loi japonaise sur le droit d’auteur. Cette définition se décompose en quatre exigences essentielles. Toute création qui manque ne serait-ce qu’une de ces exigences ne sera pas protégée en tant qu’œuvre.
Premièrement, l’œuvre doit contenir des « idées ou des sentiments ». Cela signifie que les simples faits ou données en tant que tels sont exclus des œuvres protégées par le droit d’auteur. Par exemple, le fait que la hauteur de la Tour de Tokyo soit de 333 mètres est une donnée objective qui n’implique ni idée ni sentiment et ne correspond donc pas à une œuvre.
Deuxièmement, l’œuvre doit être exprimée de manière « créative ». La « créativité » ici n’implique pas nécessairement une valeur artistique élevée ou une nouveauté totale. Il suffit que l’individualité de l’auteur se manifeste dans l’expression pour que l’œuvre soit considérée comme créative. Ainsi, une œuvre qui imite simplement celle d’un autre ou une expression banale qui serait identique quel que soit l’auteur n’est pas reconnue comme créative et ne constitue pas une œuvre protégée.
Troisièmement, il doit s’agir d’une « expression ». La loi sur le droit d’auteur protège des expressions concrètes, et non des idées sous-jacentes. C’est ce qu’on appelle la « dichotomie idée-expression », un principe fondamental du droit d’auteur. Par exemple, le concept ou l’intrigue d’un roman, en tant qu’idées, ne sont pas protégés, mais le texte concret rédigé sur la base de ces idées est une « expression » et, à ce titre, il est protégé. Ce principe a également un aspect de politique économique visant à promouvoir une concurrence saine et le développement culturel. Si l’on permettait la monopolisation des idées elles-mêmes, cela priverait les créateurs ultérieurs de l’opportunité de créer des œuvres supérieures sur le même thème, ce qui pourrait entraver l’innovation. La loi laisse les idées dans le domaine public afin de garantir un terrain fertile pour une diversité d’expressions. L’avantage concurrentiel des entreprises est également construit sur la qualité des « expressions » concrètes et légalement protégées, telles que le code logiciel, le design de la marque ou la rédaction des manuels, plutôt que sur des concepts d’affaires abstraits.
Quatrièmement, l’œuvre doit appartenir au domaine de la « littérature, de la science, des beaux-arts ou de la musique ». C’est une exigence qui limite les objets de protection aux activités créatives culturelles et exclut les produits industriels purs du champ de protection du droit d’auteur. Le design industriel est principalement protégé par d’autres lois sur la propriété intellectuelle, telles que la loi sur les dessins et modèles.
Les types exemplatifs d’œuvres protégées par le droit d’auteur
L’article 10, paragraphe 1 de la loi japonaise sur le droit d’auteur (著作権法) énumère neuf catégories spécifiques d’œuvres qui correspondent à la définition mentionnée précédemment. Bien que cette liste soit purement illustrative et que des œuvres ne figurant pas sur cette liste puissent être protégées si elles répondent à la définition d’une œuvre, comprendre ces catégories est extrêmement utile dans la pratique juridique.
Les œuvres littéraires sous le droit d’auteur japonais
Les œuvres littéraires (selon l’article 10, paragraphe 1, point 1 de la loi japonaise sur le droit d’auteur) englobent toutes les créations exprimées par le langage, telles que les romans, les scénarios, les dissertations, les conférences, ainsi que les textes et copies publicitaires publiés sur les sites web des entreprises. Cependant, le paragraphe 2 du même article précise clairement que les “informations diverses et les reportages d’actualité qui ne sont que la transmission de faits” ne sont pas considérés comme des œuvres littéraires. Cette disposition réaffirme la définition fondamentale d’une œuvre protégée par le droit d’auteur, qui ne reconnaît pas la créativité dans le simple rapport de faits.
Un critère de jugement important dans ce domaine a été établi par la décision de la Cour suprême du 28 juin 2001 (2001), communément appelée “l’affaire Esashi Oiwake”. Dans cette affaire, la similitude entre la partie prologue d’un livre et la narration diffusée dans une émission de télévision concernant la ville d’Esashi à Hokkaido a été contestée. La Cour a statué que pour qu’une adaptation d’une œuvre littéraire (la création d’une nouvelle œuvre basée sur une œuvre existante) soit reconnue, il est nécessaire que les “caractéristiques essentielles de l’expression” de l’œuvre originale soient maintenues et que la nouvelle œuvre permette à celui qui y est confronté de “percevoir directement” ces caractéristiques. Les deux œuvres partageaient la connaissance historique que la ville d’Esashi avait autrefois prospéré grâce à la pêche au hareng et la perception que la ville était la plus animée lors du concours national d’Esashi Oiwake. La Cour a jugé que ces éléments étaient des idées ou des faits banals non protégés et, étant donné que les expressions textuelles spécifiques étaient différentes, elle n’a pas reconnu de violation du droit d’auteur.
Cet arrêt est un guide important pour les activités des entreprises. Créer un nouveau rapport en ajoutant une analyse ou un point de vue unique de votre entreprise, basé sur les mêmes informations factuelles ou données publiées par un concurrent, ne constitue pas en principe une violation du droit d’auteur, tant que l’expression elle-même n’est pas imitée. Le droit d’auteur protège spécifiquement l'”expression” et non les “faits” ou les “idées” qui se trouvent derrière, un principe qui constitue la base de la libre concurrence et de la circulation de l’information.
Les œuvres musicales sous le droit d’auteur japonais
Les œuvres musicales, selon l’article 10, paragraphe 1, point 2 de la loi japonaise sur le droit d’auteur, désignent la composition musicale elle-même (la combinaison de mélodie, d’harmonie et de rythme). De plus, les paroles accompagnant la musique sont également protégées indépendamment en tant qu’œuvres littéraires.
Un jugement récent important concernant l’utilisation de la musique est celui de la Cour suprême du Japon en date du 24 octobre 2022 (2022年10月24日), communément appelé l’affaire des « cours de musique ». Dans cette affaire, il a été débattu de qui devait assumer l’obligation de payer les droits d’auteur pour les performances musicales lors des leçons dans une école de musique. La Cour suprême a statué que pour les performances effectuées par les enseignants, puisqu’elles sont destinées à être écoutées par les élèves, considérés comme le « public », et qu’elles se déroulent sous le contrôle de l’exploitant de l’école de musique, c’est l’exploitant qui est considéré comme responsable de la violation du droit d’auteur. En revanche, pour les performances des élèves, dont le but est l’amélioration de leurs propres compétences et où le contrôle de l’exploitant n’est pas aussi prononcé que pour les performances des enseignants, il a été conclu que l’exploitant n’est pas le principal utilisateur responsable.
Ce jugement suggère que non seulement la personne qui effectue physiquement l’acte, mais aussi celle qui « gère et contrôle » cet acte dans le cadre de son entreprise et en tire profit, peut être considérée comme l’utilisateur légal. Ce concept de « gestion et contrôle » est un élément important à prendre en compte non seulement pour les écoles de musique, mais aussi pour d’autres services où les clients utilisent des œuvres protégées, tels que les établissements de karaoké ou les plateformes d’affaires où les clients téléchargent du contenu, afin de déterminer dans quelle mesure les exploitants sont responsables au regard du droit d’auteur.
Les œuvres chorégraphiques et pantomimes sous le droit japonais
Les œuvres chorégraphiques et pantomimes (selon l’article 10, paragraphe 1, point 3 de la loi japonaise sur le droit d’auteur) protègent les expressions d’idées ou d’émotions à travers des mouvements corporels, comme les chorégraphies de ballet, de danse japonaise ou de danse en général.
Un exemple où la nature de l’œuvre a été reconnue est le jugement du tribunal de district d’Osaka en date du 20 septembre 2018 (2018), communément appelé le « procès de la chorégraphie de hula ». Dans ce procès, la question était de savoir si une chorégraphie spécifique de hula pouvait être protégée en tant qu’œuvre. Le tribunal a distingué entre les pas traditionnels et fondamentaux transmis depuis longtemps dans le hula (qui relèvent du domaine des idées ou des faits) et la partie où le chorégraphe a sélectionné et arrangé ces pas de manière originale pour créer une nouvelle expression (qui est protégée). Le tribunal a reconnu la créativité de cette dernière et a affirmé son caractère d’œuvre protégeable.
Cette jurisprudence montre que même une performance intangible et éphémère, comme une danse, peut être protégée par le droit d’auteur si elle est fixée de manière identifiable et reproductible, que ce soit par vidéo, notation chorégraphique ou par un enseignement continu. Cela a une importance significative pour les entreprises qui commandent ou utilisent des chorégraphies uniques pour des campagnes publicitaires, des événements ou des spectacles de divertissement. Les chorégraphies créées peuvent devenir une propriété intellectuelle précieuse pour une entreprise, il est donc essentiel de définir clairement l’étendue de leur utilisation et l’attribution des droits dans les contrats avec les chorégraphes.
Les œuvres d’art sous le droit d’auteur japonais
Les œuvres d’art selon l’article 10, paragraphe 1, point 4 de la loi japonaise sur le droit d’auteur (日本の著作権法第10条第1項第4号) incluent des éléments tels que la peinture, la gravure, la sculpture et la bande dessinée. Les enjeux juridiques dans ce domaine se concentrent particulièrement sur la protection des « arts appliqués », c’est-à-dire l’application de créations artistiques à des objets utilitaires.
Un cas de jurisprudence clé à ce sujet est le jugement de la Cour suprême de la propriété intellectuelle du 14 avril 2015 (2015年4月14日), communément appelé l’affaire « TRIPP TRAPP ». Ce cas a porté sur la question de savoir si le design original d’une chaise pour enfant pouvait être protégé en tant qu’œuvre d’art. La cour a estimé que le design de cette chaise, qui ne se limitait pas à une forme purement fonctionnelle, pouvait être apprécié esthétiquement de manière indépendante de sa fonction pratique et pourrait donc relever des œuvres d’art. Bien que finalement, la cour ait jugé qu’il n’y avait pas d’atteinte au droit d’auteur en raison de l’absence d’identité des caractéristiques essentielles de l’expression entre le produit en question et les produits concurrents, cette décision a été révolutionnaire en reconnaissant la possibilité de protéger le design d’un produit industriel utilitaire comme une œuvre d’art.
Ce précédent suggère qu’un design de produit peut être protégé de manière superposée par plusieurs lois sur la propriété intellectuelle, telles que la loi sur les dessins et modèles, la loi sur les marques (marques tridimensionnelles), la loi contre la concurrence déloyale et la loi sur le droit d’auteur. Alors que la durée de protection des droits de dessins et modèles est relativement courte, le droit d’auteur subsiste pendant une longue période après la mort de l’auteur, jusqu’à 70 ans. Par conséquent, il est conseillé aux entreprises d’examiner non seulement l’enregistrement de leurs designs de produits phares en tant que dessins et modèles, mais aussi de considérer si ces derniers possèdent une créativité esthétique suffisante pour être protégés en tant qu’œuvres d’art, et de construire une stratégie de propriété intellectuelle multidimensionnelle.
Les œuvres architecturales sous le droit d’auteur japonais
Les objets protégés en tant qu’œuvres architecturales (selon l’article 10, paragraphe 1, point 5 de la loi japonaise sur le droit d’auteur) sont interprétés de manière extrêmement limitative dans le cadre du droit d’auteur japonais. Les habitations générales et les immeubles de bureaux, même s’ils présentent un design remarquable, ne sont généralement pas considérés comme des œuvres architecturales.
Cette interprétation stricte a été établie par le jugement du Tribunal de district d’Osaka en date du 30 octobre 2003 (2003), communément appelé l’affaire « Sekisui House ». Un grand fabricant de maisons avait porté plainte contre un concurrent pour avoir imité le design de ses maisons modèles, mais le tribunal a rejeté la demande. La raison invoquée était que pour qu’une construction soit protégée en tant qu’œuvre d’art, elle doit posséder une qualité artistique suffisamment élevée pour être considérée comme une « œuvre d’art architecturale », reflétant les idées culturelles et spirituelles ainsi que les émotions du concepteur, allant au-delà d’une simple considération esthétique.
La mise en place d’un tel seuil élevé s’explique par des considérations politiques : protéger facilement par le droit d’auteur les designs relatifs aux fonctions de base et à la structure des bâtiments pourrait permettre une monopolisation par certains acteurs et entraver la concurrence saine et le développement de l’ensemble du secteur de la construction. Les bâtiments sont par nature des objets pratiques, et la loi privilégie l’intérêt général de la société plutôt que la protection de la créativité individuelle. Par conséquent, les entreprises du secteur de la construction et de l’immobilier doivent être conscientes que la probabilité que leurs designs architecturaux soient protégés par le droit d’auteur est extrêmement faible et qu’elles doivent assurer leur avantage concurrentiel par d’autres moyens, tels que la valeur de la marque ou la qualité du service.
Les œuvres graphiques sous le droit d’auteur japonais
Les œuvres graphiques (selon l’article 10, paragraphe 1, point 6 de la loi japonaise sur le droit d’auteur) incluent des éléments tels que les cartes, les dessins scientifiques, les graphiques, les modèles et les plans architecturaux. La créativité ici ne réside pas dans les informations objectives représentées par le graphique, mais plutôt dans la manière dont ces informations sont sélectionnées, organisées et exprimées graphiquement.
Les plans architecturaux sont un exemple typique de cette catégorie. Comme mentionné précédemment, il est rare que les bâtiments construits sur la base de ces plans soient protégés en tant qu’œuvres architecturales, mais les plans eux-mêmes peuvent être protégés en tant qu’œuvres graphiques. Cela est dû au fait que le concepteur utilise ses connaissances et compétences techniques spécialisées pour créer une expression originale de la structure et de l’agencement du bâtiment.
Cette structure juridique revêt une importance significative dans la relation entre l’architecte et le client (comme les promoteurs immobiliers). Les droits d’auteur des plans conçus par l’architecte appartiennent en principe à l’architecte. Par conséquent, si le client reproduit ces plans sans autorisation pour construire un autre bâtiment, ou les transmet à un autre architecte pour modification, cela pourrait constituer une violation des droits d’auteur des œuvres graphiques. Pour éviter cela, il est essentiel que, dans le contrat de commission de conception architecturale, le client obtienne les licences nécessaires (autorisation d’utilisation) pour utiliser les plans à des fins de construction, de rénovation future, de maintenance, etc.
Les œuvres cinématographiques sous le droit d’auteur japonais
Les œuvres cinématographiques, définies par l’article 10, paragraphe 1, point 7 de la loi japonaise sur le droit d’auteur (著作権法), sont très largement interprétées conformément à l’article 2, paragraphe 3 de la même loi. Elles englobent non seulement les films destinés au cinéma, mais aussi toute œuvre « exprimée par un procédé produisant un effet visuel ou audiovisuel similaire à celui des films et fixée sur un support matériel ». Cela inclut donc les programmes télévisés, les films publicitaires et même les jeux vidéo en tant qu’œuvres cinématographiques.
La première décision judiciaire reconnaissant un jeu vidéo comme une œuvre cinématographique fut rendue par le Tribunal de district de Tokyo le 28 septembre 1984 (1984年9月28日), dans l’affaire communément appelée « l’affaire Pac-Man ». Dans cette affaire, il était question de savoir si l’installation de machines de jeu Pac-Man reproduites sans autorisation dans une salle d’arcade constituait une violation du droit d’auteur, notamment du droit de représentation. Le tribunal a jugé que la série d’images enregistrées (fixées) dans la ROM du jeu, bien qu’elles changent en fonction des actions du joueur, constituaient dans leur ensemble une expression audiovisuelle créative et relevaient donc du domaine des œuvres cinématographiques.
Cette décision a eu un impact significatif sur le développement ultérieur de l’industrie japonaise du jeu vidéo. En classant les jeux comme des œuvres cinématographiques, les créateurs de jeux ont pu bénéficier des mêmes droits puissants (tels que le droit de représentation et le droit de distribution) que les producteurs de films. De plus, conformément à l’article 29 de la loi japonaise sur le droit d’auteur, les droits d’auteur des œuvres cinématographiques appartiennent en principe au producteur du film (la société de jeux vidéo), ce qui a simplifié la gestion des droits dans le cadre du développement de jeux complexes impliquant de nombreux créateurs. Cela a constitué une base juridique stable essentielle pour que l’industrie japonaise du jeu vidéo acquière une compétitivité mondiale.
Les œuvres photographiques sous le droit d’auteur japonais
Les œuvres photographiques, selon l’article 10, paragraphe 1, point 8 de la loi japonaise sur le droit d’auteur (著作権法), sont protégées par le droit d’auteur. Bien que le seuil de créativité requis pour qu’une photographie soit reconnue comme une œuvre soit relativement bas, un certain degré d’inventivité est néanmoins nécessaire.
Le critère de l’originalité d’une œuvre photographique a été établi par la décision de la Cour d’appel de Tokyo en date du 21 juin 2001 (2001年6月21日), communément appelée l’affaire de la “photo de pastèque fraîche”. La cour a statué que la créativité d’une photographie provient de la combinaison de divers choix et astuces du photographe, tels que la sélection du sujet, la composition, la gestion de la lumière et des ombres, l’angle, le moment de la prise de vue et les techniques de développement. Cette décision a établi une interprétation large selon laquelle presque toutes les photographies, à l’exception des simples copies mécaniques, sont protégées en tant qu’œuvres d’art dès lors que l’intention du photographe intervient.
Cette protection étendue suggère la nécessité d’une gestion des risques importante pour les entreprises. À l’ère numérique où il est facile d’obtenir des images en ligne, il est courant d’oublier que ces images peuvent être la propriété intellectuelle de quelqu’un. Cependant, l’utilisation non autorisée de photographies prises par d’autres sur le site Web d’une entreprise, ses réseaux sociaux ou dans ses supports publicitaires peut constituer une violation du droit d’auteur et entraîner des demandes de dommages et intérêts. Par conséquent, il est essentiel pour les entreprises d’établir un système de gestion interne rigoureux, incluant la conclusion de contrats de licence, la vérification des droits associés et la conservation des preuves d’autorisation. Il convient de partir du principe que toutes les photographies sont, en principe, l’œuvre de quelqu’un.
Les œuvres de programme sous le droit d’auteur japonais
Les œuvres de programme (selon l’article 10, paragraphe 1, point 9 de la loi japonaise sur le droit d’auteur) désignent les programmes informatiques. Ce qui est extrêmement important ici, c’est la disposition du paragraphe 3 de l’article 10. Selon cette disposition, la protection par le droit d’auteur s’étend à l’« expression » concrète du programme (la rédaction du code source), mais ne couvre pas le « langage de programmation » qui en est la base, les « conventions (protocoles) » telles que les procédures de communication, ni les méthodes de traitement que sont les « solutions (algorithmes) ». Cela applique la dichotomie idée-expression au monde des programmes.
Un exemple récent illustrant les points de discussion pratiques dans ce domaine est le jugement du Tribunal de district d’Osaka en date du 29 janvier 2024 (2024年1月29日). Dans cette affaire, il a été contesté qu’une entreprise commanditaire ait reproduit et modifié un programme développé sous contrat pour l’utiliser sur plusieurs sites. Le tribunal a d’abord affirmé la nature d’œuvre de création du code source du programme concerné, reconnaissant qu’en dépit de contraintes fonctionnelles, il existait une « marge de choix appropriée » dans la rédaction, et que la quantité de cette rédaction (environ 120 pages au format A4) reflétait la personnalité du développeur. Cependant, l’allégation de violation du droit d’auteur a été rejetée. La raison en était que, compte tenu de la longue relation commerciale entre les parties et du fait que le développeur avait livré le code source, et que le commanditaire était conscient de l’utilisation du programme sur plusieurs sites, il a été jugé qu’il y avait une « autorisation implicite » pour le commanditaire d’utiliser, de reproduire et de modifier le programme en interne.
Ce jugement contient une leçon importante pour les dirigeants d’entreprises qui sous-traitent le développement de logiciels. L’attribution des droits d’auteur sur un logiciel et l’étendue de la licence d’utilisation sont deux questions totalement distinctes. Se reposer sur les pratiques commerciales et les ententes tacites peut devenir une source de conflits futurs. Dans les contrats de développement sous-traité, il est essentiel, du point de vue de la gestion des risques, de définir clairement et spécifiquement dans le contrat l’étendue de la licence, y compris qui peut utiliser le programme, sur combien de sites ou de terminaux, de quelle manière, si les modifications sont autorisées et comment les droits d’accès au code source sont gérés.
Comparaison des critères de créativité pour différents types d’œuvres sous le droit d’auteur japonais
Comme nous l’avons vu jusqu’à présent, le critère de « créativité » dans la loi japonaise sur le droit d’auteur ne s’applique pas uniformément à toutes les œuvres. Les tribunaux interprètent ce critère de manière flexible en fonction de la nature de l’œuvre. En particulier, pour des œuvres à forte utilité pratique comme les bâtiments, le seuil de créativité est fixé très haut afin de ne pas restreindre indûment l’activité industrielle, tandis que pour des œuvres dont l’expression est une fin en soi, comme les photographies, la créativité est reconnue selon un seuil relativement bas. Comprendre cette différence de critères est utile pour déterminer quelles propriétés intellectuelles de votre entreprise peuvent bénéficier d’une protection robuste par le droit d’auteur. Le tableau suivant compare les points clés des critères de créativité pour les principaux types d’œuvres où les jugements divergent particulièrement.
| Type d’œuvre | Points clés pour le jugement de créativité | Exemples de jurisprudence pertinents |
| Œuvres architecturales | Doivent posséder un haut degré d’artistique et être évaluées comme « art architectural » | Affaire Sekisui House |
| Œuvres d’art (arts appliqués) | Peuvent être appréciées esthétiquement indépendamment de leur utilité pratique | Affaire TRIPP TRAPP |
| Œuvres littéraires | Les caractéristiques essentielles de l’expression reflètent-elles la personnalité de l’auteur ? | Affaire Esashi Oiwake |
| Œuvres photographiques | La sélection du sujet, la composition, la lumière, les ombres, etc., sont-elles travaillées avec ingéniosité ? | Affaire de la photo de pastèque fraîche |
| Œuvres de programme | Existe-t-il des alternatives dans l’expression, et la personnalité de l’auteur est-elle manifeste ? | Jugement du Tribunal de district d’Osaka, 29 janvier 2024 (2024) |
Résumé
La loi japonaise sur le droit d’auteur (Japanese Copyright Law) protège une large gamme d’expressions créatives, allant du langage à la musique, en passant par les arts et les programmes informatiques. Cependant, les définitions abstraites et les exemples fournis par les textes de loi ne suffisent pas toujours à déterminer si une œuvre spécifique est protégée ou non. Comme nous l’avons examiné dans cet article, la portée de la protection de chaque œuvre est concrétisée par la jurisprudence accumulée par les tribunaux au fil des ans. Ces décisions judiciaires fournissent des lignes directrices essentielles pour interpréter et appliquer le concept de “créativité” de la loi, en fonction des caractéristiques de chaque domaine. Par conséquent, pour évaluer correctement les problèmes liés au droit d’auteur, une connaissance approfondie des décisions judiciaires, en plus de la compréhension des lois, est indispensable. Le cabinet Monolith offre une vaste expérience en conseil juridique sur les questions de droit liées aux types d’œuvres décrits dans cet article à de nombreux clients au Japon. Notre cabinet compte plusieurs anglophones, y compris des avocats qualifiés à l’étranger, ce qui nous permet de fournir un soutien spécialisé et fluide aux entreprises internationales confrontées aux complexités du droit de la propriété intellectuelle au Japon.
Category: General Corporate