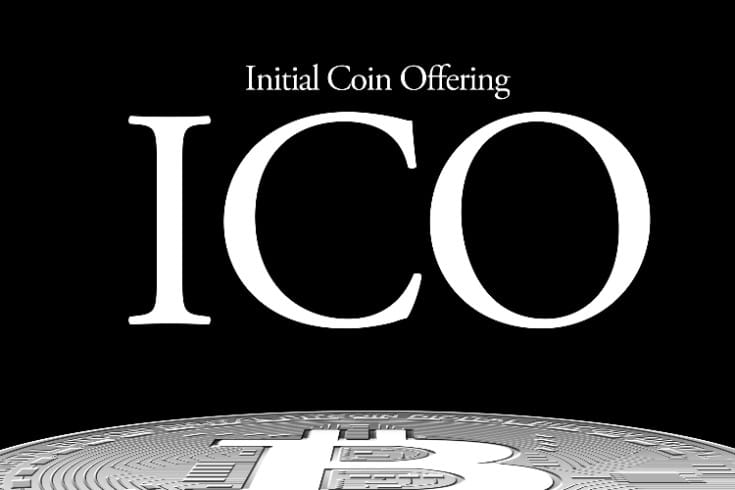Le retrait d'un associé et le remboursement de sa part dans une société en commandite simple selon le droit des sociétés japonais

La société à responsabilité limitée par actions (Godo Kaisha) est une forme d’entreprise extrêmement populaire au Japon en raison de la simplicité de ses procédures de création et de l’étendue de l’autonomie de ses statuts. Elle est souvent utilisée par les entreprises étrangères établissant une entité japonaise, en parallèle avec la société par actions. Cependant, sa structure hautement flexible peut engendrer des points de droit spécifiques concernant l’adhésion et le départ des associés (équivalents aux actionnaires dans une société par actions). Le départ d’un associé a un impact direct sur la pérennité de la société, les relations avec les autres associés et la répartition de la valeur patrimoniale. Par conséquent, il est essentiel pour les dirigeants et les responsables juridiques d’une société à responsabilité limitée par actions de comprendre précisément les dispositions du droit des sociétés japonais concernant le départ des associés.
Cet article offre une explication complète et détaillée du système de départ des associés d’une société à responsabilité limitée par actions, selon le droit des sociétés au Japon. Le départ d’un associé se divise principalement en deux catégories : le départ volontaire, basé sur la volonté de l’associé, et le départ légal, survenant à la suite de circonstances spécifiques définies par la loi. Ces systèmes sont conçus pour équilibrer la liberté de récupération du capital investi par les associés avec la continuité de l’entreprise et la protection des intérêts des créanciers. L’article détaille les exigences et les procédures de chaque système de départ, en se basant sur des articles de loi spécifiques, et approfondit également le calcul et les procédures juridiques pour le remboursement des parts, qui est l’un des droits les plus importants associés au départ. En intégrant des exemples de jurisprudence japonaise, nous clarifierons les aspects pratiques de ce système juridique complexe.
Démission volontaire basée sur la volonté de l’employé sous le droit japonais
La démission volontaire est un système où l’employé quitte la société à responsabilité limitée de son propre gré, et ses règles fondamentales sont établies par l’article 606 du droit des sociétés japonais. C’est une disposition cruciale qui reconnaît la liberté de l’employé de se retirer de la société, fondée sur la confiance personnelle entre les membres au sein d’une société à responsabilité limitée.
L’article 606, paragraphe 1, du droit des sociétés japonais établit la règle de base. Si les statuts ne fixent pas de durée de vie pour la société, ou si la durée de vie de la société est liée à celle d’un employé, chaque employé peut démissionner à la fin de l’exercice fiscal. Cependant, pour exercer ce droit, l’employé souhaitant démissionner doit notifier son intention de quitter la société au moins six mois à l’avance. Cette période de préavis de six mois vise à éviter que la gestion de l’entreprise ne soit perturbée par le départ imprévu d’un employé, en donnant le temps nécessaire pour prendre des mesures telles que la sélection d’un successeur ou la préparation des fonds pour le remboursement des parts.
Cependant, la société à responsabilité limitée est une forme d’organisation qui permet une large autonomie dans ses statuts. L’article 606, paragraphe 2, du droit des sociétés japonais applique ce principe aux règles de démission volontaire, permettant à la société de stipuler des dispositions différentes dans ses statuts. Par exemple, les statuts peuvent prévoir que « les employés peuvent démissionner à la fin de l’exercice fiscal en notifiant la société trois mois à l’avance », ce qui permet de fixer une période de préavis plus courte que celle prévue par la loi. Ainsi, en concevant stratégiquement les statuts, il est possible de construire des règles de démission flexibles adaptées à la réalité de chaque société.
De plus, le droit des sociétés japonais prévoit des mesures de secours pour les employés confrontés à des situations imprévues. L’article 606, paragraphe 3, du droit des sociétés japonais stipule qu’en cas de « circonstances inévitables », un employé peut démissionner à tout moment, indépendamment des dispositions des statuts ou de la période de préavis. L’expression « nonobstant les dispositions des deux paragraphes précédents » dans cet article indique que ce droit est une disposition impérative qui ne peut être limitée par les statuts. Cela sert de filet de sécurité pour empêcher que les employés soient liés de manière permanente à la gestion de l’entreprise. Parmi les exemples concrets de « circonstances inévitables », on peut citer le cas où un employé tombe gravement malade et nécessite un traitement à long terme, ou si l’employé déménage dans une région éloignée rendant l’exécution des tâches de l’entreprise difficile. Cette disposition établit un équilibre juridique entre les restrictions imposées par les statuts pour assurer la stabilité de l’entreprise et les circonstances personnelles graves des employés individuels.
Le départ statutaire d’un associé selon les dispositions légales japonaises
Le départ statutaire d’un associé est un système par lequel, indépendamment de la volonté de l’associé, celui-ci quitte automatiquement la société en raison de la survenance de certains motifs spécifiques énumérés à l’article 607, paragraphe 1, de la loi japonaise sur les sociétés (Companies Act). Ce mécanisme vise à réorganiser la structure de l’entreprise et à assurer une gestion stable lorsque des changements significatifs surviennent dans la position de l’associé ou lorsque les fondements de la relation de confiance entre les associés sont perdus.
Les motifs de départ statutaire prévus par l’article 607, paragraphe 1, de la loi japonaise sur les sociétés sont variés. Les principaux motifs sont les suivants :
- La survenance d’un motif prévu dans les statuts
- Le consentement de tous les associés
- Le décès de l’associé
- La disparition de l’associé personne morale suite à une fusion
- La décision d’ouverture d’une procédure de faillite à l’encontre de l’associé
- La dissolution de l’associé personne morale
- La mise sous tutelle de l’associé
- L’exclusion
Ces motifs s’appliquent selon que l’associé est une personne physique ou une personne morale. Par exemple, le « décès » s’applique à un associé personne physique, tandis que la « disparition par fusion » ou la « dissolution » s’appliquent à un associé personne morale.
Ici aussi, le principe de l’autonomie des statuts de la société à responsabilité limitée joue un rôle certain. L’article 607, paragraphe 2, de la loi japonaise sur les sociétés permet à une société de prévoir dans ses statuts l’exclusion de certains motifs de départ statutaire. Plus précisément, il est possible de stipuler dans les statuts que l’associé ne quittera pas la société même en cas de « décision d’ouverture d’une procédure de faillite », de « dissolution » ou de « mise sous tutelle ». Cette disposition revêt une importance stratégique, notamment lorsque la société à responsabilité limitée est utilisée comme joint-venture entre entreprises. Par exemple, il est possible de concevoir les statuts de manière à ce que les difficultés financières (faillite) ou la réorganisation (dissolution) d’une entreprise partenaire n’entraînent pas automatiquement son retrait de la joint-venture, renforçant ainsi la continuité de l’activité. Ainsi, les statuts ne sont pas de simples documents formels, mais peuvent devenir un outil stratégique pour gérer les risques futurs.
En outre, indépendamment de ces motifs, l’article 609 de la loi japonaise sur les sociétés accorde au créancier qui a saisi la part de l’associé le droit de faire quitter cet associé à la fin de l’exercice social. Il s’agit d’un système de départ spécial conçu comme un moyen pour le créancier de récupérer son investissement.
Le retrait forcé d’un employé par la volonté d’autres membres : l’exclusion sous le droit japonais
Parmi les motifs légaux de retrait d’une société, l’un des plus graves et conflictuels est l'”exclusion”. Ce mécanisme permet, en cas de faute grave d’un employé, de l’exclure de force de la société par la volonté des autres membres. Comme il s’agit d’une mesure extrêmement puissante qui prive l’employé de sa position contre sa volonté, le droit des sociétés japonais impose des procédures strictes et des exigences substantielles.
La procédure d’exclusion est définie à l’article 859 du droit des sociétés japonais. Pour procéder à une exclusion, une résolution doit d’abord être adoptée par une majorité des membres autres que celui visé par l’exclusion. Ensuite, la société, en tant que plaignante, doit intenter une action en justice pour demander l’exclusion de l’employé. Il n’est pas possible de procéder à une exclusion uniquement sur la base d’un accord entre les membres ; il est impératif de solliciter un jugement judiciaire.
L’article mentionné énumère les motifs légaux justifiant une exclusion, tels que :
- Le non-respect de l’obligation de contribution
- La violation de l’obligation de non-concurrence
- La commission d’actes frauduleux dans l’exécution des opérations de la société
- Le manquement à d’autres obligations importantes
Cependant, les tribunaux japonais n’accordent pas facilement l’exclusion sur la seule base d’actes correspondant formellement à ces motifs. La jurisprudence indique que pour justifier une exclusion, il est nécessaire que les actes de l’employé concerné aient irrémédiablement détruit la confiance entre les membres et que le maintien de cet employé au sein de la société constitue un obstacle significatif à la survie et à la continuité des activités de la société.
Cette approche judiciaire est clairement illustrée par deux décisions de justice contrastées. La première est un jugement du Tribunal de district de Tokyo en date du 29 novembre 2021, qui a admis l’exclusion. Dans cette affaire, le représentant d’un membre corporatif avait détourné des fonds d’une société à responsabilité limitée pour son propre bénéfice. Le tribunal a reconnu que cet acte correspondait à l’acte frauduleux dans l’exécution des opérations de la société, tel que défini à l’article 859, paragraphe 3, du droit des sociétés japonais. Le tribunal a jugé que cette grave trahison avait fondamentalement détruit la confiance entre les membres et rendu impossible la gestion normale de la société, justifiant ainsi l’exclusion. Dans ce cas, l’exclusion de l’employé fautif était nécessaire pour la survie de la société.
L’autre décision est celle du Tribunal de district de Tokyo du 26 septembre 2019, qui a refusé d’accorder l’exclusion. Dans cette affaire, un employé était accusé de fraude fiscale et d’autres comportements inappropriés. Cependant, le tribunal a pris en compte le fait que cet employé était la figure centrale de l’entreprise et générait à lui seul presque tous les revenus de la société. En conséquence, même si cet employé avait commis des fautes, son exclusion aurait rendu impossible la continuité des activités de la société, menant à son effondrement. Le tribunal a conclu que l’exclusion, dans ces circonstances, nuirait à l’objectif même de la survie de la société et ne pouvait donc être accordée.
Ces cas jurisprudentiels montrent que les tribunaux japonais considèrent l’exclusion non pas comme une punition pour l’employé fautif, mais comme un dernier recours pour préserver la société. L’argument central des procès est de savoir si l’exclusion de l’employé est véritablement indispensable à la continuité des activités de la société, une question qui doit être évaluée du point de vue de la gestion et des intérêts de l’entreprise. Par conséquent, une société envisageant une exclusion doit non seulement prouver la faute grave de l’employé, mais aussi présenter un plan concret démontrant que l’entreprise peut continuer ses activités après son départ, ce qui est crucial pour mener à bien le procès.
Remboursement des parts suite à une démission au Japon
Lorsqu’un employé quitte volontairement ou est contraint de quitter une entreprise au Japon, il a le droit de réclamer le remboursement de ses parts auprès de l’entreprise. C’est un droit fondamental de propriété pour les employés démissionnaires, établi par l’article 611, paragraphe 1, de la loi japonaise sur les sociétés .
Le calcul du montant du remboursement des parts doit être effectué « selon la situation des biens de la société au moment de la démission », conformément à l’article 611, paragraphe 2, de la loi japonaise sur les sociétés . En pratique, cela signifie que le montant des actifs nets de l’entreprise au moment de la démission est calculé, puis multiplié par la proportion des parts de l’employé démissionnaire. Le remboursement peut être effectué en argent, que la contribution initiale ait été en espèces ou en nature (même article, paragraphe 3) .
Concernant le moment et l’objectivité de l’évaluation des parts, des décisions judiciaires importantes ont été rendues. Dans un cas de litige fiscal (jugement du tribunal de district de Nagoya), l’évaluation du droit de réclamation de remboursement des parts d’un employé décédé (une cause de démission légale) a été contestée . Le tribunal a statué que la valeur du droit de réclamation de remboursement devrait être déterminée objectivement sur la base de la valeur des actifs nets de l’entreprise au moment de la démission due au décès de l’employé. Il a également conclu que tout accord postérieur entre les employés restants et les héritiers pour fixer le montant du remboursement à zéro n’affecte pas la valeur objective du droit établi au moment de la démission . Ce jugement clarifie que le montant du remboursement des parts doit être calculé sur la base de faits objectifs concernant la situation financière de l’entreprise au moment de la démission, et non sur un accord arbitraire entre les parties.
Le remboursement des parts est un acte qui entraîne la sortie des biens de l’entreprise, et des procédures strictes sont établies pour protéger les créanciers de l’entreprise. Si le montant du remboursement dépasse le montant des bénéfices non distribués de l’entreprise, celle-ci doit suivre une procédure de protection des créanciers. Si le remboursement nécessite une réduction du capital social, les procédures de l’article 627 de la loi japonaise sur les sociétés (telles que l’annonce officielle et la sommation individuelle) sont requises . Même si le capital social n’est pas réduit, si le montant du remboursement dépasse les bénéfices non distribués, la procédure d’opposition des créanciers basée sur l’article 635 de la loi japonaise sur les sociétés est nécessaire . Ces procédures offrent aux créanciers l’opportunité de présenter des objections et obligent l’entreprise à effectuer des paiements ou à fournir des garanties si nécessaire.
En cas de remboursement abusif en violation de ces réglementations, l’employé qui a exécuté l’opération peut être tenu responsable de rembourser le montant à l’entreprise, conformément à l’article 636 de la loi japonaise sur les sociétés . Cela montre que la loi s’étend pour s’assurer que les événements internes tels que la démission d’un employé ne nuisent pas aux intérêts des créanciers externes de l’entreprise.
Comparaison entre la démission volontaire et la démission statutaire sous le droit japonais
La démission volontaire et la démission statutaire, que nous avons détaillées jusqu’à présent, ont en commun le fait que l’employé se sépare de l’entreprise. Cependant, elles diffèrent fondamentalement dans leurs causes d’occurrence et leurs caractéristiques juridiques. La démission volontaire est un processus actif qui commence par la manifestation volontaire de la volonté de l’employé, tandis que la démission statutaire est un processus passif qui survient en raison de causes objectives définies par la loi ou les statuts de l’entreprise. Les statuts interviennent de différentes manières dans ces deux cas : dans la démission volontaire, ils peuvent ajuster des aspects procéduraux tels que la modification de la période de préavis, et dans la démission statutaire, ils peuvent exclure certaines causes spécifiques des motifs de démission. Comprendre ces différences est essentiel pour gérer correctement la gouvernance d’une société à responsabilité limitée.
| Caractéristiques | Démission volontaire | Démission statutaire |
| Base & Cause d’occurrence | Volonté spontanée de l’employé | Causes définies par la loi ou les statuts |
| Volonté de l’employé | La volonté de l’employé est la cause directe | Survient indépendamment de la volonté de l’employé |
| Rôle des statuts | Peut modifier la période de préavis de démission, etc. | Peut exclure certains motifs statutaires de démission |
| Moment | En principe, à la fin de l’exercice fiscal | Au moment de la survenance de la cause |
Les conséquences juridiques d’un départ de l’entreprise au Japon
Le départ d’un employé entraîne plusieurs effets juridiques au-delà du simple remboursement des parts sociales.
Tout d’abord, lorsque l’employé quitte l’entreprise, les informations le concernant inscrites dans les statuts (telles que le nom et l’adresse) sont automatiquement considérées comme abrogées sans qu’une résolution de modification des statuts soit nécessaire. Cela est stipulé à l’article 610 de la loi japonaise sur les sociétés (会社法) et contribue à simplifier les procédures.
Ensuite, il existe des dispositions concernant la responsabilité de l’employé qui quitte l’entreprise. Selon l’article 612 de la loi japonaise sur les sociétés, un employé qui démissionne reste responsable des dettes contractées par l’entreprise avant que sa démission ne soit enregistrée. Cette responsabilité s’éteint deux ans après l’enregistrement de la démission. Cette disposition vise à protéger les créanciers qui ont effectué des transactions avec l’entreprise.
Enfin, et c’est peut-être l’impact le plus significatif, il y a le risque de dissolution de l’entreprise. Si le départ d’un employé entraîne l’absence de tout membre dans une société en nom collectif, alors, conformément à l’article 641, paragraphe 4 de la loi japonaise sur les sociétés, l’entreprise est automatiquement dissoute. Pour préserver l’existence de l’entreprise, il est essentiel d’éviter une situation où il ne reste aucun membre.
Résumé
La démission d’un associé d’une société à responsabilité limitée japonaise (合同会社) ne se limite pas à un simple départ de personnel, mais est un processus juridique complexe qui affecte l’organisation de l’entreprise, ses actifs et même sa pérennité. Le droit des sociétés au Japon offre deux cadres pour la démission d’un associé : la « démission volontaire », qui respecte la volonté de l’associé, et la « démission statutaire », basée sur des motifs objectifs, chacun étant régi par des règles détaillées. En particulier, l’« exclusion » d’autres associés et le « remboursement des parts » lors de la démission sont soumis à des exigences et des procédures juridiques strictes, nécessitant une approche prudente. Ces systèmes sont fondés sur l’intention de la loi de concilier plusieurs valeurs : les droits des associés, la continuité de l’entreprise et la protection des intérêts des créanciers. Ainsi, la gestion des risques la plus efficace consiste à anticiper les diverses situations qui pourraient survenir à l’avenir dès la création de l’entreprise et à concevoir stratégiquement les statuts en fonction de la réalité de votre entreprise.
Le cabinet d’avocats Monolith possède une expertise approfondie et une expérience pratique du droit des sociétés au Japon et a fourni des services juridiques liés à la création, à la gestion et à la démission des associés de sociétés à responsabilité limitée à de nombreux clients, tant nationaux qu’internationaux. Notre cabinet compte plusieurs avocats parlant anglais et qualifiés à l’étranger, qui comprennent profondément les défis et les besoins uniques de l’environnement commercial international. De la rédaction des statuts à la mise en œuvre de procédures de démission complexes, en passant par la résolution des conflits connexes, nous sommes en mesure de fournir un soutien juridique complet et optimisé pour votre situation. Si vous avez des questions concernant ce thème, n’hésitez pas à contacter notre cabinet.
Category: General Corporate