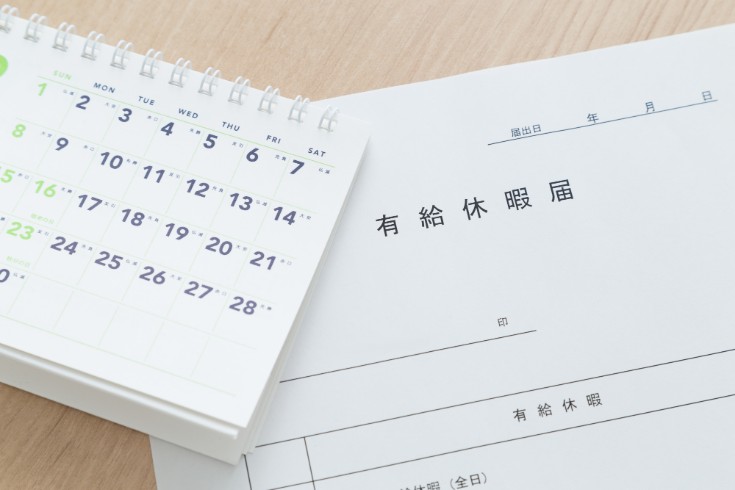Interdiction des pratiques déloyales de travail dans le droit du travail japonais

Dans la gestion d’entreprise au Japon, la relation avec les travailleurs est un élément extrêmement important. En particulier, la relation avec les syndicats est essentielle pour établir des relations de travail saines. Le système juridique japonais a mis en place un cadre spécifique pour encourager les travailleurs et les employeurs à se positionner sur un pied d’égalité dans les négociations. Au cœur de ce cadre se trouve l’interdiction des “actes de travail déloyaux” définis par la loi japonaise sur les syndicats. Ce système vise à garantir substantiellement les droits fondamentaux des travailleurs tels que le droit de s’associer, le droit de négociation collective et le droit à l’action collective, droits garantis par la Constitution du Japon. Les actes spécifiques qui violent ces droits sont strictement interdits par la loi, et en cas de violation, l’employeur peut être tenu légalement responsable. Les actes considérés comme des actes de travail déloyaux vont du licenciement ou du traitement défavorable d’un membre du syndicat, au refus de négociation collective sans motif valable, jusqu’à l’intervention injuste dans les opérations du syndicat. Lorsque de tels actes sont commis, les travailleurs ou les syndicats peuvent demander réparation auprès d’un organe administratif spécialisé, la Commission du travail, ou par le biais des tribunaux. À travers ces procédures, l’employeur peut être ordonné de restaurer la situation antérieure ou de payer des dommages-intérêts, ce qui peut avoir un impact significatif sur la réputation et les finances de l’entreprise. Par conséquent, pour les dirigeants d’entreprise et les responsables juridiques des entreprises opérant au Japon, il est essentiel de comprendre précisément l’objectif du système d’actes de travail déloyaux, le contenu spécifique des actes interdits et les procédures de réparation en cas de violation, afin de se conformer à la législation dans la gestion quotidienne du travail, de gérer les risques juridiques et de maintenir une exploitation commerciale stable. Cet article explique de manière exhaustive le système d’actes de travail déloyaux, depuis sa base juridique jusqu’aux types d’actes interdits et aux procédures de réparation.
Les fondements et objectifs du système de recours contre les pratiques déloyales du travail au Japon
Le fondement juridique du système de recours contre les pratiques déloyales du travail remonte à la Constitution du Japon. L’article 28 de la Constitution japonaise garantit aux travailleurs des droits fondamentaux tels que le droit de s’associer, le droit de négocier collectivement et le droit d’agir collectivement (les trois droits du travail). Pour concrétiser ces garanties constitutionnelles et leur donner une efficacité réelle, le Japon a adopté la Loi sur les syndicats de travailleurs .
L’article 1 de la Loi sur les syndicats de travailleurs au Japon définit clairement son objectif. Selon cet article, la loi vise à « améliorer la position des travailleurs en favorisant leur capacité à négocier sur un pied d’égalité avec les employeurs ». Ce concept d’« égalité de position » est essentiel pour comprendre le système de recours contre les pratiques déloyales du travail. Individuellement, les travailleurs sont souvent placés dans une position plus faible que les employeurs en raison des rapports de force économiques. Par conséquent, la loi considère qu’il est indispensable que les travailleurs s’unissent et organisent des syndicats pour négocier collectivement avec les employeurs, afin de maintenir et d’améliorer les conditions de travail et d’élever leur statut économique.
Pour atteindre cet objectif, l’article 7 de la Loi sur les syndicats de travailleurs au Japon énumère spécifiquement certaines actions susceptibles de violer les droits d’association des travailleurs, les qualifiant de « pratiques déloyales du travail » et les interdisant . Autrement dit, le système de recours contre les pratiques déloyales du travail n’est pas simplement un ensemble de dispositions interdites, mais une intervention systémique proactive visant à protéger substantiellement les trois droits du travail garantis par la Constitution et à équilibrer les rapports de force entre employeurs et employés. Grâce à ce système, les syndicats peuvent agir sans craindre une pression injuste de la part des employeurs et s’asseoir à la table des négociations collectives. Ainsi, le fondement de ce système repose sur les droits fondamentaux garantis par la Constitution, et son objectif est de réaliser une relation de négociation équitable entre employeurs et employés. Comprendre ce point est essentiel pour saisir l’esprit de la loi qui sous-tend chaque interdiction et pour gérer correctement les ressources humaines.
Les types d’actes interdits par la loi japonaise sur les syndicats de travailleurs
L’article 7 de la loi japonaise sur les syndicats de travailleurs (Japanese Trade Union Law) classe spécifiquement les actes injustes de travail que les employeurs ne doivent pas commettre en quatre catégories distinctes. Ces dispositions protègent divers aspects des activités syndicales, allant de la formation des syndicats à leur gestion, en passant par les négociations collectives et jusqu’aux demandes de recours.
Traitement défavorable en raison de l’appartenance à un syndicat selon l’article 7, paragraphe 1 de la Loi sur les syndicats de travail japonaise
L’article 7, paragraphe 1 de la Loi sur les syndicats de travail au Japon interdit aux employeurs de licencier ou de traiter de manière défavorable les travailleurs pour les raisons suivantes :
- L’appartenance à un syndicat de travail
- La tentative d’adhésion à un syndicat de travail
- Les efforts pour former un syndicat de travail
- L’exercice d’activités légitimes liées au syndicat de travail
Le terme « traitement défavorable » ne se limite pas à des mesures sévères telles que le licenciement. Il englobe également la rétrogradation, la réduction de salaire, la discrimination dans les promotions ou avancements, les mutations défavorables, l’évaluation discriminatoire des primes et le harcèlement sur le lieu de travail, soit toute action susceptible de porter préjudice à la position économique ou au statut du travailleur.
Pour qu’un acte de travail injuste soit établi, il est nécessaire que l’action de l’employeur soit basée sur les activités syndicales mentionnées ci-dessus comme raison. Cela signifie que l’employeur doit avoir une « intention de travail injuste ». Cette intention est un élément subjectif indiquant que l’employeur a agi sur la base de motifs anti-syndicaux, mais sa preuve n’est pas facile. Par conséquent, dans la pratique, l’intention de travail injuste est souvent déduite de diverses preuves circonstancielles objectives. Par exemple, le fait que l’employeur ait régulièrement exprimé son aversion pour les syndicats, que le traitement défavorable ait eu lieu immédiatement après l’adhésion à un syndicat ou une activité syndicale spécifique, que les raisons de nécessité opérationnelle avancées par l’entreprise pour justifier le traitement défavorable soient irrationnelles, ou qu’il existe une différence de traitement irrationnelle entre les membres du syndicat et les non-membres, sont des éléments importants pour déduire l’intention de travail injuste.
De plus, le même paragraphe interdit également « de faire de la non-adhésion à un syndicat ou du retrait d’un syndicat une condition d’emploi ». Cela est connu sous le nom de « contrat jaune » et est clairement illégal car il viole directement le droit des travailleurs à s’organiser.
À cet égard, la question de la relation avec la liberté d’embauche a été soulevée dans l’affaire JR Hokkaido/JR Freight (décision de la Cour suprême du 22 décembre 2003). Bien que cette affaire concerne la situation particulière de la privatisation des chemins de fer nationaux, la Cour suprême a jugé que le refus d’embauche par la nouvelle société ne constituait pas immédiatement un acte de travail injuste. Cependant, cette décision ne reconnaît pas que la liberté d’embauche de l’employeur est absolument sans contrainte. Il reste possible qu’un acte de travail injuste soit établi si, par exemple, un employeur refuse d’embaucher un travailleur spécifiquement parce qu’il est membre d’un syndicat, dans le but d’exercer un contrôle ou une ingérence sur le syndicat, ou si d’autres circonstances particulières sont présentes.
Refus de négociation collective sans motif valable selon l’article 7, paragraphe 2 de la loi japonaise sur les syndicats
L’article 7, paragraphe 2 de la loi japonaise sur les syndicats interdit aux employeurs de refuser sans motif valable de mener des négociations collectives avec les représentants des travailleurs qu’ils emploient. Cette disposition garantit de manière substantielle le droit à la négociation collective, qui est l’une des activités les plus importantes pour les syndicats.
Une violation de cette disposition ne se limite pas à un refus explicite de la demande de négociation collective émanant d’un syndicat. Elle inclut également ce qu’on appelle une “négociation de mauvaise foi”, où l’employeur se présente à la table des négociations mais refuse effectivement de négocier. Les exemples typiques de négociation de mauvaise foi incluent les comportements suivants :
- Envoyer uniquement des personnes sans pouvoir de décision aux négociations.
- Ignorer complètement les arguments et demandes du syndicat et se contenter de répéter les positions de l’entreprise sans montrer une volonté de dialogue.
- Refuser sans raison valable de fournir des documents de base sur la situation financière de l’entreprise lors de négociations salariales.
- Reporter indûment les dates de négociation collective sous prétexte de surcharge de travail.
Les “motifs valables” permettant à un employeur de refuser la négociation collective sont interprétés de manière très restrictive. Par exemple, des raisons telles que “les demandes du syndicat sont excessives”, “les négociateurs incluent des dirigeants d’organisations supérieures externes” ou “nous sommes actuellement trop occupés” ne sont généralement pas reconnues comme valables. Ces questions devraient être discutées dans le cadre des négociations collectives.
La portée de ce terme “employeur” a été mise en question dans l’affaire Asahi Broadcasting (décision de la Cour suprême du Japon du 28 février 1995). Dans cette affaire, une chaîne de télévision a refusé de négocier collectivement avec les travailleurs intérimaires d’une entreprise sous-traitante avec laquelle elle n’avait pas de contrat d’emploi direct. La Cour suprême a établi un cadre de jugement selon lequel, même si l’on n’est pas l’employeur direct, on doit s’engager dans la négociation collective en tant qu'”employeur” au sens de la loi sur les syndicats, dans la mesure où l’on est en position de contrôler et de décider de manière réaliste et concrète des conditions de travail fondamentales des travailleurs. Ce précédent est devenu une ligne directrice importante pour déterminer qui devrait être partie prenante dans les négociations, dans un contexte où les formes d’emploi sont de plus en plus diversifiées.
Il est important de noter que l’obligation imposée par cette loi aux employeurs est de s’engager dans le “processus” de négociation de bonne foi, et non de produire le “résultat” d’accepter les demandes du syndicat. Même en cas de refus des demandes du syndicat, l’employeur doit expliquer concrètement ses raisons et proposer des alternatives, montrant ainsi un effort sincère pour parvenir à un accord. Si ce processus est respecté, l’employeur sera considéré comme ayant rempli son obligation de négociation de bonne foi, même si les parties ne parviennent finalement pas à un accord.
L’ingérence et l’assistance financière dans la gestion des syndicats sous le droit japonais (Article 7, paragraphe 3 de la Loi sur les syndicats)
L’article 7, paragraphe 3 de la Loi japonaise sur les syndicats vise à garantir l’autonomie des syndicats en interdisant « toute domination ou ingérence dans la formation ou la gestion d’un syndicat par les travailleurs », ainsi que « l’assistance financière dans la gestion des dépenses d’un syndicat ».
L’« ingérence » fait référence à toute action de l’employeur qui influence les décisions ou les activités d’un syndicat et nuit à son autonomie. Les manifestations de cette ingérence sont variées, mais incluent typiquement les exemples suivants :
- Les actes visant à entraver la formation d’un syndicat ou à inciter les membres à se désaffilier.
- Les déclarations suggérant que l’engagement syndical pourrait nuire aux perspectives de promotion, décourageant ainsi l’activité syndicale.
- Le soutien à la création d’un second syndicat plus coopératif avec l’entreprise, ou toute action favorisant ou défavorisant un syndicat spécifique (discrimination entre syndicats).
- L’entrave injustifiée à des activités syndicales légitimes (distribution de tracts, assemblées, etc.).
La question de savoir si les déclarations de l’employeur constituent une ingérence fait souvent débat. À cet égard, l’affaire Prima Ham (décision de la Cour suprême du 10 septembre 1982) a établi un critère important. Selon cette décision, pour déterminer si les propos de l’employeur constituent une pratique de travail déloyale, il faut considérer « le contenu des propos, les moyens et méthodes de communication, le moment de la déclaration, le statut et la position de celui qui s’exprime, ainsi que l’impact de la déclaration », et évaluer si ces propos ont un effet intimidant sur les membres du syndicat et influencent l’organisation et la gestion du syndicat.
Par ailleurs, l’interdiction de l’« assistance financière » vise à empêcher les syndicats de devenir économiquement dépendants de l’employeur, ce qui pourrait compromettre leur capacité à agir de manière autonome. Cependant, l’article 7, paragraphe 3 de la Loi japonaise sur les syndicats prévoit des exceptions à cette interdiction. Cela inclut, par exemple, permettre aux travailleurs de participer à des négociations collectives pendant les heures de travail avec rémunération (check-off), des dons à des fonds de bien-être social, et la fourniture d’un bureau de taille minimale. Ces actions sont exceptionnellement autorisées car elles contribuent à la bonne gestion des relations entre employeurs et employés.
Traitement défavorable en représailles à une plainte déposée auprès de la Commission du travail (Article 7, paragraphe 4 de la Loi sur les syndicats de travailleurs au Japon)
L’article 7, paragraphe 4 de la Loi japonaise sur les syndicats de travailleurs interdit aux employeurs de licencier ou de traiter de manière défavorable un employé pour avoir déposé une plainte pour actes déloyaux de travail auprès de la Commission du travail, pour avoir fourni des preuves ou pour avoir témoigné dans le cadre de la procédure d’examen.
Cette disposition vise à garantir l’efficacité du système de recours contre les actes déloyaux de travail. Si les travailleurs étaient victimes de représailles simplement pour avoir cherché à obtenir réparation, ils pourraient être dissuadés d’utiliser le système, ce qui le rendrait inopérant. C’est pourquoi la loi interdit explicitement de tels actes de représailles.
La protection offerte par cette disposition ne se limite pas à l’acte de déposer une plainte auprès de la Commission du travail. Elle s’étend également aux actes de témoigner en tant que témoin ou de soumettre des preuves au cours de l’enquête ou de l’audience de la Commission. En cas de violation de cette disposition, le traitement défavorable subi pourrait être jugé nul et non avenu, tout comme le serait un traitement défavorable au sens de l’article 1.
Procédures de recours contre les actes de travail déloyaux au Japon
Lorsqu’un employeur commet un acte de travail déloyal, les travailleurs ou les syndicats affectés peuvent chercher à obtenir une réparation légale pour restaurer leurs droits. Sous le système juridique japonais, deux principales procédures de recours sont disponibles. La première est le “recours administratif” par l’intermédiaire d’une agence administrative spécialisée appelée la commission du travail, et la seconde est le “recours judiciaire” à travers les tribunaux.
Le recours administratif par la Commission des Relations de Travail au Japon
La Commission des Relations de Travail est un organisme administratif spécialisé dans la résolution des conflits entre employeurs et employés, composé de membres représentant l’intérêt public, les travailleurs et les employeurs. Le recours administratif contre les pratiques de travail déloyales commence par une demande de secours auprès de cette commission. La procédure suit généralement les étapes suivantes :
- Dépôt de la demande : Les travailleurs ou les syndicats soumettent une demande de secours à la Commission des Relations de Travail compétente de la préfecture, dans l’année suivant la date de l’acte de travail déloyal. Il n’y a pas de frais pour déposer une demande.
- Enquête : Une fois la demande acceptée, un examinateur de la Commission des Relations de Travail interroge les deux parties, organise les arguments et les preuves, et clarifie les points de litige. À ce stade, une résolution par conciliation est souvent tentée.
- Audition : Après l’organisation des points de litige lors de l’enquête, une audition est tenue dans un cadre similaire à une salle d’audience publique. Des interrogatoires des parties et des témoins sont menés, et la collecte de preuves pour établir les faits a lieu.
- Décision : À la fin de l’audition, après délibération par les membres représentant l’intérêt public, la Commission des Relations de Travail rend une décision. Si les allégations du demandeur sont reconnues et qu’un acte de travail déloyal est établi, une « ordonnance de secours » est émise. Si les allégations ne sont pas reconnues, une « ordonnance de rejet » est émise.
Le contenu de l’ordonnance de secours varie selon l’affaire, mais repose généralement sur le rétablissement de la situation antérieure à l’infraction, comme le retour à l’emploi après un licenciement abusif, la réintégration dans le poste d’origine et le paiement d’un montant équivalent au salaire pour la période de licenciement (back pay). En cas de refus de négociation collective, l’ordonnance peut exiger de participer de bonne foi aux négociations. Pour les cas d’ingérence, l’ordonnance peut interdire de futurs actes similaires et exiger l’affichage d’une lettre d’excuses dans l’entreprise (ordonnance de post-notice).
Les parties insatisfaites de l’ordonnance de la Commission des Relations de Travail peuvent demander une révision auprès de la Commission Centrale des Relations de Travail, un organisme national, ou intenter une action en justice pour annuler l’ordonnance.
Les recours privés par voie judiciaire au Japon
Indépendamment des procédures devant la commission du travail, les travailleurs et les syndicats peuvent également demander directement par le biais des tribunaux un recours pour leurs droits en droit privé. Les actes de travail injustes ne violent pas seulement les réglementations du droit public, comme la loi sur les syndicats, mais affectent également les relations juridiques en droit privé.
Premièrement, les actes juridiques constituant un travail injuste (par exemple, un licenciement fondé sur l’activité syndicale) sont généralement jugés invalides en vertu de l’article 90 du Code civil japonais, car ils vont à l’encontre de l’article 28 de la Constitution du Japon et des objectifs de la loi sur les syndicats, et sont considérés comme contraires à l’ordre public. Par conséquent, un travailleur licencié peut intenter une action en justice pour confirmer son statut contractuel de travail (la confirmation que son statut d’employé persiste) et pour le paiement des salaires pour la période pendant laquelle il n’a pas pu travailler.
De plus, les actes de travail injustes, en tant qu’atteintes illégales aux droits des travailleurs et des syndicats, peuvent constituer un délit civil en vertu de l’article 709 du Code civil japonais. Dans ce cas, les travailleurs ou les syndicats peuvent réclamer à l’employeur une indemnisation financière pour le préjudice moral subi en raison de l’acte de travail injuste, comme des dommages-intérêts pour souffrance morale. En effet, il y a eu des cas où les tribunaux ont ordonné des dommages-intérêts pour avoir refusé des négociations collectives.
Ainsi, les recours administratifs et judiciaires coexistent en tant que voies de recours indépendantes avec des objectifs et des procédures distincts.
Comparaison entre les recours administratifs et judiciaires sous le droit japonais
Face à des actes illicites en matière de travail, il existe des procédures de recours administratif par le biais de la Commission du travail et des recours judiciaires par les tribunaux, chacun présentant des différences significatives en termes d’objectifs, de procédures et d’effets. Le choix entre ces procédures, ou leur utilisation simultanée, représente une décision stratégique pour les employeurs et les employés.
Le recours administratif, c’est-à-dire la procédure d’examen par la Commission du travail, vise avant tout une « restauration rapide de l’ordre normal des relations collectives de travail ». De ce fait, la procédure est conçue pour être moins rigide et plus flexible que celle des tribunaux, permettant une progression plus rapide. La gratuité de la demande et l’implication de commissaires spécialistes des relations de travail favorisent la promotion d’un règlement amiable adapté à la réalité. Les ordonnances de redressement émises par la Commission du travail visent à corriger directement la situation lésée par des actions concrètes telles que la réintégration dans l’emploi d’origine ou l’ordre d’entamer des négociations collectives.
En revanche, le recours judiciaire, soit la procédure de litige devant les tribunaux, a pour principal objectif de fixer légalement les droits et obligations des parties et de compenser les dommages par des indemnisations financières. La procédure suit des règles juridiques strictes, avec des responsabilités claires en matière de revendications et de preuves. La résolution peut souvent prendre beaucoup de temps et les coûts, tels que les honoraires d’avocats, ont tendance à être élevés. Cependant, le jugement a une force de certitude légale et, en cas de dettes monétaires, une exécution forcée est possible, ce qui constitue un effet puissant.
Ces différences impliquent, du point de vue de l’employeur, des risques et des stratégies de réponse variés. Avec la Commission du travail, une résolution rapide est possible, mais il y a aussi un risque de recevoir des ordres difficiles à accepter pour l’entreprise, comme la publication d’un avis postérieur. Devant les tribunaux, une défense rigoureuse basée sur la logique juridique est possible, mais en cas de défaite, l’entreprise peut se voir ordonner de payer des dommages-intérêts élevés ou des arriérés de salaire, ce qui peut nuire considérablement à sa crédibilité économique et sociale.
Le tableau suivant compare les principales caractéristiques des deux systèmes.
| Caractéristiques | Recours administratif (Commission du travail) | Recours judiciaire (Tribunaux) |
| Objectif principal | Restauration rapide de l’ordre normal des relations de travail | Confirmation des droits et obligations légaux, indemnisation financière |
| Procédure | Enquête, audience (plus flexible que le procès) | Procédure judiciaire formelle (ou jugement du travail) |
| Rapidité | Généralement plus rapide que le procès | Peut être prolongé, souvent plus d’un an |
| Coûts | Aucun frais de dépôt de demande | Frais de dépôt de demande, honoraires d’avocats souvent élevés |
| Contenu du redressement | Ordres flexibles (réintégration, ordre d’entamer des négociations collectives, avis postérieur, etc.) | Jugement de nullité d’actes juridiques, ordres de paiement de dommages-intérêts et de salaires |
| Force exécutoire | Sanctions telles que des amendes en cas de non-exécution d’une ordonnance confirmée | Exécution forcée basée sur le jugement |
Résumé
Tel que détaillé dans cet article, le système de lutte contre les pratiques de travail déloyales est un dispositif fondamental du droit du travail au Japon, conçu pour matérialiser les droits fondamentaux des travailleurs garantis par la Constitution japonaise. L’article 7 de la Loi japonaise sur les syndicats de travailleurs interdit strictement certaines actions de l’employeur, telles que le traitement défavorable en raison de l’appartenance syndicale, le refus de négociations collectives sans motif valable, et l’ingérence dans les activités syndicales. En cas de violation de ces dispositions, une entreprise peut faire face à des risques juridiques significatifs, tels que des ordres de correction de la part de la commission du travail, des jugements d’invalidité d’actes juridiques par les tribunaux, et même des responsabilités pour dommages-intérêts. Ces risques peuvent avoir un impact direct sur la situation financière et la réputation sociale de l’entreprise, rendant essentielle la mise en place d’un système de conformité préventif.
Le cabinet d’avocats Monolith offre une expérience éprouvée dans le conseil sur des questions complexes de droit du travail, y compris les pratiques de travail déloyales, à une clientèle diversifiée au Japon. Notre cabinet compte plusieurs experts qui, en plus de détenir des qualifications d’avocats japonais, possèdent également des qualifications d’avocats étrangers et parlent anglais, leur permettant de comprendre profondément les défis uniques auxquels sont confrontées les entreprises qui se développent à l’international. Nous sommes en mesure de fournir un soutien juridique complet et stratégique, allant de la gestion appropriée des négociations collectives, la mise en place de règlements internes, l’évaluation des risques liés au travail, jusqu’à la représentation en cas de plaintes pour pratiques de travail déloyales.
Category: General Corporate