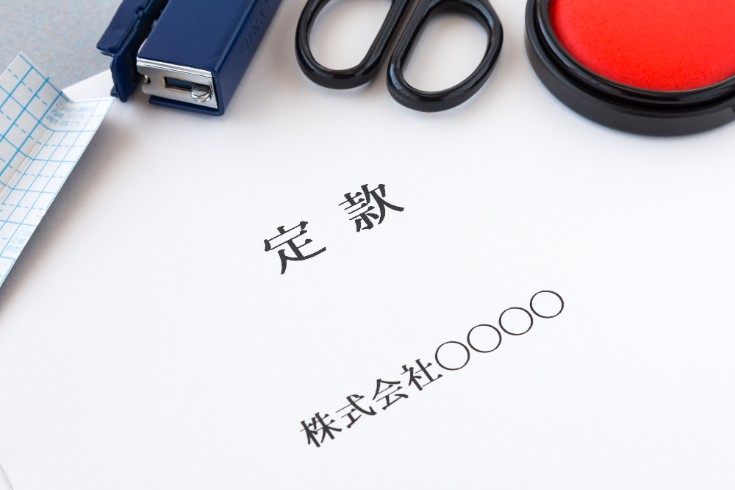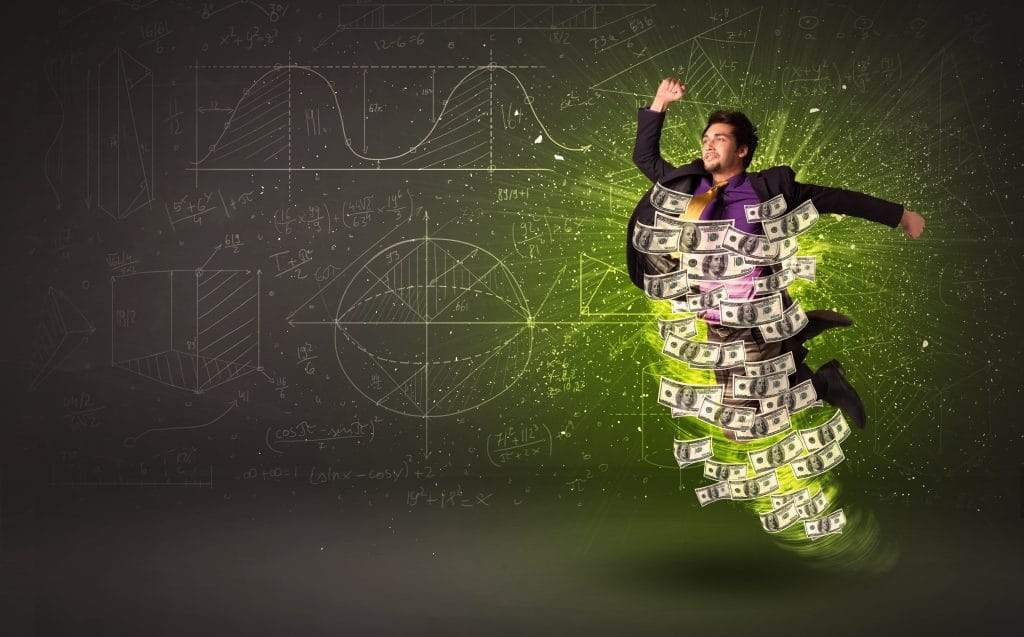Le droit d'auteur en tant qu'objet de transaction : de la cession des droits à l'exécution forcée

En vertu du système juridique japonais, le droit d’auteur ne se limite pas à la protection des activités créatives. Il constitue un actif immatériel essentiel au cœur des activités d’entreprise et représente un droit de propriété sujet à des transactions actives. La loi japonaise sur le droit d’auteur adopte le principe de l’« absence de formalités », selon lequel les droits naissent automatiquement dès la création de l’œuvre, sans aucune procédure requise. Ce principe, tout en contribuant à la promotion de la créativité, nécessite un cadre juridique précis pour clarifier les relations de droits et assurer la sécurité des transactions lorsque ces droits deviennent l’objet de transactions. Cet article explique en détail, sur la base de la législation et de la jurisprudence japonaises, les principaux aspects juridiques du droit d’auteur en tant qu’objet de transaction, notamment le transfert de droits (cession), l’octroi de licences, l’établissement de sûretés, la fiducie et l’exécution forcée, que les actionnaires, les dirigeants et les responsables juridiques des entreprises doivent comprendre. Ces mécanismes juridiques ne sont pas de simples concepts légaux, mais des outils pratiques pour la mise en œuvre de stratégies d’entreprise telles que le financement, les fusions et acquisitions, les partenariats commerciaux et la gestion des risques. Au fondement de la loi japonaise sur le droit d’auteur, il y a deux objectifs politiques importants : protéger les droits des auteurs pour « contribuer au développement de la culture » et faciliter la circulation fluide de ces droits pour soutenir le développement industriel. Comprendre cette structure binaire est essentiel pour maximiser la valeur du droit d’auteur en tant qu’actif et éviter les risques potentiels lors du déploiement d’activités sur le marché japonais.
Transfert de droits d’auteur (cession) sous le droit japonais
En tant que forme de propriété intellectuelle, il est possible de transférer (céder) tout ou partie des droits d’auteur par contrat. L’article 61, paragraphe 1, de la loi japonaise sur les droits d’auteur stipule clairement cette possibilité de transfert, constituant ainsi la base juridique d’un marché actif pour les droits d’auteur. La cession de droits d’auteur diffère fondamentalement de la vente d’un objet physique, comme une peinture. Même si la propriété physique d’une œuvre est transférée, les droits d’auteur qui y sont attachés ne sont pas automatiquement cédés. De même, cela se distingue d’une licence d’utilisation, où le détenteur des droits d’auteur permet à autrui d’utiliser l’œuvre tout en conservant ses droits.
Lors de la conclusion d’un contrat de cession de droits d’auteur, l’attention doit se porter principalement sur une disposition spéciale énoncée à l’article 61, paragraphe 2, de la loi japonaise sur les droits d’auteur. Cette disposition présume que, sauf mention explicite dans l’objet de la cession, les droits de créer des œuvres dérivées, tels que le droit de traduction et d’adaptation (conformément à l’article 27 de la loi japonaise sur les droits d’auteur), ainsi que les droits de l’auteur original sur l’utilisation des œuvres dérivées (conformément à l’article 28 de la même loi), restent réservés à la personne qui cède les droits (l’auteur original). Cela signifie qu’une formulation générale telle que “transfert de tous les droits d’auteur relatifs à l’œuvre en question” est juridiquement insuffisante pour transférer les droits énoncés aux articles 27 et 28. Pour acquérir ces droits importants de manière fiable, il est nécessaire de les énumérer individuellement et clairement dans le contrat. Cette disposition a une fonction protectrice, empêchant les créateurs de perdre involontairement des opportunités de revenus futures importantes, tout en représentant un point d’attention crucial pour les entreprises cherchant à acquérir des droits lors de la rédaction de contrats.
Un exemple célèbre de litige où l’interprétation de cette clause de “mention spéciale” a été contestée est l’affaire “Hikonyan” (décision de la Cour d’appel d’Osaka du 31 mars 2011 (Heisei 23)). Dans cette affaire, le créateur du populaire personnage de mascotte “Hikonyan” avait conclu un contrat avec la ville de Hikone pour transférer “tous les droits, y compris les droits d’auteur”. Cependant, les droits mentionnés aux articles 27 et 28 n’étaient pas spécifiquement énoncés dans le contrat. Plus tard, l’auteur a créé de nouvelles illustrations de poses similaires à Hikonyan et a revendiqué que les droits d’adaptation, entre autres, lui étaient réservés. Bien que reconnaissant l’absence de mention spéciale dans le contrat, le tribunal a pris en compte l’objectif du contrat d’utiliser le personnage pour une large promotion touristique, le montant de la contrepartie payée, et le déroulement des négociations entre les parties, et a déterminé qu’il y avait une intention commune de transférer tous les droits d’auteur, y compris ceux des articles 27 et 28. Ainsi, la “présomption” de l’article 61, paragraphe 2, a été renversée, et les droits de la ville ont été reconnus. Ce cas illustre l’approche des tribunaux japonais qui, au-delà du libellé des articles, accordent de l’importance au contenu substantiel de la transaction et à la véritable intention des parties. Cependant, il s’agit d’un exemple de recours juridique postérieur au litige, qui implique des risques de conflits coûteux en temps et en argent. Par conséquent, l’affaire Hikonyan ne doit pas être vue comme un raccourci facile, mais plutôt comme une leçon réaffirmant l’importance de la rédaction de contrats clairs.
L’octroi de licences d’auteur sous le droit japonais
L’octroi de licences d’auteur (licence) est l’acte par lequel le titulaire des droits d’auteur, tout en conservant les droits pour lui-même, autorise un tiers (le licencié) à utiliser l’œuvre dans les limites, la durée et la région définies par contrat. Cela trouve son fondement dans l’article 63, paragraphe 1, de la loi japonaise sur les droits d’auteur.
Il existe principalement deux formes de contrats de licence. La première est la “licence non exclusive”, qui permet au titulaire des droits d’auteur d’accorder des licences à plusieurs licenciés pour le même travail et de continuer à utiliser l’œuvre lui-même. Sauf disposition contraire du contrat, il est généralement entendu que c’est cette forme qui s’applique. L’autre forme est la “licence exclusive”, qui est un contrat où le titulaire des droits s’engage à ne pas accorder de licence à des tiers autres que le licencié spécifique. Selon le contenu du contrat, il peut également être possible d’interdire l’utilisation de l’œuvre par le titulaire des droits lui-même.
Pour comprendre la position juridique du licencié, il est extrêmement important de prendre en compte la réforme du droit d’auteur de 2020. Avant cette réforme, la licence n’était qu’un droit contractuel (créance) entre le titulaire des droits d’auteur et le licencié, et si le titulaire transférait ses droits d’auteur à un tiers, le nouveau titulaire des droits n’était généralement pas lié par le contrat de licence original. Cela représentait un risque commercial significatif pour le licencié, qui pouvait soudainement perdre son droit d’utilisation. Pour résoudre ce problème, la loi révisée sur les droits d’auteur, entrée en vigueur le 1er octobre 2020 (Reiwa 2), a introduit l’article 63-2. Cette disposition, connue sous le nom de “système d’opposition automatique”, permet à une licence valablement établie de revendiquer son efficacité contre un tiers qui a acquis les droits d’auteur par la suite, sans procédures spéciales telles que l’enregistrement. Cette réforme a considérablement renforcé la position du licencié et a augmenté la stabilité des transactions de licence, ayant une signification politique économique pour le développement du marché du contenu au Japon.
En outre, un exemple de jurisprudence illustrant la force des droits du licencié exclusif est l’affaire du “logiciel d’investissement” (jugement du Tribunal de district de Tokyo, 17 décembre 2020). Dans cette affaire, le tribunal a reconnu qu’un licencié exclusif pouvait directement réclamer des dommages-intérêts à un tiers enfreignant les droits d’auteur. Le jugement, tout en partant du principe que la licence est un droit contractuel, a décidé que l’acte d’infraction par un tiers constituait une violation illégale des bénéfices économiques que le licencié exclusif aurait dû obtenir de sa position exclusive. Cela a établi que le licencié exclusif n’est pas seulement une partie contractante, mais un acteur économique important qui peut demander un recours juridique direct contre une infraction.
Les sûretés sur les droits d’auteur sous le droit japonais
Les droits d’auteur, ayant une valeur patrimoniale, peuvent servir de collatéral pour garantir des dettes telles que des prêts. En cas de défaillance du débiteur, le créancier peut liquider les droits d’auteur mis en garantie et recouvrer sa créance à partir du produit de la vente. Au Japon, les sûretés sur les droits d’auteur prennent principalement la forme de « gages » et de « sûretés par cession », deux méthodes couramment utilisées.
Le gage est une sûreté fondée sur la loi japonaise sur les droits d’auteur et le code civil. Il est établi par un contrat de mise en gage entre les parties et prend effet contre les tiers une fois enregistré dans le registre des droits d’auteur de l’Agence pour les Affaires Culturelles. L’article 77, paragraphe 1, point 2 de la loi japonaise sur les droits d’auteur stipule que cet enregistrement est nécessaire pour opposer le gage à des tiers.
D’autre part, la sûreté par cession est une sûreté atypique établie par la jurisprudence japonaise, sans disposition explicite dans la loi. Avec cette méthode, le débiteur (titulaire des droits d’auteur) cède formellement les droits d’auteur au créancier à titre de garantie, et les droits sont restitués au débiteur une fois la dette intégralement remboursée. L’avantage majeur de la sûreté par cession réside dans sa flexibilité. En général, le débiteur peut continuer à exploiter l’œuvre protégée et à générer des revenus après avoir fourni la garantie. De plus, l’exécution de la sûreté en cas de défaillance peut se faire par des méthodes de vente privée convenues dans le contrat, plutôt que par des procédures judiciaires requises pour le gage, ce qui permet une liquidation plus rapide et moins coûteuse. Pour opposer la sûreté par cession à des tiers, il est nécessaire de procéder à un « enregistrement de transfert » plutôt qu’à un enregistrement de mise en gage.
Ces deux méthodes présentent des différences importantes en termes de nature juridique et de pratique opérationnelle, ce qui exige une compréhension de leurs caractéristiques pour choisir la méthode appropriée en fonction des objectifs de financement.
| Caractéristiques | Gage | Sûreté par cession |
| Base légale | Loi japonaise sur les droits d’auteur, Code civil | Jurisprudence japonaise |
| Utilisation par le débiteur | En principe, l’autorisation du créancier est nécessaire et l’utilisation est souvent restreinte. | En principe, l’utilisation est possible et la continuité des revenus d’entreprise est envisageable. |
| Méthode d’exécution | La vente aux enchères par le tribunal selon la loi sur l’exécution civile est la règle. | La vente privée par le créancier basée sur le contrat est possible, permettant une liquidation rapide. |
| Enregistrement | Enregistré en tant que « mise en gage ». | Enregistré en tant que « transfert », ce qui peut rendre difficile la publicité de la véritable intention de la transaction. |
| Taxe d’enregistrement | Variable selon le montant de la créance garantie (0,4% du montant de la créance). | Montant fixe par droit d’auteur (18 000 yens par cas). |
La fiducie de droits d’auteur sous le droit japonais
La fiducie de droits d’auteur est un cadre juridique conçu pour gérer et exploiter les droits d’auteur de manière plus flexible et efficace. Selon la loi japonaise sur la fiducie, l’auteur des droits, appelé « fiduciant », transfère légalement ses droits à un « fiduciaire » de confiance, qui gère et dispose de ces droits d’auteur pour le compte de certains « bénéficiaires », conformément aux objectifs définis dans le contrat de fiducie. Souvent, le fiduciant est également le bénéficiaire.
L’exemple le plus courant d’utilisation de la fiducie de droits d’auteur est la gestion centralisée par des organismes de gestion collective des droits, tels que la Société Japonaise des Droits des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs (JASRAC). Ces organisations reçoivent la fiducie des droits d’auteur de nombreux paroliers, compositeurs et maisons d’édition de musique (les fiduciants) et, en tant que fiduciaires, gèrent de manière centralisée l’octroi de licences et la collecte et la distribution des redevances à l’intérieur et à l’extérieur du Japon. Ce système permet une gestion étendue qui serait difficile à réaliser individuellement par les détenteurs de droits et est réglementé par la loi japonaise sur la gestion des droits d’auteur et droits voisins.
Une autre application avancée de la fiducie est la titrisation des actifs. Par exemple, une société de production cinématographique peut utiliser son portefeuille de droits d’auteur sur une bibliothèque de films comme actif de fiducie, et vendre les droits à recevoir les revenus de licence futurs (droits bénéficiaires de la fiducie) sous forme de titres aux investisseurs. Cela permet aux détenteurs de droits d’auteur de monétiser la valeur future de leurs revenus et de lever des fonds à grande échelle. La fiducie offre la possibilité de séparer la « propriété » juridique des droits d’auteur de leur « bénéfice » économique, fournissant ainsi la base pour de telles techniques financières avancées.
Pour qu’une fiducie impliquant le transfert de droits d’auteur ait une force juridique vis-à-vis des tiers, il est essentiel de l’enregistrer auprès de l’Agence pour les Affaires Culturelles comme un « enregistrement de fiducie ». L’article 77, paragraphe 1, point 1 de la loi japonaise sur les droits d’auteur stipule que cet enregistrement est une condition pour opposer la fiducie aux tiers.
L’exécution forcée des droits d’auteur sous le droit japonais
Lorsqu’un créancier détient un titre exécutoire tel qu’un jugement définitif ou un acte authentique contre un débiteur, mais que ce dernier ne s’acquitte pas de son paiement, le créancier peut saisir le tribunal et procéder à la saisie forcée des biens du débiteur pour recouvrer sa créance. Les droits d’auteur, en tant que droits de propriété incorporels, sont considérés comme des “autres droits de propriété” selon la loi japonaise sur l’exécution civile et peuvent donc faire l’objet d’une exécution forcée.
La procédure d’exécution forcée commence par une demande d’ordonnance de saisie déposée par le créancier auprès du tribunal de district compétent pour le lieu de résidence du débiteur. Si le tribunal accepte la demande, il émet une ordonnance de saisie à l’encontre du débiteur et la lui signifie. Cela interdit légalement au débiteur de disposer des droits d’auteur concernés, par exemple en les transférant, en accordant des licences ou en les utilisant comme garantie. Contrairement à la saisie de biens physiques, c’est cette interdiction légale de disposition qui préserve les droits. L’ordonnance de saisie peut également être signifiée à des tiers débiteurs, tels que des licenciés qui doivent des redevances, permettant ainsi au créancier de percevoir directement les redevances.
La liquidation (conversion en argent) des droits d’auteur saisis se fait principalement de la manière suivante :
- Ordre de transfert : le tribunal fixe une valeur estimée et ordonne le transfert direct des droits d’auteur saisis au créancier.
- Ordre de vente : le tribunal ordonne à un huissier de justice de vendre les droits d’auteur à un tiers, généralement par le biais d’une vente aux enchères.
- Recouvrement : si les revenus de redevances sont saisis, le créancier peut recevoir directement les paiements du licencié.
Ce système signifie que pour le créancier, le portefeuille de droits d’auteur détenu par le débiteur peut devenir un actif de recouvrement précieux. Pour le débiteur, en revanche, le risque de perdre des droits de propriété intellectuelle essentiels à son activité constitue une forte incitation à s’acquitter de ses dettes. Ainsi, les droits d’auteur détenus par une entreprise sont à la fois un actif commercial et un élément constitutif du profil de risque de crédit de cette entreprise.
Le système d’enregistrement des droits d’auteur pour sécuriser les transactions au Japon
Comprendre l’objectif fondamental du système d’enregistrement des droits d’auteur au Japon est essentiel pour toute personne impliquée dans les transactions de droits d’auteur. Contrairement aux brevets ou aux marques de commerce, les droits d’auteur ne naissent pas de l’enregistrement. Les droits sont automatiquement établis au moment de la création. Alors, pourquoi existe-t-il un système d’enregistrement ? C’est pour rendre publics les faits juridiques relatifs aux droits d’auteur et les changements de propriété (fonction de publicité) et pour assurer la « sécurité des transactions » lorsque les droits sont transférés.
L’effet juridique le plus puissant de l’enregistrement est la satisfaction de la « condition d’opposabilité aux tiers ». L’article 77 de la loi japonaise sur les droits d’auteur stipule que les changements importants de droits, tels que le transfert des droits d’auteur, les modifications par fiducie ou la création d’un droit de gage sur les droits d’auteur, ne peuvent être opposés à des tiers que s’ils sont enregistrés. Par exemple, si une entreprise (A) vend des droits d’auteur à une autre entreprise (B) et vend ensuite illégalement les mêmes droits d’auteur à une troisième entreprise (C) (double transfert), B peut légalement affirmer qu’elle est la véritable titulaire des droits si elle a rapidement enregistré le transfert. Si ni B ni C n’ont enregistré le transfert, la relation de droits reste incertaine. Ainsi, le système d’enregistrement fonctionne comme une infrastructure essentielle sur le marché des droits d’auteur, clarifiant l’attribution des droits et prévenant les conflits avec les prétendants ultérieurs et autres tiers.
Outre l’enregistrement qui confère la condition d’opposabilité aux tiers, la loi japonaise sur les droits d’auteur établit plusieurs autres systèmes d’enregistrement pour des objectifs spécifiques.
- Enregistrement du vrai nom (Article 75) : un système permettant à l’auteur d’enregistrer son vrai nom pour les œuvres publiées anonymement ou sous un pseudonyme. Cela a pour effet d’étendre la période de protection des droits d’auteur de « 70 ans après la publication » à la règle générale de « 70 ans après la mort de l’auteur ».
- Enregistrement de la date de la première publication (Article 76) : un système pour enregistrer la date à laquelle une œuvre a été publiée ou diffusée pour la première fois. Cela permet de présumer légalement que la première publication a eu lieu à la date enregistrée.
- Enregistrement de la date de création (Article 76-2) : un système qui permet uniquement pour les œuvres de programmes informatiques d’enregistrer la date de leur création. Cela permet de présumer que la création a eu lieu à la date enregistrée.
En conclusion, le système de droits d’auteur au Japon adopte une approche non formelle qui ne nécessite aucune procédure au stade de la « naissance » des droits, tandis qu’au stade de la « transaction » des droits, il assure la sécurité des transactions et la stabilité juridique à travers une procédure formelle d’enregistrement. Comprendre cette structure est fondamental et représente la connaissance la plus importante pour toutes les entreprises engagées dans des activités liées aux droits d’auteur au Japon.
Résumé
Tel que détaillé dans cet article, le droit d’auteur sous le système juridique japonais représente un droit protégé qui est également une ressource économique dynamique, susceptible de transfert, de licence d’utilisation, de mise en garantie, de fiducie et même d’exécution forcée. Le cadre juridique régissant ces transactions est conçu avec précision et son utilisation appropriée est directement liée à l’augmentation de la valeur de l’entreprise. En particulier, les exigences de la “mention spéciale” de l’article 61, paragraphe 2, lors du transfert des droits d’auteur, et la fonction du système d’enregistrement en tant que “condition d’opposabilité aux tiers” dans divers changements de droits, nécessitent une attention minutieuse dans la pratique contractuelle et la gestion des droits. Respecter ces exigences légales et les utiliser stratégiquement est la clé pour maximiser la valeur des droits d’auteur en tant qu’actifs incorporels et, en même temps, gérer efficacement les risques juridiques.
Le cabinet d’avocats Monolith possède une vaste expérience dans la fourniture de services juridiques relatifs aux droits d’auteur en tant qu’objets de transaction, le thème traité dans cet article, pour une clientèle diversifiée au Japon. Notre cabinet compte non seulement des avocats spécialisés dans le droit de la propriété intellectuelle japonaise, mais aussi plusieurs anglophones qualifiés en droit étranger, permettant une communication fluide et une compréhension approfondie du contexte des affaires internationales, ainsi qu’un soutien juridique précis. Si vous avez besoin d’une assistance spécialisée pour l’utilisation stratégique des droits d’auteur, les contrats associés ou la résolution de conflits, n’hésitez pas à consulter notre cabinet.
Category: General Corporate