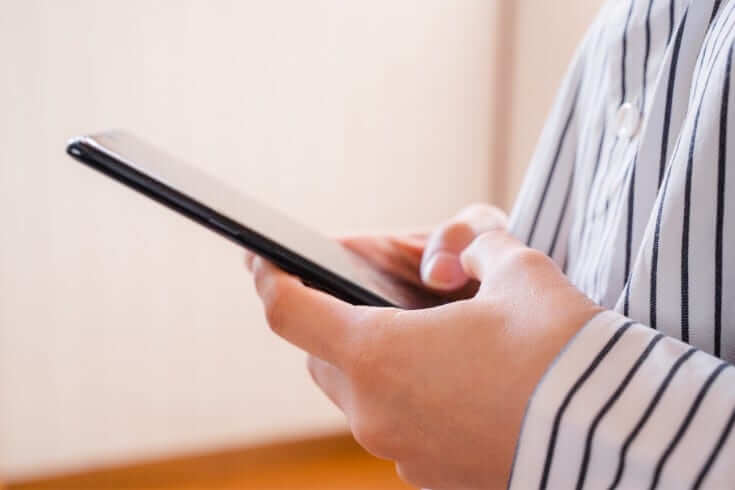La fin des contrats de travail à durée déterminée dans le droit du travail japonais : Explication de la théorie juridique du "Yamome" (cessation d'emploi)

Le contrat de travail à durée déterminée est une forme d’emploi essentielle qui permet aux entreprises une gestion flexible du personnel, que ce soit pour répondre à des projets spécifiques, à des besoins saisonniers, ou pour établir une période d’essai. La nature de ce contrat, qui se termine automatiquement à l’expiration de la période convenue, peut sembler à première vue un système clair et facile à gérer pour l’employeur. Cependant, sous le régime juridique du travail au Japon, cette “fin de contrat due à l’expiration de la période” n’est pas toujours automatiquement et inconditionnellement acceptée. En particulier, si le contrat a été renouvelé à plusieurs reprises ou si le travailleur a des raisons valables de s’attendre à un renouvellement, le refus unilatéral de renouvellement par l’employeur, connu sous le nom de “rupture de contrat”, peut être jugé légalement invalide. Cette doctrine juridique est connue sous le nom de “théorie de la rupture de contrat” et s’est formée au fil des ans grâce à l’accumulation de jurisprudence, et est maintenant explicitement codifiée dans la loi japonaise sur les contrats de travail.
L’existence de cette doctrine indique un risque juridique significatif que les entreprises doivent reconnaître lors de la gestion des contrats de travail à durée déterminée. Le simple fait que la durée soit clairement indiquée dans le contrat ne suffit pas toujours à justifier la fin de l’emploi. Les tribunaux privilégient les aspects substantiels tels que la réalité de l’application du contrat, les actions et déclarations des parties, et la nature du travail, plutôt que la forme du contrat, pour juger de la validité de la rupture de contrat. Par conséquent, il est essentiel que les dirigeants d’entreprise et les responsables juridiques comprennent précisément le contenu de cette théorie de la rupture de contrat, en particulier dans quels cas l'”attente de renouvellement” du travailleur est légalement protégée, et, si la rupture de contrat est limitée, quelles raisons sont nécessaires pour la mener à bien de manière valide. Cet article explique de manière exhaustive la théorie de la rupture de contrat, en se basant sur l’article 19 de la loi japonaise sur les contrats de travail, les critères de jugement issus de jurisprudences importantes, ainsi que les mesures de gestion des risques pratiques que les entreprises devraient adopter.
Principes fondamentaux des contrats de travail à durée déterminée et de la cessation d’emploi au Japon
En droit du travail japonais, les contrats de travail sont généralement classés en deux catégories : les contrats à durée déterminée et les contrats à durée indéterminée. Comme leur nom l’indique, les contrats à durée déterminée prennent fin automatiquement à l’expiration de la période convenue, sans qu’une manifestation de volonté particulière des parties ne soit nécessaire. L’acte par lequel l’employeur refuse de renouveler le contrat à l’expiration de cette période est appelé “cessation d’emploi” .
Cependant, il existe d’importantes exceptions à ce principe. Le système juridique du travail au Japon valorise la stabilité de l’emploi comme un principe fondamental, et cette protection s’étend également aux travailleurs sous contrat à durée déterminée. La liberté de l’employeur de mettre fin à l’emploi n’est pas absolue et peut être considérablement restreinte dans certaines circonstances. Au cœur de ces restrictions se trouve la “théorie de la cessation d’emploi”, qui a été établie par la jurisprudence et plus tard inscrite explicitement dans la loi japonaise sur les contrats de travail. Cette théorie vise à protéger les travailleurs employés dans des conditions pratiquement identiques à celles d’un contrat à durée indéterminée, ainsi que ceux qui ont des raisons légitimes de s’attendre à ce que leur contrat soit renouvelé, contre une cessation d’emploi arbitraire de la part de l’employeur. La loi centrale qui établit cette réglementation est la loi japonaise sur les contrats de travail, et en particulier son article 19, qui définit les règles spécifiques concernant la validité de la cessation d’emploi .
La codification de la théorie du refus de renouvellement de contrat de travail : Article 19 de la Loi japonaise sur les contrats de travail
La réforme législative de 2012 a codifié la théorie du refus de renouvellement de contrat de travail, qui était auparavant établie par la jurisprudence de la Cour suprême, en tant qu’article 19 de la Loi japonaise sur les contrats de travail. Cette codification n’a pas créé de nouvelles règles mais a plutôt clarifié le statut des principes et de la portée de la jurisprudence existante en les inscrivant dans le texte de la loi.
L’article 19 de la Loi japonaise sur les contrats de travail stipule que le refus de renouvellement de contrat par l’employeur est invalide si certaines conditions sont remplies. Plus précisément, le refus de renouvellement ne peut se faire, sauf si l’employeur a une raison objectivement raisonnable et socialement acceptable, dans l’un des deux cas suivants et que le travailleur a demandé le renouvellement du contrat :
Premièrement, dans le cas d’un contrat de travail à durée déterminée qui a été renouvelé à plusieurs reprises et dont le refus de renouvellement peut être considéré, selon les normes sociales, comme équivalent au licenciement d’un travailleur sous contrat à durée indéterminée (alinéa 1 de l’article). Cela concerne les situations où le renouvellement du contrat a été répété de nombreuses fois, au point que la relation de travail est devenue, en substance, indifférenciable d’un contrat sans durée déterminée. Cette disposition codifie directement la théorie établie dans le jugement de l’affaire de l’usine Toshiba Yanashiro.
Deuxièmement, dans le cas où il est reconnu que le travailleur a une raison valable de s’attendre au renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée à l’expiration de la période contractuelle (alinéa 2 de l’article). Cela couvre une gamme plus large de situations où, même sans renouvellements répétés à long terme comme dans le premier cas, il est raisonnable pour le travailleur de s’attendre à la continuation de l’emploi en raison de la nature du travail ou des actions et déclarations de l’employeur. L’existence de cet alinéa 2 élargit considérablement la portée de la théorie du refus de renouvellement, exigeant des employeurs une approche plus prudente.
Il est à noter que, comme condition préalable à l’application de ces dispositions, le travailleur doit demander le renouvellement ou la conclusion d’un nouveau contrat avant l’expiration du contrat ou immédiatement après sans délai. Cependant, cette “demande” n’a pas nécessairement besoin d’être formelle et écrite. Il suffit que le travailleur communique à l’employeur son opposition au refus de renouvellement sous une forme quelconque, par exemple, en intentant une action en justice ou en exprimant une objection oralement. Étant donné que le seuil pour cette exigence procédurale est très bas, il est généralement difficile pour l’employeur de justifier la légitimité d’un refus de renouvellement en arguant que “le travailleur n’a pas formellement demandé le renouvellement”.
Attentes raisonnables de renouvellement : Quand les “attentes” sont-elles légalement protégées sous le droit japonais ?
L’article 19, alinéa 2 de la loi japonaise sur les contrats de travail (Japanese Labor Contract Act) stipule s’il est raisonnable de s’attendre à un renouvellement du contrat. Cette question est l’un des points de litige les plus importants en matière de cessation d’emploi. La décision ne repose pas sur un seul facteur, mais prend en compte diverses circonstances liées à l’emploi et est prise au cas par cas. Les éléments de jugement particulièrement pris en compte par les tribunaux sont les suivants :
- Le contenu objectif des tâches : Il est pris en compte si le travail est de nature permanente ou temporaire. Si l’employé est engagé dans des tâches essentielles et permanentes de l’entreprise, et que le contenu de son travail ne diffère pas de celui d’un employé permanent, l’attente de renouvellement a tendance à se renforcer.
- Le nombre de renouvellements de contrat et la durée totale de l’emploi : Plus le nombre de renouvellements est élevé et plus la durée totale de l’emploi est longue, plus la continuité de l’emploi est présumée et plus l’attente de renouvellement de l’employé se solidifie.
- La gestion de la durée du contrat : La rigueur avec laquelle les procédures de renouvellement de contrat sont effectuées est questionnée. Par exemple, si à chaque renouvellement, un entretien est mené et que la décision de renouveler ou non est prise avec soin sur la base d’une évaluation, l’attente de l’employé diminue. À l’inverse, si les contrats sont renouvelés automatiquement sans procédure particulière, l’attente se renforce.
- Le comportement de l’employeur : Si, lors de l’entretien d’embauche ou pendant la durée du contrat, des supérieurs ou des responsables des ressources humaines ont tenu des propos suggérant un emploi à long terme (par exemple : “On compte sur toi pour l’année prochaine”, “Si tu travailles sérieusement, tu pourras rester longtemps”), cela constitue un argument important pour protéger l’attente de l’employé.
- La situation des autres employés : Si d’autres employés à durée déterminée dans une position similaire ont été renouvelés dans la plupart des cas sans être licenciés, il est plus facile de juger que l’employé concerné a la même attente.
Lors de l’évaluation de ces éléments, ce qui importe n’est pas la forme mais la substance. Par exemple, même si l’employeur a procédé à des renouvellements de manière formelle et rigoureuse, si la réalité est que l’employé a été engagé pendant de nombreuses années dans des tâches essentielles, on ne peut pas nier l’attente raisonnable de renouvellement sur la seule base de la formalité de la procédure. Les procédures ne deviennent une mesure de gestion des risques efficace que lorsqu’elles reflètent précisément la nature temporaire de l’emploi. Par conséquent, la gestion des risques la plus efficace ne se limite pas à la mise en place de contrats et de procédures, mais consiste à s’assurer que le rôle et le contenu du travail des employés à durée déterminée correspondent réellement à leur statut juridique de “temporaire”.
Le tableau suivant résume ces éléments de jugement :
| Élément de jugement | Circonstances renforçant l’attente de renouvellement | Circonstances affaiblissant l’attente de renouvellement |
| Contenu des tâches | Tâches permanentes et essentielles | Tâches temporaires et occasionnelles |
| Nombre de renouvellements et durée totale | Nombreux renouvellements, longue période d’emploi | Premier contrat ou peu de renouvellements, courte période d’emploi |
| Procédures de renouvellement | Procédures formelles et automatiques | Procédures de renouvellement substantielles basées sur une évaluation rigoureuse |
| Comportement de l’employeur | Comportement suggérant un emploi continu | Communication claire sur la possibilité de fin de contrat |
| Situation des autres employés | Renouvellement uniforme des employés de même statut | Précédents de licenciement parmi les employés de même statut |
Apprendre des précédents judiciaires sur l’attente de renouvellement : l’affaire de l’usine Toshiba Yanagicho et l’affaire Hitachi Medico sous le droit japonais
Deux types de raisonnements juridiques concernant la fin de l’emploi ont été établis par deux décisions emblématiques de la Cour suprême du Japon. Comprendre ces décisions est essentiel pour saisir la portée de ces principes juridiques.
L’affaire de l’usine Toshiba Yanagicho (décision de la Cour suprême du Japon du 22 juillet 1974 (Showa 49)) concerne des ouvriers temporaires employés pour des périodes de deux mois, dont les contrats ont été renouvelés entre 5 et 23 fois, avant qu’ils ne soient finalement licenciés. Ces ouvriers participaient aux opérations essentielles de l’usine et leurs tâches étaient indifférenciables de celles des employés permanents. La Cour suprême a jugé que, compte tenu de la réalité de ces renouvellements répétés, les contrats de travail en question étaient « dans un état qui ne diffère pas substantiellement d’un contrat à durée indéterminée ». Par conséquent, la fin de l’emploi pour ces contrats devrait être évaluée de la même manière que le licenciement d’un travailleur à durée indéterminée, et le principe de l’abus de droit de licenciement devrait être appliqué par analogie. En d’autres termes, la fin de l’emploi exige des raisons objectivement rationnelles et une équité sociale. Cette décision a établi le type de « contrat substantiellement à durée indéterminée », qui est à la base de l’article 19, paragraphe 1 du Code du travail japonais actuel.
L’affaire Hitachi Medico (décision de la Cour suprême du Japon du 4 décembre 1986 (Showa 61)) concerne un ouvrier temporaire dont le contrat de deux mois a été renouvelé cinq fois, avant d’être licencié en raison de difficultés financières de l’entreprise entraînant une réduction du personnel. La Cour suprême a jugé que la relation d’emploi dans cette affaire ne pouvait pas être considérée comme équivalente à un contrat à durée indéterminée, contrairement à l’affaire de l’usine Toshiba Yanagicho. Cependant, la Cour ne s’est pas arrêtée là. Elle a indiqué que même si la relation d’emploi ne pouvait pas être considérée comme équivalente à un contrat à durée indéterminée, si le travailleur avait une attente raisonnable de renouvellement du contrat en raison de la réalité des renouvellements répétés, cette attente devrait être légalement protégée, et la fin de l’emploi qui trahit cette attente pourrait être invalide en tant qu’abus de droit, sauf circonstances exceptionnelles. Cela a établi le type de « protection de l’attente de renouvellement », qui est à la base de l’article 19, paragraphe 2 du Code du travail japonais. Dans cette affaire, la nécessité de réduire le personnel en raison de difficultés financières était claire, donc la fin de l’emploi a été jugée valide, mais l’importance juridique de cette décision est très significative. De plus, cette décision suggère qu’il existe une différence rationnelle entre les employés permanents et les travailleurs à contrat à durée déterminée lors de la restructuration du personnel, fournissant ainsi une base pour reconnaître une certaine rationalité dans le choix de cibler en premier les travailleurs à contrat à durée déterminée pour les réductions de personnel.
La comparaison de ces deux décisions est présentée dans le tableau ci-dessous.
| Éléments de comparaison | Affaire de l’usine Toshiba Yanagicho | Affaire Hitachi Medico |
| Substance du contrat | Considéré substantiellement comme un contrat à durée indéterminée | Non considéré comme un contrat à durée indéterminée, mais l’attente de renouvellement existe |
| Principe juridique établi | Type de « contrat substantiellement à durée indéterminée » | Type de « protection de l’attente de renouvellement » |
| Article de référence | Code du travail, article 19, paragraphe 1 | Code du travail, article 19, paragraphe 2 |
| Conclusion du tribunal | Fin de l’emploi invalide | Fin de l’emploi valide (en raison de la nécessité de gestion) |
L’efficacité du licenciement : rationalité objective et adéquation sociale sous le droit du travail japonais
Lorsque les tribunaux jugent qu’une situation correspond aux dispositions du numéro 1 ou 2 de l’article 19 de la Loi japonaise sur les contrats de travail, c’est-à-dire que la relation de travail est considérée comme équivalente à un contrat à durée indéterminée ou qu’il est reconnu que le travailleur a une attente raisonnable de renouvellement, le licenciement n’est pas immédiatement invalidé. À ce stade, l’accent est mis sur la question de savoir s’il existe une raison valable pour le licenciement. L’employeur a la charge de la preuve et doit démontrer que le licenciement repose sur des « raisons objectivement raisonnables » et est « socialement adéquat », selon les termes exacts de l’article 16 de la Loi japonaise sur les contrats de travail, qui régit le licenciement des employés à durée indéterminée (théorie de l’abus de droit de licenciement), et qui est extrêmement strict.
Alors, quelles raisons peuvent être considérées comme « objectivement raisonnables » et « socialement adéquates » ? Les deux principales sont les suivantes :
Premièrement, l’insuffisance de capacité ou l’attitude de travail inappropriée du travailleur. Cependant, le simple mécontentement subjectif de l’employeur n’est pas suffisant comme raison. Il est nécessaire d’argumenter et de prouver de manière concrète, sur la base de preuves objectives (dossiers d’évaluation du personnel, dossiers de supervision, dossiers de sanctions disciplinaires, etc.), des problèmes tels que de mauvaises performances au travail, des violations graves de la discipline ou des manquements aux ordres de service. De plus, les tribunaux examinent rigoureusement si l’employeur a fourni une orientation adéquate et des opportunités d’amélioration au travailleur.
Deuxièmement, la nécessité pour des raisons de gestion, communément appelée licenciement pour motif économique. Lorsque des licenciements sont effectués pour réduire les effectifs en raison de difficultés financières, il est essentiel que cette nécessité existe réellement. Dans la pratique judiciaire, l’efficacité d’un licenciement pour motif économique est généralement jugée de manière stricte en prenant en compte de manière globale quatre éléments : la nécessité de réduire les effectifs, les efforts pour éviter le licenciement, la rationalité de la sélection des personnes à licencier et l’adéquation de la procédure. Pour les licenciements de travailleurs sous contrat à durée déterminée, une évaluation rigoureuse similaire est tendance à être appliquée. Comme l’a montré l’affaire Hitachi Medico, il peut être raisonnable de procéder d’abord au licenciement de travailleurs sous contrat à durée déterminée pour éviter le licenciement de salariés permanents, mais cela repose toujours sur la présence d’une nécessité de gestion objective.
Cette structure juridique contient des implications importantes pour les employeurs. Une fois qu’une attente raisonnable de renouvellement est établie pour le travailleur, le seuil pour un licenciement ultérieur devient presque aussi élevé que pour le licenciement d’un employé permanent. Par conséquent, du point de vue de la gestion des risques juridiques, il est extrêmement important de prendre des mesures préventives dès les premiers stades du conflit, c’est-à-dire pour éviter de créer une « attente raisonnable ».
Réponses pratiques et gestion des risques pour les entreprises sous le droit japonais
Afin de gérer adéquatement les risques associés à la fin de contrats de travail à durée déterminée et de prévenir les conflits, il est recommandé aux entreprises d’appliquer les mesures pratiques suivantes.
- Clarification dans le contrat de travail Il est essentiel que le contrat de travail spécifie non seulement la durée du contrat, mais aussi clairement s’il y a possibilité de renouvellement ou non. Si un renouvellement est envisageable, il convient d’indiquer des critères concrets tels que “La décision de renouveler le contrat sera basée sur le volume de travail à l’expiration du contrat, la performance et les compétences de l’employé, ainsi que la situation financière de l’entreprise”. Si le non-renouvellement est déjà décidé, envisager l’ajout d’une clause de non-renouvellement peut être judicieux. Cependant, même en présence d’une telle clause, si les pratiques ultérieures contredisent son contenu (par exemple, si des comportements laissent espérer un renouvellement), il existe un risque que l’efficacité de la clause soit niée.
- Gestion rigoureuse de la durée d’emploi Il est indispensable de mettre en place un système pour saisir et gérer avec précision la date d’expiration du contrat de tous les travailleurs à durée déterminée. Selon les normes du Ministère de la Santé, du Travail et des Affaires Sociales, si un employé a été renouvelé plus de trois fois ou a travaillé pendant plus d’un an, l’employeur doit notifier la fin du contrat au moins 30 jours avant l’expiration du contrat. Bien que cette notification soit une obligation légale, il est important de noter que le simple fait de notifier ne constitue pas en soi une base pour la validité de la fin du contrat.
- Éviter les comportements qui laissent espérer un renouvellement Il est crucial de fournir une formation approfondie aux gestionnaires et au personnel des ressources humaines sur les principes juridiques de la fin de contrat, et de les instruire pour éviter de promettre légèrement un emploi à long terme ou de laisser espérer un renouvellement. Il est nécessaire de reconnaître que les communications quotidiennes peuvent devenir des preuves involontaires dans les litiges ultérieurs.
- Mise en œuvre de procédures de renouvellement substantielles Si le contrat mentionne la possibilité d’un renouvellement, les procédures de renouvellement ne doivent pas être purement formelles. À l’approche de l’expiration du contrat, il est essentiel d’évaluer réellement la nécessité du travail et la performance de l’employé, et de baser la décision de renouveler ou non sur ces résultats, tout en documentant ce processus.
- Documentation exhaustive Documenter tous les processus par écrit est la défense la plus solide en cas de litige. Il est extrêmement important de préparer des preuves objectives telles que les évaluations du personnel, les enregistrements des directives d’amélioration des tâches, les procès-verbaux des entretiens et les notifications précisant clairement les raisons de la fin du contrat.
Résumé
La gestion des contrats de travail à durée déterminée sous le droit du travail japonais ne se limite pas à la simple formalisation des termes du contrat ; elle exige une gestion approfondie de la réalité des relations d’emploi, un domaine qui requiert une gestion des risques avancée. L’article 19 de la Loi japonaise sur les contrats de travail impose des restrictions significatives au droit de l’employeur de mettre fin unilatéralement à l’emploi à l’expiration du contrat. En particulier, si la nature du travail, le nombre de renouvellements et le comportement des cadres créent chez le travailleur une « attente raisonnable de renouvellement », alors la fin de l’emploi ne sera pas considérée comme valide sans des raisons objectives et raisonnables ainsi qu’une proportionnalité sociale, tout comme pour le licenciement d’un travailleur sous contrat à durée indéterminée. Ce seuil légal est très élevé et peut représenter un risque de gestion significatif pour les entreprises.
Le cabinet d’avocats Monolith comprend profondément ces subtilités du droit du travail japonais et a une solide expérience dans le soutien d’une clientèle internationale. Notre cabinet compte plusieurs avocats qualifiés à l’étranger et de langue maternelle anglaise, capables de fournir des conseils clairs et pratiques qui font le pont entre différents systèmes juridiques et cultures d’affaires. Nous offrons une gamme complète de services juridiques pour assurer que les pratiques d’emploi de nos clients soient robustes sous le système juridique japonais, allant de la création de contrats de travail conformes à la loi applicable, à la formation des cadres, et jusqu’à la négociation en cas de conflits du travail. Pour un soutien spécialisé visant à renforcer votre stratégie de gestion des ressources humaines au Japon, n’hésitez pas à consulter notre cabinet.
Category: General Corporate