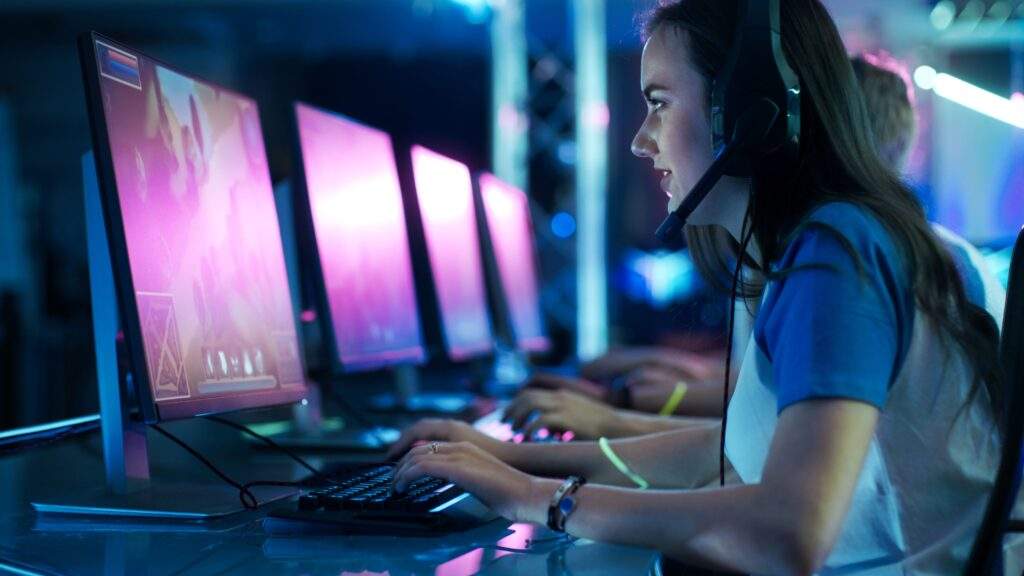Traitement juridique des actes accomplis au nom d'une société en formation par les fondateurs selon le droit des sociétés japonais

La création d’une entreprise ne se résume pas à une simple succession de démarches administratives. D’un point de vue juridique, de la rédaction des statuts jusqu’à l’achèvement de l’enregistrement de la société, l’organisation est traitée comme une « société en formation » en droit japonais. Cette phase constitue une période cruciale pour établir les fondations des activités commerciales futures, mais elle est également juridiquement très ambiguë et comporte de nombreux risques. Une société en formation ne possède pas encore une personnalité juridique complète. Cependant, il est nécessaire de réaliser divers actes contractuels pour la future entreprise, tels que la location de bureaux ou l’embauche d’employés. Une question fondamentale se pose alors : les actes accomplis au nom de la société en formation par les promoteurs sont-ils légalement attribués à la société une fois constituée ? Et qui assumera finalement la responsabilité des obligations découlant de ces actes ? Par exemple, si un contrat de leasing coûteux conclu avant la création est jugé inadapté au plan d’affaires de la société après sa constitution, peut-on annuler ce contrat ou est-ce que les promoteurs doivent en assumer la responsabilité individuellement ?
Cet article se concentre sur le statut juridique complexe de la « société en formation » selon le droit des sociétés au Japon et les cas de jurisprudence associés. Nous expliquerons en détail la portée des actes qu’une société en formation peut réaliser et comment leurs effets juridiques sont traités. De plus, nous examinerons les responsabilités légales des promoteurs et des parties concernées en cas de succès ou d’échec de la création de la société. Cela inclut les responsabilités envers la société elle-même, les tiers avec lesquels des transactions ont été effectuées, et les « pseudo-promoteurs » qui, sans être promoteurs, ont été profondément impliqués dans la création de la société. Comprendre ces problématiques est essentiel pour faciliter le processus de création d’entreprise et prévenir les litiges juridiques futurs.
La création d’une entreprise et ses actions en droit japonais
Dans le processus de création d’une entreprise, dès que les fondateurs établissent les statuts et commencent à agir vers l’objectif commun de la création de l’entreprise, l’organisation est appelée “entreprise en formation” jusqu’à ce que l’enregistrement de sa création lui confère une existence légale. Avant cet enregistrement, l’entreprise en formation ne possède pas encore la personnalité juridique selon le droit des sociétés au Japon et sa nature juridique est interprétée comme similaire à celle d’une “association sans capacité juridique”. Une telle association est dotée d’une organisation en tant que groupe, fonctionne sur le principe de la majorité, continue d’exister indépendamment des changements de ses membres, et a des méthodes de représentation, la gestion des assemblées générales, la gestion des biens et d’autres points essentiels à l’organisation clairement établis.
En tant qu’organe de l’entreprise en formation, les fondateurs agissent en tant que représentants nécessaires à la création de l’entreprise, dans la mesure requise. La question de savoir si les effets juridiques des actions menées par les fondateurs seront attribués à l’entreprise après sa création dépend de la nature de ces actions. Plus précisément, il est question de savoir si ces actions entrent dans le cadre des objectifs de l’entreprise en formation. Les actions menées par l’entreprise en formation peuvent être largement classées en deux catégories : les actions “essentielles à la création même de l’entreprise” et les actions “relatives à la préparation des activités de l’entreprise”, cette dernière catégorie étant elle-même divisée en “actions préparatoires à l’ouverture” et en “actions commerciales”. En outre, il existe également des actions appelées “acceptation de biens”, spécifiquement réglementées par le droit des sociétés au Japon.
Les actes essentiels à la constitution même d’une société
Pour atteindre l’objectif de constituer une société, il existe des actes considérés comme essentiels, tant sur le plan légal que factuel. Ces actes incluent la rédaction des statuts, le contrat par lequel les fondateurs souscrivent aux actions, le recrutement de souscripteurs pour les actions émises lors de la création, ainsi que la tenue de l’assemblée générale constitutive. Ces actes sont directement alignés avec l’objectif de la société en formation. Par conséquent, les droits et obligations qui découlent de ces actes appartiennent naturellement à la société une fois constituée. Par exemple, les frais de notaire payés par les fondateurs pour l’authentification des statuts ou les coûts publicitaires engagés pour recruter des souscripteurs d’actions peuvent être pris en charge par la société après sa formation. Il est rare que des litiges juridiques surviennent concernant l’attribution à la société des effets de ces actes.
Les actes préparatoires à la création d’entreprise au Japon
Ensuite, il existe des actes préparatoires, dits de préparation à l’ouverture, qui sont nécessaires pour démarrer l’activité de l’entreprise de manière fluide après sa constitution. Ces actes sont distincts de ceux qui lancent l’activité elle-même (actes d’exploitation). Parmi les exemples concrets d’actes préparatoires, on peut citer la conclusion de contrats de location pour les locaux commerciaux, l’achat de matériel de bureau et d’équipements, ainsi que la conclusion de contrats de travail avec les employés.
La question de savoir si les effets juridiques de ces actes préparatoires sont attribués à la société après sa constitution ne se décide pas de manière uniforme. La jurisprudence indique que ces actes appartiennent à la société constituée uniquement s’ils sont « objectivement nécessaires en tant qu’actes préparatoires à l’ouverture » et qu’ils ont été effectués dans les limites des pouvoirs des fondateurs. Par exemple, dans un cas de jurisprudence (jugement du tribunal de district d’Ōita du 24 mars 1986 (1986)), il a été reconnu que le contrat de travail conclu par une société en formation avec un employé était essentiel au démarrage de l’activité de l’entreprise, et il a été décidé que la société, une fois constituée, hériterait de la position contractuelle.
Cependant, l’évaluation de cette nécessité est stricte. Par exemple, l’achat de biens immobiliers à un prix excessivement élevé par rapport à la taille de l’entreprise ou l’embauche d’un nombre inutilement important d’employés pour le démarrage de l’activité sont considérés comme des actes dépassant les pouvoirs des fondateurs et n’appartiennent généralement pas à la société une fois constituée. Dans ce cas, les fondateurs qui ont effectué ces actes assument personnellement la responsabilité.
L’activité commerciale avant la constitution d’une société au Japon
L’activité commerciale avant la constitution d’une société se réfère à l’initiation des opérations commerciales qu’une société est censée mener après sa création, mais qui sont commencées pendant sa phase de constitution. Par exemple, une entreprise manufacturière qui commence la production et la vente de produits ou une société de conseil qui conclut des contrats de conseil avec des clients et fournit des services avant même d’être officiellement établie.
Une société en cours de constitution ne possède pas encore la personnalité juridique et n’a pas la capacité d’agir en tant qu’entité commerciale. Par conséquent, les activités commerciales menées par une société en constitution sont généralement considérées comme des actes sans autorité, dépassant les pouvoirs des fondateurs, et ne sont pas attribuées à la société une fois constituée. Même si ces activités commerciales génèrent des bénéfices, les droits et obligations associés reviennent en principe aux fondateurs individuellement.
Cependant, il est possible pour la société, une fois constituée, de ratifier ces activités commerciales. La ratification est l’expression de la volonté d’attribuer à soi-même les effets d’un acte juridique qui, à l’origine, ne produirait pas d’effet. Si, après la constitution de la société, un organe compétent tel que le conseil d’administration décide de prendre en charge les effets de ces activités commerciales, elles peuvent exceptionnellement être attribuées à la société. Néanmoins, il s’agit d’une mesure exceptionnelle et le démarrage d’activités commerciales pendant la phase de constitution comporte des risques juridiques significatifs.
L’Acquisition de Biens Sous le Droit des Sociétés au Japon
Enfin, parmi les actes régis par des dispositions spéciales du droit des sociétés japonais, il y a l’« acquisition de biens ». Selon l’article 28, paragraphe 2 du droit des sociétés au Japon, l’acquisition de biens désigne « les biens et leur valeur que la société par actions a convenu d’acquérir après sa constitution, ainsi que le nom ou la dénomination du cédant ». Concrètement, il s’agit d’un contrat par lequel les fondateurs promettent, après la création de la société, d’acheter certains biens (par exemple, des biens immobiliers ou des équipements) à un prix déterminé avec le propriétaire de ces biens.
Cette acquisition de biens, bien qu’elle ressemble à des actes de préparation à l’ouverture, diffère considérablement dans son traitement juridique. L’acquisition de biens ne peut pas être librement décidée par la seule appréciation personnelle des fondateurs ; elle doit être inscrite dans les statuts pour être reconnue. Cela est appelé une disposition de constitution anormale dans les statuts. L’inscription dans les statuts a pour but de divulguer à l’avance aux autres actionnaires et créanciers les biens que la société va acquérir et le montant qu’elle va payer immédiatement après sa création, afin de prévenir la surévaluation des biens et la détérioration de l’actif de la société.
Si un contrat d’acquisition de biens est conclu sans être mentionné dans les statuts, ce contrat est en principe invalide. Même si le conseil d’administration de la société approuve ce contrat après la création de la société, il n’est pas possible de rendre valide un acte invalide. À cet égard, la décision de la Cour suprême du 24 décembre 1968 (1968) a clairement jugé que l’acquisition de biens non mentionnée dans les statuts est invalide et ne peut être validée par approbation ultérieure. Par conséquent, si l’acquisition de biens spécifiques après la création de la société est prévue, il est nécessaire de suivre la procédure d’inscription dans les statuts.
| Type d’acte | Contenu | Attribution à la société après sa création | Fondement / Conditions |
| Actes essentiels à la création de la société | Rédaction des statuts, souscription des actions, tenue de l’assemblée constitutive, etc. | Attribués en principe | Conformes aux objectifs de la société en formation |
| Actes de préparation à l’ouverture | Location de bureaux, achat de matériel, embauche d’employés, etc. | Attribués sous conditions | Essentiels à la préparation à l’ouverture et dans les limites des pouvoirs des fondateurs (jurisprudence) |
| Actes commerciaux | Fabrication et vente de produits, fourniture de services, etc. | Non attribués en principe | Excèdent les pouvoirs des fondateurs. Toutefois, ils peuvent être attribués par approbation de la société après sa création. |
| Acquisition de biens | Promesse d’acquisition de biens après la création de la société | Attribués uniquement si mentionnés dans les statuts | En vertu de l’article 28, paragraphe 2 du droit des sociétés au Japon, l’inscription dans les statuts est une condition pour l’efficacité. Sans inscription, c’est invalide. |
Responsabilités liées à la création d’une société
Dans le processus de création d’une société, diverses responsabilités légales peuvent émerger. Ces responsabilités, principalement assumées par les fondateurs, couvrent un large éventail de domaines. Nous allons ici expliquer les responsabilités envers la société une fois celle-ci établie, envers les tiers en tant que partenaires commerciaux, et celles des « fondateurs de fait ».
Responsabilités envers la société après sa constitution
Les fondateurs doivent exécuter leur mission de création de la société avec toute l’attention d’un bon gestionnaire. En cas de manquement à ce devoir, ils sont responsables des dommages causés à la société nouvellement établie.
L’article 52, paragraphe 1, du droit des sociétés japonais (Japanese Corporate Law) stipule que si les fondateurs négligent leurs devoirs lors de la création de la société, ils sont responsables des dommages qui en résultent pour la société. Par exemple, cela peut concerner des cas où des frais de création inutilement élevés ont été engagés ou des préparatifs d’ouverture inappropriés ont causé des dommages à la société. Cette responsabilité ne peut être levée sans le consentement de l’ensemble des actionnaires (Article 54, paragraphe 1, du droit des sociétés japonais).
De plus, en cas de contribution en nature (apport de biens autres que de l’argent) ou de reprise de biens mentionnés précédemment, si la valeur des biens inscrite dans les statuts est considérablement inférieure à leur valeur réelle, les fondateurs ont une responsabilité particulière. L’article 52-2, paragraphe 1, du droit des sociétés japonais prévoit que dans de tels cas, les fondateurs sont solidairement responsables de payer à la société le montant manquant. Il s’agit d’une responsabilité stricte pour assurer l’enrichissement des actifs de la société, et en principe, elle ne peut être évitée même si les fondateurs prouvent qu’ils n’ont pas négligé leur attention dans l’exercice de leurs fonctions.
Responsabilités envers les tiers
Les fondateurs peuvent également être responsables envers les tiers, partenaires commerciaux, pour les actes effectués dans le cadre de la création de la société.
Premièrement, si les fondateurs agissent avec malveillance ou négligence grave dans l’exercice de leurs fonctions lors de la création de la société, ils sont responsables des dommages causés aux tiers (Article 53, paragraphe 1, du droit des sociétés japonais). Par exemple, cela peut inclure des cas où des plans d’affaires frauduleux ont été présentés pour emprunter des fonds à des tiers.
Plus important encore est la responsabilité en cas d’échec de la constitution de la société. Si, par malheur, les procédures de création échouent et que la société n’est pas constituée, les fondateurs sont solidairement responsables des actes effectués dans le cadre de la création de la société (Article 56 du droit des sociétés japonais). Par exemple, si un contrat de location de bureaux est conclu en prévision de la création de la société et que celle-ci n’aboutit pas, les fondateurs deviennent collectivement les parties contractantes. De même, les frais engagés pour ces actes doivent être supportés solidairement par tous les fondateurs. Il s’agit d’une disposition visant à protéger les partenaires commerciaux et à souligner la lourde responsabilité de devenir fondateur.
Responsabilités des fondateurs de fait
Enfin, il peut arriver que des personnes qui ne sont pas formellement fondateurs mais qui ont été substantiellement impliquées dans la création de la société soient tenues responsables. On parle alors de responsabilité des « fondateurs de fait ».
L’article 55 du droit des sociétés japonais mentionne deux cas de figure. Le premier concerne les personnes qui ont accepté d’inscrire ou d’enregistrer leur nom ou dénomination sociale ainsi que leur soutien à la création de la société dans des publicités ou d’autres documents ou enregistrements électroniques relatifs à la souscription des actions émises lors de la création d’une société par actions. Par exemple, cela peut s’appliquer à un entrepreneur renommé qui a autorisé l’utilisation de sa crédibilité pour la création de la société. Le second cas concerne les personnes qui n’ont pas signé les statuts en tant que fondateurs.
Ces personnes sont considérées comme des fondateurs et assument les mêmes responsabilités que celles décrites précédemment (responsabilités envers la société et envers les tiers). Cela repose sur l’idée qu’en ayant créé une crédibilité externe pour la création de la société par leur nom ou leurs actions, elles doivent assumer une responsabilité correspondante à cette crédibilité. Lorsqu’on s’implique dans la création d’une société, il est nécessaire de reconnaître qu’on peut être soumis à de lourdes responsabilités légales, même si on n’est pas officiellement listé comme fondateur, en fonction de la manière dont on participe.
Résumé
La création d’une entreprise représente un départ plein d’espoir vers une nouvelle aventure commerciale, mais ce processus s’accompagne de problèmes juridiques complexes, comme expliqué dans cet article. En particulier, la validité des actes et la localisation des responsabilités durant la phase transitoire de la « société en formation » sont difficiles à évaluer sans connaissances spécialisées. Les actes dépassant les pouvoirs des fondateurs peuvent non seulement imposer des charges imprévues à la société après sa création, mais aussi exposer les fondateurs à des risques de responsabilité illimitée. Si l’on néglige des procédures strictes comme l’apport de biens, les fondements mêmes du projet d’entreprise envisagé peuvent être ébranlés. Identifier et gérer ces risques à l’avance est la première étape pour assurer une création d’entreprise fluide et une gestion saine dans le futur.
Le cabinet d’avocats Monolith possède une vaste expérience dans le soutien de nombreux clients sur des questions juridiques liées à la création d’entreprise, en particulier avant et après la constitution de la société. Basés sur une connaissance approfondie de la loi sur les sociétés au Japon, nous analysons les risques potentiels liés aux actes et responsabilités de la société en formation et proposons des solutions optimales pour nos clients. De plus, notre cabinet compte plusieurs experts anglophones qualifiés en droit étranger, ce qui nous permet d’offrir un soutien juridique précis et attentif sans barrière linguistique, même pour les clients souhaitant développer des affaires à l’international. Si vous avez des inquiétudes juridiques concernant la création de votre entreprise, n’hésitez pas à nous consulter.
Category: General Corporate