Explication juridique sur la création des statuts lors de l'établissement d'une entreprise au Japon
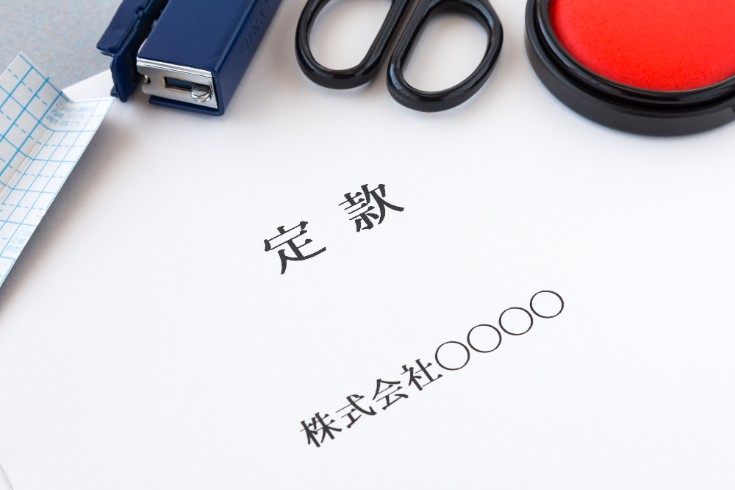
Le processus de création d’une société au Japon (日本) implique bien plus qu’une simple étape procédurale lors de la rédaction des statuts. Ces derniers constituent un document juridique essentiel qui définit l’organisation, la gestion et les règles fondamentales de l’entreprise, et sont souvent qualifiés de “constitution de la société”. La manière dont ce document est conçu et rédigé a un impact profond sur la structure de gouvernance de l’entreprise après sa création, sur ses processus de prise de décision et sur ses perspectives de croissance future. Les dispositions des statuts ont une force contraignante significative pour les actionnaires, les administrateurs et la société elle-même, et leur création doit se conformer aux règles strictes établies par la loi japonaise sur les sociétés. Cet article débute par une explication de la structure de base des statuts sous le droit des sociétés japonais, en détaillant les éléments qui doivent y être obligatoirement inscrits, ceux qui nécessitent une mention spécifique pour avoir un effet juridique particulier, ainsi que les éléments facultatifs qui peuvent refléter l’individualité de l’entreprise. Nous mettrons particulièrement l’accent sur des points de discussion cruciaux pour la prise de décision en gestion, tels que l’interprétation de l'”objet” qui définit le champ d’activité de l’entreprise, et les règles complexes entourant les “apports en nature”, qui sont des contributions autres qu’en argent. Enfin, nous détaillerons également les procédures d’authentification indispensables pour que les statuts rédigés aient une force juridique, fournissant ainsi une connaissance juridique complète pour établir les fondations de la création d’une société.
La structure fondamentale des statuts : Trois catégories de clauses à inscrire
Le droit des sociétés japonais classe les clauses à inscrire dans les statuts en trois catégories, selon leur nature juridique : les « clauses absolument obligatoires », les « clauses relativement obligatoires » et les « clauses facultatives » . Cette structure en trois niveaux reflète l’intention législative de garantir un cadre juridique minimal commun à toutes les entreprises, tout en permettant à chaque société de concevoir sa gouvernance de manière flexible en fonction de sa situation spécifique.
Les clauses absolument obligatoires sont, comme leur nom l’indique, des éléments qui doivent impérativement figurer dans les statuts. Si l’une de ces clauses fait défaut ou si son contenu est juridiquement invalide, l’ensemble des statuts est considéré comme nul, ce qui rend impossible la constitution même de la société . Cela inclut des informations essentielles telles que la dénomination sociale, l’objet, le siège social de l’entreprise, qui sont nécessaires pour identifier l’identité fondamentale de la société et assurer la sécurité des transactions.
Ensuite, les clauses relativement obligatoires n’affectent pas la validité des statuts si elles ne sont pas inscrites. Cependant, si la société souhaite établir des règles concernant ces éléments, elles doivent être inscrites dans les statuts pour avoir une force juridique . Par exemple, les dispositions restreignant le transfert d’actions ou celles prévoyant la mise en place d’un conseil d’administration entrent dans cette catégorie. Ces éléments s’écartent souvent des règles principes établies par le droit des sociétés au Japon, et leur inscription dans les statuts, qui sont la norme suprême de l’entreprise, vise à clarifier leur force obligatoire et à lier tous les actionnaires et parties prenantes.
Enfin, les clauses facultatives sont celles qui n’appartiennent à aucune des deux catégories précédentes et que la société peut déterminer librement, tant qu’elles ne contreviennent pas au droit des sociétés japonais, à d’autres lois impératives ou aux bonnes mœurs . Par exemple, la définition de l’exercice social ou le moment de la convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires peuvent être mentionnés. Bien que ces éléments puissent être établis dans d’autres règlements internes à la société, leur inscription dans les statuts souligne leur importance et rend leur modification sujette à des procédures strictes telles qu’une résolution spéciale de l’assemblée générale des actionnaires, contribuant ainsi à la stabilité de la gestion de l’entreprise . Par conséquent, la décision de savoir quels éléments inclure dans les statuts en tant que quelle catégorie est une décision stratégique importante en prévision de la future gestion de la société.
Les Informations Fondamentales et Incontournables d’une Société
Les informations fondamentales et incontournables constituent les données les plus cruciales qui forment la base de la personnalité juridique d’une société. L’article 27 de la loi japonaise sur les sociétés par actions (会社法) stipule que les statuts d’une société par actions doivent impérativement contenir les cinq éléments suivants :
- L’objet social
- La dénomination commerciale
- Le siège social
- La valeur ou le montant minimum des apports en capital lors de la constitution
- Le nom ou la dénomination et l’adresse des fondateurs
Parmi ces éléments, la mention de l’objet social est particulièrement importante car elle définit légalement le champ d’activité de la société. L’objet social doit être légal, lucratif et clair. Cependant, il existe une divergence notable entre l’interprétation juridique et les exigences pratiques concernant la portée de cet ‘objet social’.
La Cour suprême du Japon, dans des décisions telles que le jugement connu sous le nom d’affaire Yawata Iron & Steel (判決1970年6月24日大法廷), a constamment soutenu que bien que la capacité juridique d’une société soit limitée à l’objet social défini dans ses statuts, la portée de cet objet doit être interprétée largement. Selon la jurisprudence, les actes d’une société ne se limitent pas strictement à l’objet social explicitement mentionné dans les statuts, mais s’étendent à ‘tous les actes directement ou indirectement nécessaires’ à la réalisation de cet objet. Cette interprétation vise principalement à protéger les tiers qui traitent avec la société et à assurer la sécurité des transactions. Si les actes d’une société étaient strictement limités à l’objet social, les partenaires commerciaux seraient constamment contraints de vérifier si leurs transactions entrent dans le cadre des statuts de l’autre partie, ce qui entraverait le bon déroulement des activités économiques.
Cependant, cette interprétation juridique large n’est pas toujours applicable dans la pratique. Par exemple, lors de l’obtention d’un prêt auprès d’une institution financière, si le projet financé n’est pas explicitement mentionné dans l’objet social des statuts, l’examen du prêt peut rencontrer des difficultés. De même, pour des secteurs tels que la construction ou le travail temporaire, où une autorisation administrative est nécessaire pour exercer une activité spécifique, le fait que cette activité soit mentionnée dans l’objet social des statuts est une condition préalable à l’obtention de cette autorisation. Lors d’un contrôle fiscal, des questions peuvent également se poser quant à la déductibilité des dépenses engagées pour des activités non mentionnées dans les statuts.
Par conséquent, même si la loi reconnaît une large portée aux activités d’une société, pour prévenir les obstacles pratiques et assurer une gestion d’entreprise fluide, il est judicieux d’inclure dans l’objet social des statuts non seulement les activités actuelles mais aussi celles qui pourraient être développées à l’avenir, de manière aussi concrète et exhaustive que possible.
Les conditions de validité des dispositions relatives aux mentions relatives
Les mentions relatives sont des éléments qui, tout en respectant l’autonomie de l’entreprise, peuvent avoir un impact significatif sur les parties prenantes telles que les actionnaires et les créanciers. Par conséquent, leur inclusion dans les statuts est requise comme condition de leur validité. Si ces mentions ne figurent pas dans les statuts, même si elles ont été approuvées par l’assemblée générale des actionnaires, elles seront juridiquement invalides.
Des exemples courants de mentions relatives incluent les dispositions relatives aux restrictions de transfert d’actions, la mise en place d’un conseil d’administration ou d’un auditeur, et l’installation d’un gestionnaire du registre des actionnaires. Ces règlements permettent à l’entreprise d’apporter ses propres ajustements en remplacement des règles uniformes du droit des sociétés japonais, mais en raison de leur importance, leur inscription dans les statuts, qui sont les règles fondamentales, est exigée.
Parmi les mentions relatives, celles qui sont soumises à une discipline particulièrement stricte sont les « dispositions relatives à la création atypique » définies à l’article 28 de la loi japonaise sur les sociétés. Ce terme signifie qu’il s’agit de dispositions relatives à une création qui diffère de la création normale par apport en numéraire. Les dispositions relatives à la création atypique comprennent les quatre éléments suivants :
- Apport en nature : apport de biens autres que de l’argent.
- Acquisition de biens : contrat par lequel les fondateurs s’engagent à transférer certains biens après la constitution de la société.
- Rémunération des fondateurs et autres avantages spéciaux : avantages patrimoniaux accordés aux fondateurs en reconnaissance de leur contribution à la création de la société.
- Frais liés à la création de la société à la charge de la société par actions.
Ce qui est commun à ces éléments est le risque que, lors de la création de l’entreprise, une étape fragile où aucun organe de décision indépendant n’existe encore, les fondateurs puissent compromettre les fondements patrimoniaux de l’entreprise par leur discrétion. Par exemple, si des actifs de faible valeur sont surévalués lors de l’apport en nature, ou si les fondateurs reçoivent une rémunération indûment élevée, le capital de l’entreprise nouvellement créée pourrait n’être que nominal et ne pas refléter une valeur réelle, donnant naissance à une « entreprise vide ».
Afin de prévenir une telle situation et de garantir les fondements patrimoniaux de l’entreprise, conformément au « principe de suffisance du capital », la loi japonaise sur les sociétés exige que ces dispositions relatives à la création atypique soient inscrites dans les statuts. De plus, elle impose généralement une enquête par un inspecteur nommé par le tribunal, mettant en place un système de vérifications multiples.
L’essentiel sur l’établissement de contributions en nature et leur régime juridique au Japon
Dans le cadre des modalités de création d’entreprise, la contribution en nature est celle qui est la plus fréquemment utilisée en pratique et qui est soumise à la réglementation la plus détaillée. La contribution en nature consiste à apporter des biens autres que de l’argent, tels que des biens immobiliers, des véhicules ou des droits de propriété intellectuelle, et à recevoir en contrepartie des actions de la société. Cela présente l’avantage de pouvoir renforcer le capital d’une société en utilisant des actifs possédés, même en cas de liquidités limitées.
Cependant, afin de garantir l’objectivité de l’évaluation et de prévenir une augmentation artificielle de la valeur du capital, le droit des sociétés japonais impose une réglementation stricte sur les contributions en nature. Ces réglementations sont basées sur le principe fondamental de l’augmentation du capital, qui vise à assurer une base financière solide pour l’entreprise et à protéger les créanciers.
Premièrement, lorsqu’une contribution en nature est effectuée, il est nécessaire selon l’article 28, paragraphe 1 du droit des sociétés japonais, de détailler cette contribution dans les statuts de la société. Plus précisément, il faut indiquer le nom du contributeur, les biens apportés et leur valeur, ainsi que le nombre d’actions qui seront attribuées au contributeur.
Deuxièmement, en principe, après l’authentification des statuts, il faut demander à un tribunal la nomination d’un inspecteur pour évaluer la valeur des biens apportés (selon l’article 33 du droit des sociétés japonais). Cette procédure, qui peut être coûteuse et prendre du temps, représente donc un fardeau important en pratique.
Par conséquent, le droit des sociétés japonais prévoit des cas exceptionnels où cette inspection rigoureuse n’est pas nécessaire. En pratique, la plupart des contributions en nature sont effectuées en utilisant ces exceptions. Les exceptions sont principalement accordées dans les trois cas suivants :
- Lorsque la valeur totale des biens apportés en nature indiquée dans les statuts est inférieure à 5 millions de yens.
- Lorsque les biens apportés sont des valeurs mobilières ayant un prix de marché et que la valeur indiquée dans les statuts ne dépasse pas ce prix de marché.
- Lorsque la valeur indiquée dans les statuts est jugée appropriée par un expert tel qu’un avocat, un comptable agréé ou un fiscaliste (en cas de biens immobiliers, une évaluation par un expert immobilier est également nécessaire).
Troisièmement, le droit des sociétés japonais établit un système de responsabilité a posteriori. L’article 52 du droit des sociétés japonais stipule que si la valeur réelle des biens apportés en nature lors de la création de la société est « considérablement inférieure » à la valeur indiquée dans les statuts, les fondateurs et les administrateurs au moment de la création sont solidairement responsables de payer à la société le montant manquant (responsabilité de compensation de la valeur). Cette responsabilité est une responsabilité sans faute, qui est très lourde. Les experts qui ont certifié la valeur sont également solidairement responsables, à moins qu’ils ne puissent prouver qu’ils n’ont pas été négligents. Le jugement de la Haute Cour d’Osaka du 19 février 2016 (2016) est un cas où la responsabilité d’un avocat ayant certifié la valeur des biens apportés en nature a été mise en question, illustrant ainsi la lourde responsabilité que les experts peuvent porter.
Ainsi, le droit des sociétés japonais prévient l’abus des contributions en nature et assure substantiellement le principe de l’augmentation du capital à travers une triple réglementation : l’inscription dans les statuts, l’inspection préalable et la responsabilité ultérieure.
Les dispositions facultatives reflétant l’identité de l’entreprise sous le droit japonais
Les dispositions facultatives sont des règles que les entreprises peuvent inclure volontairement dans leurs statuts, en plus des dispositions absolues et relatives, afin de faciliter leur gestion. Ces éléments, même s’ils ne sont pas mentionnés dans les statuts, ne sont pas invalides légalement et peuvent également être établis dans des règlements inférieurs, tels que les règlements du conseil d’administration. Cependant, l’inclusion délibérée de ces éléments dans les statuts, qui sont la norme suprême de l’entreprise, revêt une importance significative.
Pour modifier les éléments inscrits dans les statuts, il est généralement nécessaire d’obtenir une résolution spéciale de l’assemblée générale des actionnaires, c’est-à-dire l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents, qui doivent représenter plus de la moitié des droits de vote. Cela représente des exigences bien plus strictes que celles des règlements internes de l’entreprise, qui peuvent être modifiés plus facilement par des résolutions du conseil d’administration.
Par conséquent, la décision de ce qui doit être inclus dans les statuts en tant que dispositions facultatives est un choix stratégique qui doit tenir compte de l’équilibre entre la « flexibilité » et la « stabilité » de la gestion. Par exemple, il est courant de définir les éléments suivants comme des dispositions facultatives :
- Le calendrier de convocation de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires
- Le nombre de directeurs et d’auditeurs
- La méthode de détermination de la rémunération des dirigeants
- L’exercice social
En particulier, dans les entreprises de coentreprise avec plusieurs actionnaires ou celles qui reçoivent des investissements d’investisseurs externes, le fait de « fixer » certaines règles de gestion dans les statuts en tant que dispositions facultatives peut être un moyen efficace de protéger les droits des actionnaires minoritaires et d’assurer le respect des accords entre les fondateurs. Par exemple, en spécifiant le nombre de directeurs dans les statuts, il est possible de prévenir les changements unilatéraux dans la composition du conseil d’administration par les actionnaires majoritaires. Ainsi, les dispositions facultatives fonctionnent comme un outil de gouvernance qui reflète l’identité de l’entreprise et la dynamique entre les parties prenantes, tout en prévenant les conflits futurs.
Dernière étape de la création des statuts : la procédure de certification
Dans le cadre de la création d’une société par actions au Japon, les statuts initiaux rédigés par les fondateurs doivent être certifiés par un notaire, conformément à l’article 30, paragraphe 1 de la loi japonaise sur les sociétés. Cette procédure de certification est un processus crucial qui garantit la clarté des statuts, prévient les litiges futurs et atteste officiellement que les statuts ont été établis selon une procédure légale.
Il existe deux méthodes de certification : la certification traditionnelle sur papier et la certification moderne des statuts électroniques. La principale différence entre les deux réside dans le coût, en particulier la présence ou l’absence de la taxe de timbre. Les statuts rédigés sur papier sont considérés comme des documents taxables selon la loi japonaise sur la taxe de timbre, nécessitant l’apposition d’un timbre fiscal de 40 000 yens. En revanche, les statuts électroniques, étant des données électroniques et non des “documents”, ne sont pas soumis à cette taxe de timbre.
Cependant, pour créer et certifier des statuts électroniques, il est nécessaire de disposer d’un logiciel de signature électronique, d’un lecteur de carte à puce et d’un certificat électronique stocké, par exemple, sur une carte My Number. Si vous préparez ces équipements par vous-même, l’investissement initial peut dépasser les économies réalisées sur la taxe de timbre. Par conséquent, en particulier pour une création d’entreprise unique, faire appel à un professionnel tel qu’un juriste ou un avocat, qui dispose déjà de l’environnement nécessaire pour la certification électronique, peut souvent être le choix le plus efficace en termes de coûts et de temps.
Le tableau suivant résume les principales différences entre la certification sur papier et la certification électronique.
| Élément | Certification sur papier | Certification électronique |
| Frais de notaire | De 30 000 à 50 000 yens selon le montant du capital | De 30 000 à 50 000 yens selon le montant du capital |
| Taxe de timbre | 40 000 yens | Non requise |
| Frais de copie certifiée | Environ 250 yens par page | Frais pour la fourniture des mêmes informations, par exemple 700 yens par document |
| Équipement nécessaire | Non requis | Certificat électronique, lecteur de carte à puce, logiciel de signature, etc. |
| Résumé de la procédure | Se rendre au bureau du notaire pour la certification | Demande possible en ligne |
Comme le montre ce tableau, la certification électronique présente un avantage clair en termes d’économie de la taxe de timbre, mais pour en bénéficier, une préparation technique est nécessaire. Il est important de choisir la méthode la plus adaptée à la situation de votre entreprise.
Résumé
Comme détaillé dans cet article, les statuts ne sont pas simplement un des documents de création d’entreprise, mais le document le plus important qui définit l’identité juridique, la gouvernance et l’essence de la gestion des affaires d’une société. Sur la base d’un cadre obligatoire d’éléments absolument nécessaires, une “constitution” sur mesure pour chaque entreprise est achevée en intégrant une conception institutionnelle stratégique à travers des éléments relatifs et en tissant des règles de fonctionnement uniques à travers des éléments facultatifs. En particulier, l’équilibre entre l’interprétation juridique et les exigences pratiques dans la formulation de l'”objet” qui définit le champ d’activité de l’entreprise, ainsi que la discipline complexe concernant les “apports en nature” qui incarnent le principe du renforcement du capital, sont difficiles à gérer correctement sans connaissances spécialisées. Comprendre précisément ces dispositions et les refléter adéquatement dans les statuts est essentiel pour construire une base solide qui minimise les risques juridiques futurs et permet une croissance durable.
Notre cabinet d’avocats Monolith, situé au Japon, possède une vaste expérience dans le domaine abordé par cet article, ayant servi de nombreux clients au Japon. En plus des avocats bilingues qualifiés au Japon, notre cabinet compte également plusieurs avocats anglophones qualifiés à l’étranger, ce qui nous permet de fournir un soutien juridique minutieux adapté aux besoins spécifiques de ceux qui développent des affaires dans un environnement commercial international. Du processus de création des statuts à leur certification, en passant par l’établissement de structures de gouvernance après la création de l’entreprise, nous proposons des solutions optimales basées sur une expertise spécialisée à chaque étape.
Category: General Corporate





















