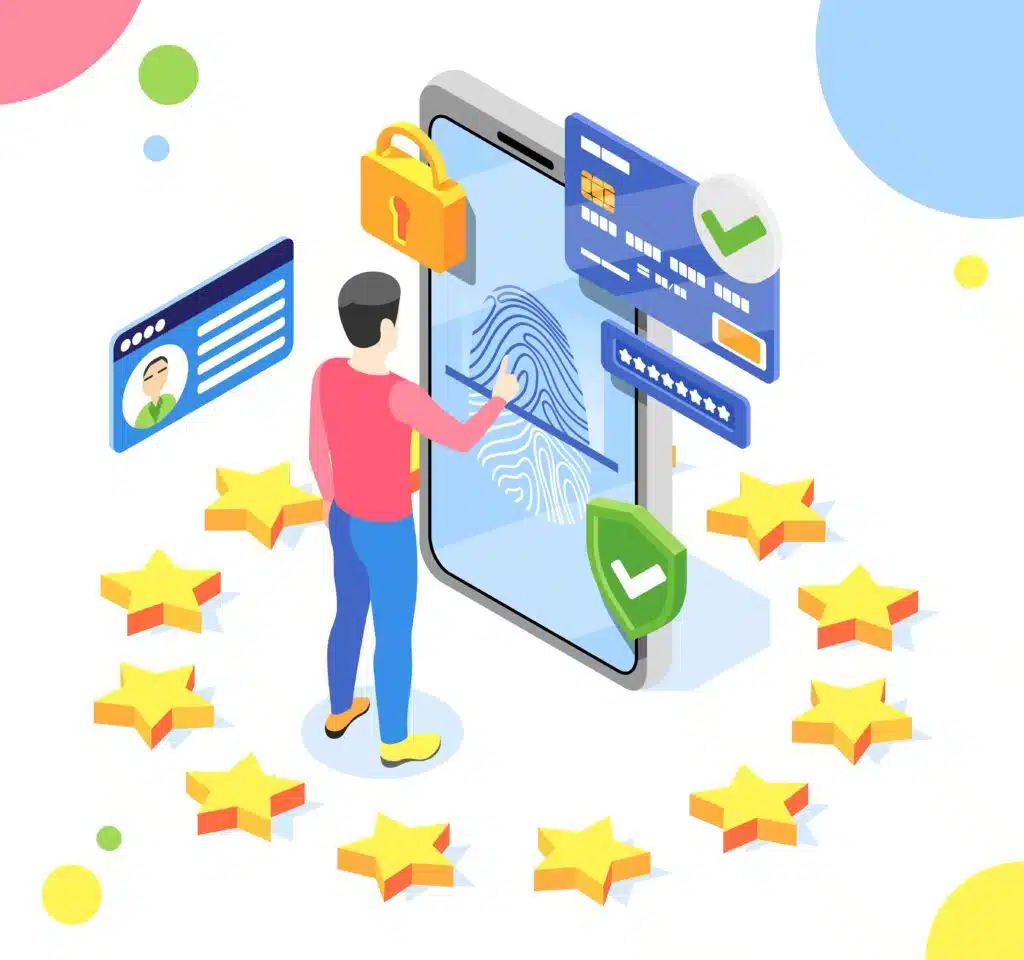Les actions de conflit dans le droit du travail japonais : légitimité juridique et stratégies de réponse des entreprises

Dans la gestion d’entreprise au Japon, la relation avec les syndicats est un enjeu incontournable et crucial. En particulier, les “actions de conflit” que les syndicats peuvent choisir lorsque les négociations collectives échouent, peuvent avoir un impact sérieux sur le fonctionnement normal des affaires. Bien que le droit japonais garantisse les actions de conflit en tant que droit des travailleurs, cette garantie n’est pas inconditionnelle. Selon que l’action de conflit est légalement “justifiée” ou non, les mesures de rétorsion que l’entreprise peut prendre, ainsi que les responsabilités légales incombant au syndicat et à ses membres, diffèrent fondamentalement. Par conséquent, comprendre précisément cette frontière de “justification” est essentiel pour les dirigeants et les responsables juridiques des entreprises opérant au Japon, dans le cadre de la gestion des risques.
Lorsqu’une action de conflit se produit, elle peut représenter une crise juridique affectant la survie même de l’entreprise, et pas seulement un problème de relations de travail. Par exemple, si une grève arrête la production, l’entreprise peut subir non seulement des pertes économiques directes, mais aussi perdre la confiance de ses partenaires commerciaux. Cependant, si l’action de conflit manque de légitimité juridique, l’entreprise peut être en mesure de réclamer des dommages et intérêts au syndicat ou aux employés participants individuellement. À l’inverse, si l’entreprise répond de manière inappropriée à une action de conflit justifiée, elle peut être tenue responsable de pratiques de travail déloyales. Cet article organise le cadre juridique des actions de conflit dans le droit du travail japonais et explique, du point de vue d’un expert, les critères pour juger de leur “justification”, les responsabilités légales en cas de manque de justification, et les mesures spécifiques de rétorsion que l’entreprise peut prendre, en s’appuyant sur des cas de jurisprudence.
Le fondement juridique des actions de conflit sous le droit japonais
Au Japon, le droit de mener des actions de conflit repose sur un solide fondement juridique, ancré dans l’article 28 de la Constitution japonaise. Cet article garantit aux travailleurs le « droit de s’associer », le « droit de négocier collectivement » et le « droit d’agir collectivement ». Ce « droit d’agir collectivement » constitue la base constitutionnelle du droit de mener des actions de conflit, telles que les grèves.
Pour concrétiser cette garantie constitutionnelle, la loi japonaise sur les syndicats de travailleurs offre une forte protection juridique aux actions de conflit. Cette protection se compose principalement de deux immunités : l’immunité pénale et l’immunité civile.
Premièrement, l’immunité pénale. L’article 1, paragraphe 2, de la loi japonaise sur les syndicats de travailleurs stipule qu’aucun crime défini par le code pénal japonais ne peut être constitué pour des actions légitimes d’un syndicat. Par exemple, bien qu’une grève puisse formellement correspondre à un acte d’entrave aux opérations d’une entreprise (comme le crime de perturbation des affaires par la force), tant qu’elle constitue une action de conflit légitime, aucune sanction pénale ne sera appliquée.
Deuxièmement, l’immunité civile. L’article 8 de la loi japonaise sur les syndicats de travailleurs dispose qu’un employeur ne peut pas réclamer de dommages et intérêts à un syndicat ou à ses membres, même si l’entreprise subit des pertes en raison d’une action de conflit légitime. Ainsi, même si une grève légitime entraîne d’énormes pertes de profits pour l’entreprise, il est juridiquement impossible de transférer ces pertes sur le syndicat.
Cependant, ces fortes protections juridiques sont conditionnées par la légitimité de l’action de conflit. Les dispositions de la loi japonaise sur les syndicats de travailleurs insistent systématiquement sur la nécessité que l’action soit « légitime » pour bénéficier de l’immunité. Cela suggère que le droit de conflit garanti par la Constitution n’est pas illimité, mais est soumis à certaines limites sociales et juridiques. Par conséquent, le simple fait qu’un syndicat ait initié une action de conflit n’est pas la fin de l’analyse juridique, mais plutôt son commencement. Le défi le plus important pour une entreprise est d’analyser de manière objective et sereine si l’action de conflit répond aux critères de « légitimité » définis par la loi. Le résultat de cette analyse déterminera la position juridique de l’entreprise, les contre-mesures possibles et, en fin de compte, l’orientation de la résolution du conflit.
Les quatre critères pour juger la légitimité d’une action contestataire sous le droit japonais
Les tribunaux japonais, lorsqu’ils doivent déterminer si une action contestataire est légitime ou non, ne se basent pas sur un critère unique mais prennent en compte de manière globale plusieurs éléments. Ce cadre de jugement, établi par l’accumulation de jurisprudence, se compose principalement de quatre critères : « le sujet », « l’objectif », « la procédure » et « les moyens et la manière ». Lorsqu’une entreprise est confrontée à une action contestataire d’un syndicat, elle doit examiner la légitimité de cette action à travers ces critères pour une évaluation multidimensionnelle.
La légitimité de l’acteur
Le premier critère pour reconnaître la légitimité d’une action contestataire est que l’acteur de cette action soit approprié. Le droit de dispute est un droit visant à équilibrer substantiellement les négociations collectives, donc les actions contestataires doivent être organisées de manière systématique par un syndicat de travailleurs ou un groupe de travailleurs équivalent, qui peut être un acteur dans les négociations collectives .
Par conséquent, une grève menée de manière autonome par certains membres du syndicat sans la décision officielle du syndicat, communément appelée « grève sauvage », manque de légitimité en tant qu’acteur et est jugée illégale. Dans la jurisprudence japonaise également, il est établi qu’une grève sauvage menée par une partie des membres du syndicat, ignorant la volonté de l’ensemble du syndicat, n’est pas légitime. Même si la direction du syndicat approuve la grève a posteriori, il existe un précédent judiciaire qui a décidé qu’une action jugée illégale ne peut pas devenir légale rétroactivement (décision du tribunal de district de Fukuoka, succursale de Kokura, le 16 mai 1950 (1950)) .
La légitimité de l’objectif
Deuxièmement, l’objectif de l’action contestataire doit être légitime. Le droit de grève est un droit garanti pour améliorer la position économique des travailleurs. Par conséquent, l’objectif de l’action contestataire doit être lié à des questions qui peuvent être résolues par la négociation collective avec l’employeur, telles que les salaires, les heures de travail et d’autres conditions de travail.
Dans cette perspective, les grèves menées à des fins purement politiques, les soi-disant “grèves politiques”, ne sont généralement pas reconnues comme légitimes. Cela est dû au fait que les demandes telles que l’opposition à un projet de loi spécifique ou le changement de politique du gouvernement sont des questions qui ne peuvent pas être réalisées par les efforts d’un seul employeur. La Cour suprême du Japon a clairement indiqué dans l’affaire de l’usine de construction navale de Mitsubishi Heavy Industries à Nagasaki (jugement du 25 septembre 1992 (Heisei 4)) que mener une action contestataire pour un objectif politique qui n’est pas directement lié à l’amélioration de la position économique des travailleurs vis-à-vis de leur employeur est hors du champ de protection de l’article 28 de la Constitution japonaise.
De même, les “grèves de solidarité” menées pour soutenir les conflits de travail d’autres entreprises ont tendance à être jugées illégitimes lorsque l’employeur de la propre entreprise des grévistes n’a aucune influence sur la résolution du conflit.
La légitimité de la procédure
Troisièmement, il est requis que la procédure menant à l’action contestée soit appropriée. L’action contestée est considérée comme le dernier recours dans les négociations entre employeurs et employés, et il est présumé qu’avant d’y recourir, des négociations collectives sincères aient été menées de manière exhaustive. Si, malgré la possibilité de négocier, une partie engage unilatéralement une action contestée, la légitimité de celle-ci peut être remise en question.
De plus, une grève déclenchée sans préavis et de manière soudaine peut être jugée illégale pour avoir causé un dommage imprévu et excessif à l’employeur, en violation du principe de bonne foi. Dans un cas jurisprudentiel, la légitimité d’une grève a été niée lorsque l’heure annoncée initialement a été avancée de 12 heures et que le début de la grève a été notifié seulement cinq minutes avant.
En outre, les syndicats doivent respecter leurs propres règlements internes ainsi que les procédures établies par la loi japonaise sur les syndicats. En particulier, l’article 5, paragraphe 2, point 8 de la loi japonaise sur les syndicats stipule qu’une décision majoritaire obtenue par un vote direct et anonyme des membres du syndicat est nécessaire pour entamer une grève solidaire. Une grève qui omet cette procédure ne peut être considérée comme légitime sur le plan procédural.
De plus, la loi japonaise sur l’ajustement des relations de travail impose aux « services d’intérêt public » tels que les transports, les soins médicaux, et la fourniture d’électricité, de gaz et d’eau, de notifier au moins 10 jours avant la date prévue de l’action contestée, à la commission des relations de travail ainsi qu’au ministre de la Santé, du Travail et des Affaires sociales (ou au gouverneur de la préfecture). Une action contestée qui viole cette obligation de préavis est également illégale.
La légitimité des moyens et des modalités d’action
Enfin, il est essentiel que les moyens et modalités spécifiques des actions contestataires restent dans les limites de ce qui est considéré comme raisonnable selon les normes sociales. Quels que soient les objectifs ou les raisons, l’usage de la violence n’est jamais justifié. L’article 1, paragraphe 2, de la Loi sur les syndicats de travailleurs au Japon (Japanese Trade Union Law) stipule clairement ce point .
Concernant les modalités d’action spécifiques, les points suivants ont été soulevés dans la jurisprudence :
Le piquetage est une action visant à empêcher d’autres employés ou partenaires commerciaux qui souhaitent travailler d’entrer sur le lieu de travail, afin de garantir l’efficacité d’une grève. Cependant, cette modalité doit se limiter strictement à la persuasion pacifique. Des actions telles que l’usage d’insultes par un grand nombre de personnes ou la mise en place de barrières physiques (comme un scrum) pour bloquer complètement l’accès des personnes sont jugées comme dépassant les limites de la légitimité .
L’occupation des lieux de travail, où les participants à la grève restent sur place et excluent la gestion des installations par l’employeur, est une autre forme d’action. La jurisprudence a jugé que l’occupation « totale et exclusive » des lieux de travail, qui élimine complètement le contrôle de l’employeur sur ses installations, viole les droits de propriété de l’employeur et n’est donc pas légitime . En revanche, une simple occupation d’une partie des lieux de travail, sans entraver physiquement le travail des autres employés ou l’exécution des opérations, peut être considérée comme légitime.
Le ralentissement du travail (sabotage) est un acte visant à réduire intentionnellement l’efficacité des opérations. Il est reconnu comme faisant partie des actions contestataires dans la mesure où il implique une fourniture incomplète de la force de travail. Cependant, des actes qui vont au-delà de la simple réduction de l’efficacité, tels que ceux causant des dommages actifs aux installations ou aux produits de l’entreprise, ou menaçant la sécurité des opérations, dépassent les limites d’un ralentissement légitime et sont considérés comme illégaux. Par exemple, dans un cas où un conducteur de train a intentionnellement réduit la vitesse de manière extrême sous le prétexte de lutte pour la sécurité, créant ainsi un risque pour la sécurité des opérations ferroviaires, le tribunal a nié la légitimité de cette action contestataire (jugement du Tribunal de district de Tokyo, 16 juillet 2014) .
Comparaison entre les actions de conflit légitimes et celles dépourvues de légitimité sous le droit japonais
En nous basant sur les quatre critères de jugement détaillés précédemment, nous pouvons comparer les caractéristiques typiques des actions de conflit légitimes et celles dépourvues de légitimité comme illustré dans le tableau ci-dessous. Ce tableau sert de référence lors de l’évaluation de situations concrètes dans le cadre juridique japonais.
| Critère | Exemples d’actions reconnues légitimes | Exemples d’actions reconnues non légitimes |
| Acteur | Mise en œuvre par un syndicat suite à une décision officielle de l’organisme (vote des membres, etc.). | Action entreprise de manière unilatérale par certains membres du syndicat sans décision collective (grève sauvage). |
| Objectif | Viser l’amélioration ou le maintien des conditions de travail, telles que l’augmentation des salaires ou la réduction du temps de travail. | Objectifs purement politiques, comme l’opposition aux politiques gouvernementales (grève politique). |
| Procédure | Après avoir mené de bonne foi des négociations collectives, l’action est entreprise en dernier recours. Notification appropriée préalablement effectuée. | Aucune négociation collective n’est menée ou elle est purement formelle, et la grève est lancée soudainement. Coup de théâtre sans préavis. |
| Moyens & Comportement | Non-fourniture pacifique de travail (grève). Piquetage dans les limites de la persuasion pacifique par la parole. | Violence, intimidation, destruction de biens. Piquetage bloquant physiquement et complètement l’accès des personnes. Occupation totale et exclusive du lieu de travail. |
Responsabilité légale pour des actions de grève sans justification en droit japonais
Lorsqu’une action de grève ne remplit aucun des quatre critères mentionnés précédemment et est jugée « sans justification », la protection puissante de l’immunité pénale et civile offerte par la loi japonaise sur les syndicats est perdue. En conséquence, le syndicat et les membres individuels qui ont participé peuvent être tenus responsables de sévères obligations légales en vertu du droit civil et pénal japonais.
Responsabilité civile : demande de dommages et intérêts
Une action de grève sans justification peut constituer un délit civil selon le Code civil japonais (article 709 du Code civil japonais). Cela permet à une entreprise de réclamer des dommages et intérêts au syndicat pour les pertes subies en raison de l’action de grève. Les dommages pouvant être réclamés incluent les profits manqués dus à l’arrêt de la production, les coûts de réparation des équipements, et les dépenses engagées pour restaurer la confiance des clients.
Un point encore plus important est que la responsabilité pour dommages et intérêts ne se limite pas uniquement à l’organisation syndicale. La jurisprudence japonaise reconnaît que les dirigeants du syndicat qui ont planifié ou dirigé une action de grève illégale, ainsi que les membres qui y ont activement participé, peuvent être tenus conjointement responsables des dommages (acte délictuel conjoint, article 719 du Code civil japonais). Dans l’affaire Shosen (jugement du Tribunal de district de Tokyo du 6 mai 1992 (Heisei 4)), il a été établi que l’action de grève est à la fois un acte du groupe et, en même temps, un acte des membres individuels du syndicat, affirmant ainsi la responsabilité délictuelle individuelle des membres. La possibilité pour les membres individuels d’être directement responsables des dommages a une signification extrêmement importante pour dissuader la participation à des actions de grève illégales.
Responsabilité pénale
En l’absence de protection de l’immunité pénale, les actions individuelles dans une action de grève sans justification peuvent être considérées comme des crimes en vertu du Code pénal japonais. Par exemple, si l’on empêche les opérations par la force, cela pourrait constituer un crime d’obstruction des affaires par intimidation, une entrée illégale dans les installations d’une entreprise pourrait constituer un crime de violation de domicile, et l’usage de la violence envers les dirigeants ou d’autres employés pourrait mener à des accusations d’agression ou de lésions corporelles. Ces actes criminels peuvent faire l’objet d’une enquête policière et d’une inculpation par le procureur.
Sanctions disciplinaires contre les employés
Refuser de fournir du travail sans raison valable constitue un manquement aux obligations contractuelles de travail. La participation à une action de grève sans justification correspond précisément à ce manquement et est considérée comme une perturbation de l’ordre de l’entreprise. Par conséquent, l’entreprise peut, conformément aux règles établies dans le règlement intérieur, imposer des sanctions disciplinaires aux employés qui ont participé à une action de grève illégale. La sévérité des sanctions peut varier, allant de la réprimande, la réduction de salaire, la suspension de travail, jusqu’au licenciement disciplinaire, le plus sévère, en fonction de la gravité de l’acte et du degré de dommage causé à l’entreprise. La Cour suprême du Japon a également constamment indiqué que des sanctions disciplinaires peuvent être imposées aux membres individuels du syndicat qui ont perturbé l’ordre de gestion par une action de grève illégale.
Conflits de travail et salaires sous le droit japonais
La gestion des salaires des employés pendant une période de conflit de travail représente un enjeu direct et crucial pour les entreprises. La réponse à cette question varie en fonction de la nature du conflit.
Le principe du « No Work, No Pay » au Japon
Lorsque des employés participent à une grève et refusent totalement de fournir leur travail, l’entreprise n’est pas tenue de leur verser un salaire. Ce principe est connu sous le nom de « No Work, No Pay » et découle de la nature fondamentale du contrat de travail, où le salaire est la contrepartie du travail fourni. Il ne s’agit pas d’une réduction de salaire punitive, mais simplement de ne pas payer pour un travail qui n’a pas été fourni, ce qui est une conséquence logique du contrat.
En outre, le paiement de salaires à des employés participant à une grève légitime pourrait être considéré comme un soutien financier au syndicat, ce qui constitue un risque d’acte de « domination ou d’intervention » interdit par l’article 7 de la loi japonaise sur les syndicats. Par conséquent, ne pas payer les salaires pour les heures non travaillées pendant une grève est non seulement légalement justifié, mais pourrait être considéré comme une obligation.
Réduction de salaire en cas de ralentissement du travail ou de grève partielle au Japon
La situation devient plus complexe lorsque les employés fournissent un travail incomplet, comme dans le cas d’un ralentissement du travail (sabotage) ou d’une grève partielle où certaines tâches seulement sont refusées. Dans ces cas, l’entreprise peut réduire les salaires proportionnellement au travail non fourni, mais le calcul doit être objectif et raisonnable.
Une réduction uniforme et significative des salaires pour la seule raison de participation à un ralentissement du travail n’est pas autorisée ; la réduction doit correspondre au niveau de non-travail. Dans un cas jugé par le tribunal de district d’Obihiro (décision du 29 novembre 1982), il a été reconnu raisonnable de calculer la réduction de salaire en prenant comme référence le montant minimum des recettes des chauffeurs de taxi qui n’avaient pas participé au ralentissement du travail, et de réduire ensuite ce montant d’un certain pourcentage. De plus, dans le cas d’un salaire mensuel avec un salaire de base et diverses allocations, il est nécessaire de déterminer individuellement quelle partie constitue la contrepartie du travail et quelle partie ne l’est pas. La Cour suprême du Japon, dans l’affaire de l’usine de construction navale de Mitsubishi Heavy Industries à Nagasaki (décision du 18 septembre 1981), a rejeté une division abstraite simpliste des salaires en parties fournies et non fournies, indiquant que la décision de réduire ou non devrait être prise en fonction de la nature de chaque allocation.
Les mesures de contre-attaque des employeurs face aux conflits sociaux
Même lorsqu’un syndicat entame une action de grève, l’employeur n’est pas sans défense. Le système juridique japonais respecte les droits de gestion de l’employeur et autorise la prise de mesures de contre-attaque dans certaines limites.
Continuité des opérations pendant une action de grève
Pour commencer, l’employeur n’est pas obligé de suspendre ses activités pendant une action de grève. Il jouit de la « liberté d’exploitation » et peut mobiliser des non-syndiqués ou des cadres qui ne participent pas à la grève, ou encore embaucher de nouveaux travailleurs de remplacement pour assurer la continuité de l’entreprise. Sécuriser du personnel de remplacement pour atténuer les effets d’une grève fait partie des droits légitimes de l’employeur.
Le lock-out défensif (fermeture de l’établissement)
La mesure de contre-attaque la plus puissante à la disposition de l’employeur est le lock-out. Il s’agit d’une mesure où l’employeur refuse activement l’offre de travail des employés participant à l’action de grève et ne les laisse pas travailler.
Cependant, les tribunaux japonais imposent des restrictions strictes à l’exercice du lock-out. Il n’est pas permis à l’employeur de procéder à un lock-out à des fins agressives, c’est-à-dire pour affaiblir le syndicat ou pour mener des négociations à son avantage. Le lock-out est considéré comme légitime uniquement lorsqu’il s’agit d’une mesure défensive. Plus précisément, il est justifié uniquement lorsque les actions de grève du côté des travailleurs rompent considérablement l’équilibre des forces entre les parties et que l’employeur subit une pression unilatéralement défavorable, nécessitant une action pour rétablir cet équilibre.
Ce critère d’équilibre des forces a été établi dans l’affaire Marushima Sluice Manufacturing Co. (décision de la Cour suprême du Japon du 25 avril 1975) et a été concrètement appliqué dans l’affaire Aikawa Ready-Mixed Concrete Industry(décision de la Cour suprême du Japon du 18 avril 2006). Dans cette affaire, le syndicat a répété des grèves de courte durée et imprévisibles, levant la grève immédiatement après que l’employeur ait renoncé aux commandes du jour. En conséquence, l’employeur a été contraint de fermer pour la journée malgré de courtes périodes de non-travail, subissant ainsi un double coup dur de charges salariales et de pertes de revenus. La Cour suprême a jugé que l’impact de ces tactiques syndicales sur l’employeur était considérablement plus important que les heures de non-travail et a reconnu le lock-out de l’employeur comme une mesure défensive légitime pour rétablir l’équilibre des forces.
Lorsque le lock-out est reconnu comme légitime, l’employeur peut être exempté de l’obligation de payer les salaires aux employés concernés pendant cette période. Ainsi, la légitimité du lock-out de l’employeur est étroitement liée à la nature de l’action de grève du syndicat. Plus l’action du syndicat est destructrice et injuste, plus il est facile de justifier les mesures de contre-attaque défensives de l’employeur.
Résumé
Les actions de conflit dans le cadre du droit du travail japonais sont un droit fondamental des travailleurs garanti par la Constitution. Cependant, l’exercice de ce droit n’est pas illimité et ne peut bénéficier d’une protection puissante contre les responsabilités pénales et civiles qu’à travers le filtre strict de la “légitimité”. Du point de vue de la gestion d’entreprise, la présence ou l’absence de cette légitimité devient un point de divergence crucial qui détermine les risques et les retours lors d’un conflit. Si une action de conflit menée par un syndicat manque de légitimité sur le plan du sujet, de l’objectif, de la procédure ou des moyens et de la manière, elle ne constitue plus un exercice de droit protégé, mais se transforme en un acte illicite contre l’entreprise. En conséquence, l’entreprise peut prendre des mesures juridiques fermes telles que des demandes de dommages-intérêts, des plaintes pénales et des sanctions disciplinaires contre les employés participants. Face à une situation critique telle qu’une action de conflit, la première étape vers la meilleure résolution est d’analyser rapidement et précisément la légitimité de l’action d’un point de vue juridique, sans tomber dans un affrontement émotionnel, et de clarifier les droits de votre entreprise et les responsabilités de la partie adverse.
Le cabinet d’avocats Monolith possède une vaste expérience dans la gestion de problèmes de travail complexes liés aux actions de conflit décrites dans cet article pour de nombreux clients au Japon. Notre cabinet compte plusieurs experts qui, en plus d’être qualifiés comme avocats au Japon, possèdent également des qualifications d’avocats étrangers et sont anglophones, ce qui leur permet de comprendre profondément les défis uniques auxquels sont confrontées les entreprises internationales. Du stade de la négociation collective à la réponse après une action de conflit, et même jusqu’au procès, nous pouvons fournir un soutien juridique stratégique et pratique pour protéger au maximum les intérêts de nos clients. Si vous rencontrez des problèmes liés au droit du travail japonais, n’hésitez pas à nous consulter.
Category: General Corporate