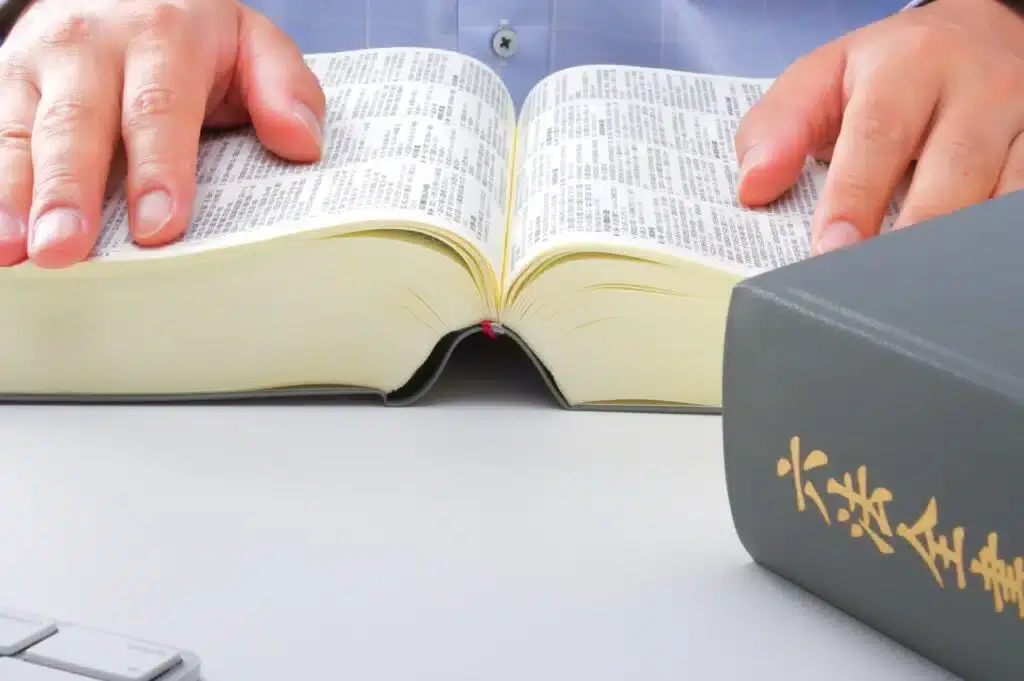Protection des droits des actionnaires minoritaires dans le droit des sociétés japonais et les droits des actionnaires minoritaires

La loi sur les sociétés japonaises (日本の会社法) met en évidence les droits des actionnaires des sociétés par actions, en mettant particulièrement l’accent sur la protection des actionnaires minoritaires. Cela fournit un mécanisme essentiel pour que les actionnaires minoritaires puissent protéger leurs intérêts contre des décisions de gestion injustes ou des actes frauduleux sous le principe de la majorité en vigueur lors des assemblées générales des actionnaires. Dans les sociétés cotées, les actionnaires peuvent exprimer leur mécontentement en vendant leurs actions, ce qui est connu sous le nom de “règle de Wall Street”, mais dans les sociétés non cotées ou dans certaines situations, il n’est pas facile de vendre des actions. Dans de tels cas, les droits des actionnaires minoritaires, tels que définis par la loi sur les sociétés, deviennent un moyen indispensable pour les actionnaires de protéger leur investissement et de surveiller la gestion saine de l’entreprise.
La loi sur les sociétés japonaises (会社法), promulguée en 2005 (Heisei 17 (2005)), a introduit de nouvelles formes de sociétés telles que la société en commandite par actions et a renforcé le “droit de retrait” des actionnaires, enrichissant ainsi le cadre de protection des actionnaires minoritaires. Cela montre que les législateurs reconnaissent l’importance de protéger les intérêts des actionnaires non seulement par les mécanismes du marché, mais aussi par des moyens légaux. Cet article explique en détail les principaux droits des actionnaires minoritaires tels que les demandes d’injonction, les demandes de révocation des dirigeants et les demandes d’inspection des livres comptables, en s’appuyant sur des lois et des cas de jurisprudence spécifiques au Japon. Comprendre ces droits est extrêmement important pour saisir l’environnement de gouvernance d’entreprise au Japon et élaborer des stratégies d’investissement.
Vue d’ensemble des droits des actionnaires minoritaires dans le droit des sociétés japonais
Les droits des actionnaires minoritaires désignent les droits que seuls les actionnaires détenant un certain pourcentage ou nombre d’actions d’une société par actions peuvent exercer. Ces droits sont accordés pour permettre aux actionnaires minoritaires de surveiller et superviser la gestion de l’entreprise sous le principe de la majorité en assemblée générale, et de protéger leurs intérêts contre des décisions injustes. Le but ultime est d’assurer la transparence de la gestion, de dénoncer les actes illicites ou les violations des lois par les administrateurs, et de protéger les intérêts de l’ensemble des actionnaires, favorisant ainsi le développement durable de l’entreprise.
Le droit des sociétés au Japon établit divers droits pour les actionnaires minoritaires en fonction du nombre d’actions détenues et du pourcentage de droits de vote. Ces exigences sont mises en place pour permettre une surveillance et une supervision effectives tout en prévenant l’abus de ces droits. Dans le cas des sociétés cotées, une période de détention continue de six mois est souvent requise. Les actionnaires doivent comprendre que le niveau d’influence et de protection qu’ils peuvent exercer sur l’entreprise varie en fonction du pourcentage d’actions qu’ils détiennent. Par exemple, en détenant 3% des droits de vote, un actionnaire peut exercer des pouvoirs de surveillance importants, tels que la demande de consultation des livres comptables ou l’introduction d’une action en révocation des dirigeants. Cela sert également de guide pour les investisseurs qui acquièrent des actions de manière stratégique afin d’exercer certains droits. L’exigence de la période de détention continue encourage également l’engagement des actionnaires dans une perspective à long terme plutôt que pour des objectifs spéculatifs à court terme.
Ci-dessous, nous résumons les principaux droits des actionnaires minoritaires dans le droit des sociétés japonais et leurs conditions d’exercice.
| Type de droit | Article de référence | Conditions d’exercice | Période de détention continue | Objectif & Résumé |
| Droit de consultation du registre des actionnaires | Article 121 de la Loi sur les sociétés | Au moins une unité d’actions | Non requis | Droit de demander la consultation et la transcription du registre des actionnaires |
| Droit de consultation des procès-verbaux du conseil d’administration | Article 371 de la Loi sur les sociétés | Au moins une unité d’actions | Non requis (autorisation judiciaire nécessaire) | Droit de demander, avec l’autorisation du tribunal, la consultation et la transcription des procès-verbaux du conseil d’administration |
| Droit de demande de nomination d’un inspecteur des assemblées générales | Article 306 de la Loi sur les sociétés | Au moins une unité d’actions | Plus de 6 mois | Droit de demander au tribunal la nomination d’un inspecteur pour enquêter sur les procédures de convocation et les méthodes de résolution des assemblées générales |
| Droit de proposition des actionnaires | Article 303 de la Loi sur les sociétés | Au moins 1% des droits de vote totaux ou plus de 300 droits de vote | Plus de 6 mois (dans le cas d’une société cotée) | Droit de proposer des sujets ou des motions à l’assemblée générale des actionnaires |
| Droit de demande de consultation des livres comptables | Article 433 de la Loi sur les sociétés | Au moins 3% des droits de vote totaux ou 3% des actions émises | Non requis | Droit de demander la consultation et la transcription des livres comptables et des documents connexes de la société |
| Droit de demande de nomination d’un inspecteur de l’exécution des affaires | Article 358 de la Loi sur les sociétés | Au moins 3% des droits de vote totaux | Non requis | Droit de demander au tribunal la nomination d’un inspecteur en cas de suspicion de malversation dans l’exécution des affaires de la société |
| Droit d’opposition à l’exonération de responsabilité des dirigeants | Article 426 de la Loi sur les sociétés | Au moins 3% des droits de vote totaux | Non requis | Droit de s’opposer à l’exonération de responsabilité des dirigeants décidée par le conseil d’administration |
| Droit d’intenter une action en révocation des dirigeants | Article 854 de la Loi sur les sociétés | Au moins 3% des droits de vote totaux | Plus de 6 mois | Droit d’intenter une action en justice pour la révocation des dirigeants dont la destitution a été rejetée en assemblée générale |
| Droit de demande de convocation d’une assemblée générale extraordinaire | Article 297 de la Loi sur les sociétés | Au moins 3% des droits de vote totaux | Plus de 6 mois | Droit de demander la convocation d’une assemblée générale extraordinaire |
| Droit d’intenter une action en dissolution de la société | Article 833 de la Loi sur les sociétés | Au moins 10% des droits de vote totaux ou 10% des actions émises | Non requis | Droit de demander au tribunal la dissolution de la société en cas de motifs impérieux |
| Droit de demande d’assemblée générale pour l’émission d’actions nouvelles | Article 244-2 de la Loi sur les sociétés | Au moins 10% des droits de vote totaux | Non requis (dans le cas d’une société cotée) | Droit d’exiger une résolution en assemblée générale lors de l’émission d’actions nouvelles pouvant changer le contrôle de la société |
| Droit d’intenter une action représentative multiple | Article 847-3 de la Loi sur les sociétés | Actionnaires minoritaires de la société mère ultime, etc. (sous certaines conditions) | Plus de 6 mois | Droit pour les actionnaires minoritaires de la société mère ultime d’intenter une action en responsabilité contre ses filiales complètes, etc. |
La demande d’injonction sous le droit des sociétés japonais
La demande d’injonction est un droit permettant aux actionnaires d’une société de demander en justice l’arrêt d’actes réalisés par les directeurs ou les exécutifs de la société qui violent les lois ou les statuts et qui pourraient causer un dommage irréparable à la société. Ce droit est fondé sur l’article 360, paragraphe 1, du droit des sociétés japonais (Japanese Companies Act) et fonctionne comme une mesure préventive importante pour assurer la légalité de la gestion des affaires de la société.
En particulier, la demande d’injonction contre l’émission d’actions nouvelles est fréquemment un sujet de préoccupation du point de vue de la protection des actionnaires minoritaires. Cela concerne le droit des actionnaires de demander l’arrêt de l’émission d’actions nouvelles par une société par actions qui viole les lois ou les statuts, ou qui est réalisée par des moyens considérablement injustes, et qui pourrait désavantager les actionnaires. Ce droit est stipulé dans l’article 210 du droit des sociétés japonais.
Pour qu’une telle demande soit acceptée, il est nécessaire de satisfaire deux conditions. La première est que l’émission des nouvelles actions soit « en violation des lois ou des statuts, ou réalisée par des moyens considérablement injustes », et la seconde est qu’il existe un « risque de désavantage pour les actionnaires ».
Dans l’évaluation de ce qui constitue une « méthode considérablement injuste », la « règle de l’objectif principal » est un critère important. Elle s’applique lorsque l’objectif principal de l’émission de nouvelles actions n’est pas de lever des fonds de manière légitime, mais de maintenir le contrôle de la société par la direction actuelle. Dans le droit des sociétés japonais, c’est l’assemblée générale des actionnaires qui nomme les directeurs, et il est considéré contraire à l’esprit de la loi que les directeurs manipulent la composition des actionnaires pour maintenir leur position. Cependant, si des besoins légitimes de financement ou un plan d’affaires rationnel existent, l’intention de maintenir le contrôle peut ne pas être jugée « considérablement injuste ».
De nombreux cas judiciaires se sont accumulés sur ce point.
- Décision du Tribunal de district de Tokyo du 25 juillet 1989 (affaire Inageya-Tadamiya) : Cette décision a jugé que l’émission de nouvelles actions en grande quantité à un tiers dans le but principal de diminuer la part d’un actionnaire spécifique et de maintenir le contrôle de la direction actuelle dans un contexte de lutte pour le contrôle de la société était une émission injuste.
- Décision de la Cour d’appel de Tokyo du 4 août 2004 : Bien que l’intention de la direction actuelle de maintenir le contrôle ait été mise en doute, la nécessité de lever des fonds pour un plan d’affaires et la rationalité de ce plan ont été reconnues. Par conséquent, même si l’intention de maintenir le contrôle existait, elle n’a pas été jugée prévaloir sur l’intention légitime de développer la société et n’a donc pas été considérée comme une émission d’actions par des moyens considérablement injustes.
- Décision de la Cour d’appel de Tokyo du 23 mars 2005 : Cette décision a établi que l’émission de nouveaux droits de souscription d’actions avec le but principal de maintenir et de sécuriser le contrôle de la gestion est en principe considérée comme une méthode « considérablement injuste ». Cependant, exceptionnellement, si des circonstances particulières justifient la « protection des intérêts de l’ensemble des actionnaires », telles que l’intention de dévorer la société, une gestion destructrice, l’utilisation abusive des actifs de la société ou l’intention de vendre des actions à un prix excessivement élevé, l’émission ne doit pas être considérée comme injuste.
- Décision de la Cour suprême du 7 août 2007 : Cette décision a statué que le principe de l’égalité des actionnaires vise à protéger les intérêts de chaque actionnaire, mais que si l’existence ou le développement de la société est entravé et que la valeur de l’entreprise est susceptible d’être endommagée, le traitement discriminatoire d’un actionnaire spécifique n’est pas immédiatement contraire au principe, tant qu’il ne manque pas de proportionnalité et ne va pas à l’encontre des principes d’équité. La question de savoir si la valeur de l’entreprise est endommagée doit finalement être décidée par l’assemblée générale des actionnaires, et cette décision doit être respectée tant qu’elle ne présente pas de défauts majeurs.
- Décision du Tribunal de district de Tokyo du 23 juin 2008 : Cette décision a indiqué que l’émission d’actions nouvelles par attribution à des tiers dans une société ouverte est reconnue comme un exercice de jugement de gestion et que la diminution de la part des actionnaires existants n’est pas immédiatement préjudiciable. Cependant, si un conflit existe concernant le contrôle de la société et qu’un nombre significatif de nouvelles actions est émis, affectant de manière significative la part des actionnaires existants et ayant pour but principal de maintenir le contrôle, cela est considéré comme préjudiciable.
- Décision de la Cour d’appel de Tokyo du 16 octobre 2024 : Un exemple où une demande de mesure conservatoire pour arrêter un échange d’actions a été rejetée, ce qui donne un aperçu des tendances des tribunaux concernant la portée et les conditions d’application des demandes d’injonction.
Ces cas judiciaires clarifient que les demandes d’injonction contre l’émission de nouvelles actions sont jugées non seulement sur la base de violations formelles de la loi, mais en tenant compte de manière globale de l’objectif réel et de l’impact sur les actionnaires. En particulier, dans le contexte des luttes pour le contrôle, les tribunaux ont tendance à examiner rigoureusement tout en respectant le pouvoir discrétionnaire de la direction, du point de vue de la protection des intérêts de l’ensemble des actionnaires.
Demande de révocation d’un dirigeant sous le droit japonais
Un administrateur d’une société par actions peut être révoqué à tout moment par une résolution ordinaire de l’assemblée générale des actionnaires, comme le stipule l’article 339, paragraphe 1, de la loi japonaise sur les sociétés. Cependant, même si l’assemblée générale des actionnaires ne parvient pas à obtenir une majorité de voix en faveur de la révocation, la loi japonaise sur les sociétés accorde aux actionnaires minoritaires le droit d’intenter une action en justice pour demander la révocation d’un dirigeant. Ce droit peut être exercé par les actionnaires détenant au moins 3% des droits de vote de manière continue pendant les six mois précédents.
Pour qu’une telle demande soit acceptée, il faut que le dirigeant visé par la révocation ait commis des actes illicites dans l’exercice de ses fonctions ou des faits graves en violation des lois ou des statuts de la société. L’interprétation de ces « faits graves » peut varier selon les cas individuels et est soumise à l’appréciation des tribunaux.
Voici quelques exemples concrets de jurisprudence :
- Jugement du Tribunal de district de Tokyo en date du 22 avril 2021 : Dans ce jugement, la demande de révocation d’un administrateur, condamné en Corée pour abus de confiance dans l’exercice de ses fonctions au sein d’une société affiliée, a été rejetée par des actionnaires minoritaires. Le tribunal a estimé que l’implication du dirigeant dans l’acte criminel était subordonnée et passive et que les dommages matériels avaient été réparés par le biais d’une indemnisation. Ce jugement suggère qu’une condamnation pénale pour un acte criminel commis dans l’exercice des fonctions d’un dirigeant ne mène pas automatiquement à l’acceptation d’une demande de révocation. Le tribunal examine en détail les circonstances individuelles, en particulier le degré d’implication du dirigeant et l’état de la réparation des dommages, et évalue prudemment la « gravité » de l’impact de l’acte sur la gestion de l’entreprise.
- Jugement de la Cour d’appel de Takamatsu en date du 28 mai 1953 : Ce jugement concerne un cas où un administrateur, qui était également président, n’a pas soumis sa propre révocation à l’ordre du jour ni au vote, et a déterminé que cela ne répondait pas aux critères de rejet d’une proposition de révocation.
- Jugement du Tribunal de district de Tokyo en date du 24 décembre 2013 : Un cas où une demande de révocation d’un administrateur a été acceptée sur la base de fausses facturations à la société.
- Jugement du Tribunal de district de Tokyo en date du 26 novembre 2013 : Un cas où une demande de révocation d’un administrateur a été acceptée en raison de maquillage de bilan.
- Jugement du Tribunal de district de Tokyo en date du 14 mai 2012 : Un cas où une demande de révocation d’un administrateur a été acceptée pour l’appropriation de biens de la société, entre autres raisons.
- Jugement du Tribunal de district de Tokyo en date du 24 avril 2014 : Un cas où la révocation d’un auditeur nominal a été jugée pour « motif valable ».
- Jugement du Tribunal de district de Tokyo en date du 26 juin 2024 : Un cas où la violation par un administrateur de son obligation de non-concurrence a été reconnue, et où le tribunal a rendu une décision concernant la demande de rémunération d’un administrateur après l’expiration de son mandat.
Ces exemples de jurisprudence montrent que la demande de révocation d’un dirigeant est un mécanisme permettant de destituer de force, par le biais d’une décision judiciaire, un dirigeant dont la révocation serait difficile à obtenir par un vote majoritaire de l’assemblée générale des actionnaires. En même temps, il est évident que les tribunaux évaluent non seulement les violations formelles, mais aussi la « gravité » des actes et leur impact réel sur la société, afin de rendre une décision prudente et d’éviter tout abus de droit.
Droit de consultation des livres comptables sous le droit japonais
Le droit de consultation des livres comptables est l’un des droits fondamentaux des actionnaires minoritaires pour surveiller la gestion d’une entreprise et vérifier l’absence de fraude. Ce droit permet aux actionnaires, pendant les heures d’ouverture de l’entreprise et en justifiant leur demande, de consulter ou de demander des copies des livres comptables ou des documents y afférents. Ce droit est établi par l’article 433 du Code des sociétés japonais.
Les actionnaires qui peuvent exercer ce droit sont ceux qui détiennent au moins un centième de la totalité des droits de vote des actionnaires ou au moins un centième des actions émises (à l’exclusion des actions propres). De plus, les actionnaires d’une société mère d’une société par actions peuvent également faire une demande similaire, à condition d’obtenir l’autorisation du tribunal, si cela est nécessaire pour exercer leurs droits.
Cependant, une entreprise peut refuser cette demande si elle correspond à des motifs de refus spécifiques énoncés dans le paragraphe 2 de l’article 433 du Code des sociétés japonais. Les principaux motifs de refus incluent les suivants :
- Lorsque le demandeur a fait la demande dans le but de communiquer des faits appris par la consultation ou la copie des livres comptables à des tiers pour en tirer profit, ou s’il a fait une telle communication au cours des deux dernières années.
- Lorsque le demandeur est engagé dans une entreprise en concurrence substantielle avec celle de la société. Cela est dû au fait que les livres comptables peuvent contenir des secrets d’entreprise importants tels que le coût des produits, les fournisseurs de matières premières et les clients, et que leur consultation par des concurrents pourrait nuire considérablement aux intérêts de l’entreprise.
- Lorsque la demande a pour but de perturber les opérations de l’entreprise.
- Lorsque le demandeur a déjà abusé de ce droit dans le passé.
Le recours collectif des actionnaires sous le droit japonais
Le recours collectif des actionnaires est une action en justice où les actionnaires poursuivent en justice les dirigeants d’une entreprise, tels que les administrateurs, les commissaires aux comptes, les directeurs exécutifs ou les auditeurs comptables (ci-après dénommés « dirigeants, etc. »), qui ont violé leurs obligations professionnelles et causé un préjudice à l’entreprise, mais pour lesquels l’entreprise elle-même n’a pas engagé de poursuites. Ce mécanisme, établi par l’article 847 du Code des sociétés japonais, joue un rôle extrêmement important en renforçant la fonction de surveillance contre la fraude et la négligence de la direction et en protégeant les intérêts de l’entreprise.
Pour intenter un recours collectif des actionnaires, plusieurs conditions doivent être remplies. Tout d’abord, l’actionnaire qui souhaite porter plainte doit détenir des actions de manière continue pendant au moins six mois dans le cas d’une société cotée. Ensuite, l’actionnaire doit d’abord demander par écrit à l’entreprise d’engager des poursuites contre les dirigeants, etc. L’entreprise dispose alors d’un délai de 30 jours après cette demande pour décider si elle intente ou non une action en justice. Cependant, si l’expiration de ce délai de 30 jours risque de causer un dommage irréparable à l’entreprise, l’exigence de cette demande préalable peut être levée.
Concernant la portée de la « responsabilité des administrateurs » qui peut faire l’objet d’un recours collectif des actionnaires, deux principales théories, la théorie de la responsabilité totale et la théorie de la responsabilité limitée, se sont longtemps opposées. La théorie de la responsabilité totale soutient que toutes les dettes qu’un administrateur a envers l’entreprise peuvent faire l’objet d’un recours collectif des actionnaires, en se basant principalement sur le fait que le risque que l’entreprise néglige de poursuivre les dirigeants, etc. existe indépendamment de la cause de la dette. D’autre part, la théorie de la responsabilité limitée soutient que les poursuites ne devraient viser que certaines responsabilités, par exemple celles qui sont difficiles ou impossibles à exonérer, respectant ainsi le pouvoir discrétionnaire de l’entreprise dans ses décisions de gestion.
Le recours collectif des actionnaires a connu une augmentation spectaculaire de son utilisation après la réforme du Code de commerce de 1993, qui a réduit considérablement les frais de justice pour intenter une telle action à un montant forfaitaire de 8 200 yens (à l’époque), indépendamment du montant réclamé. Cela a permis de fonctionner comme un puissant moyen de dissuasion contre les actes répréhensibles de la direction. Cependant, les actions intentées à des fins inappropriées ou dans le but de nuire à l’entreprise peuvent être rejetées conformément à l’article 847, paragraphe 1, du Code des sociétés japonais. Ce mécanisme est un moyen important pour les actionnaires, en tant que propriétaires de l’entreprise, de superviser les actions de la direction et de protéger activement les intérêts de l’entreprise, jouant ainsi un rôle central dans la gouvernance d’entreprise au Japon.
Le droit de proposition des actionnaires sous le droit japonais
Le droit de proposition des actionnaires est le droit permettant aux actionnaires de proposer certains sujets à l’ordre du jour de l’assemblée générale des actionnaires et de demander à l’entreprise d’inclure ces propositions dans l’avis de convocation. Ce système a été introduit dans le droit commercial japonais en 1981 (Showa 56) dans le but de prévenir la formalisation des assemblées générales d’actionnaires, de renforcer les droits des actionnaires et de promouvoir une communication constructive entre les actionnaires et l’entreprise.
Pour exercer ce droit, plusieurs conditions doivent être remplies. Dans le cas d’une société cotée, l’actionnaire qui souhaite faire une proposition doit détenir au moins 1% du total des droits de vote ou plus de 300 droits de vote de manière continue pendant les six mois précédant la proposition. Pour les sociétés non cotées avec un conseil d’administration, la période de détention continue de six mois n’est pas requise. De plus, la proposition des actionnaires doit être soumise à l’entreprise au moins huit semaines avant l’assemblée générale des actionnaires concernée. Le nombre de propositions qu’un actionnaire peut faire est limité à dix par personne, conformément à l’article 305, paragraphe 4, de la loi japonaise sur les sociétés.
L’entreprise peut refuser une proposition d’actionnaire pour des raisons spécifiques, telles que :
- Si la proposition viole les lois ou les statuts (Loi sur les sociétés japonaises, article 304, proviso, et article 305, paragraphe 4).
- Si une proposition substantiellement identique a été rejetée lors d’une assemblée générale des actionnaires au cours des trois dernières années sans obtenir l’approbation d’au moins un dixième des droits de vote totaux des actionnaires.
- Si les motifs de la proposition sont clairement faux ou si elle vise uniquement à diffamer ou à insulter quelqu’un (Règlement d’exécution de la loi sur les sociétés, article 93, paragraphe 1, point 3).
- Si l’exercice du droit de proposition des actionnaires est considéré comme un abus de droit.
Récemment, le nombre de propositions d’actionnaires lors des assemblées générales au Japon a considérablement augmenté. Cela est en partie dû à l’assouplissement des conditions d’exercice du droit de proposition des actionnaires, suite à la modification du système de l’action unitaire en 2018 (passant de 1 000 à 100 actions) et à l’augmentation des divisions d’actions résultant de la demande de réduction du montant minimum d’investissement par la Bourse de Tokyo. Cette augmentation suggère que le dialogue constructif et les propositions des investisseurs individuels sont en hausse, ce qui est perçu comme un moteur de l’évolution de la gouvernance d’entreprise au Japon.
Autres droits des actionnaires minoritaires sous le droit des sociétés japonais
En plus des droits détaillés précédemment, la loi japonaise sur les sociétés (会社法) établit divers droits pour protéger les actionnaires minoritaires.
- Droit de demander la convocation d’une assemblée générale extraordinaire : les actionnaires détenant plus de 3% des droits de vote total pendant au moins six mois peuvent demander à la société de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour discuter de questions importantes concernant les opérations ou les biens de la société. Ce droit assure aux actionnaires l’opportunité d’exprimer directement leur opinion sur la gestion de l’entreprise lorsque la direction ne convoque pas d’assemblée générale.
- Droit de s’opposer à la réduction de la responsabilité des dirigeants : les actionnaires détenant plus de 3% des droits de vote total peuvent exprimer une objection lorsque le conseil d’administration décide d’exonérer les dirigeants de leur responsabilité envers la société. Si une objection est soulevée, l’exonération de responsabilité décidée par le conseil d’administration ne peut pas être effectuée. C’est un pouvoir de surveillance important pour empêcher la direction de se soustraire indûment à sa responsabilité et pour protéger les intérêts des actionnaires.
- Droit d’intenter une action en dissolution de la société : les actionnaires détenant plus de 10% des droits de vote total peuvent demander la dissolution de la société en justice si la société se trouve dans une situation extrêmement difficile dans l’exécution de ses opérations et qu’il existe un risque de dommages irréparables, ou si la gestion et la disposition des biens de la société sont gravement inappropriées, mettant en péril l’existence de la société pour des raisons « inévitables ». Cela offre un recours ultime pour les actionnaires lorsque la survie de la société devient préjudiciable à leurs intérêts.
- Droit d’intenter une action en représentation multiple : l’article 847-3 de la loi japonaise sur les sociétés permet aux actionnaires minoritaires de la société mère ultime, sous certaines conditions, d’intenter une action contre les dirigeants de sa filiale complète pour poursuivre leur responsabilité. Cela permet aux actionnaires de la société mère de poursuivre directement les actes répréhensibles des dirigeants de la filiale dans une structure de groupe complexe, jouant un rôle dans le renforcement de la gouvernance d’entreprise à travers le groupe.
Ces droits constituent un mécanisme de protection multicouche permettant aux actionnaires minoritaires d’exercer une influence sur la gestion de la société et de corriger les comportements inappropriés.
Résumé
La protection des droits des actionnaires minoritaires en vertu de la loi japonaise sur les sociétés est un élément essentiel pour les investisseurs étrangers qui investissent dans des entreprises au Japon. Une gamme étendue de droits, tels que les demandes d’injonction, les actions en destitution des dirigeants, les demandes d’inspection des livres comptables, les actions en représentation des actionnaires et les droits de proposition des actionnaires, fournissent des moyens juridiques puissants pour que les actionnaires surveillent la gestion de l’entreprise et protègent leurs intérêts contre des actes injustes. Ces droits ne sont pas seulement énoncés dans la législation, mais leur interprétation a été approfondie à travers de nombreux cas juridiques, établissant leur application pratique. En particulier, les concepts tels que les conditions d’exercice des droits, les motifs de refus et l’« abus de droit » ont été dotés d’une signification concrète par les décisions judiciaires, augmentant la prévisibilité pour les actionnaires et les entreprises.
Le cabinet d’avocats Monolith possède une vaste expérience dans une large gamme de services juridiques liés aux droits des actionnaires minoritaires sous le droit des sociétés japonais. Notre cabinet compte plusieurs avocats parlant anglais et qualifiés dans des juridictions étrangères, capables d’expliquer le système juridique complexe du Japon à nos clients internationaux de manière compréhensible et de fournir un soutien juridique efficace.
Category: General Corporate