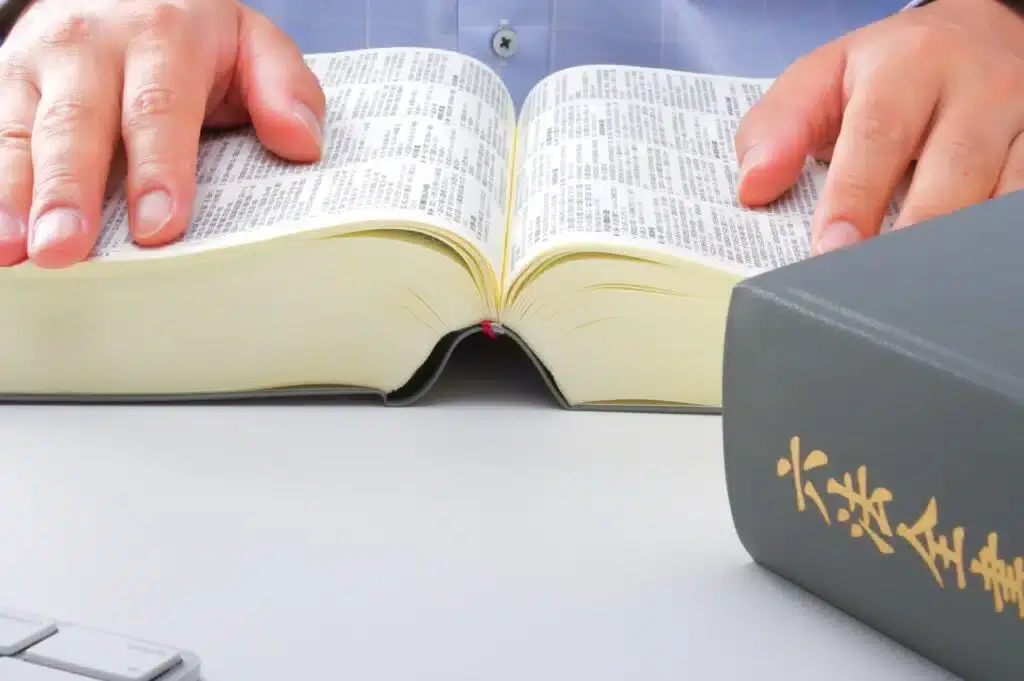Le cadre de la gestion de l'immigration et du séjour au Japon : Aperçu juridique et administratif

La circulation des personnes au-delà des frontières japonaises est réglementée de manière exhaustive par une loi japonaise intitulée « Loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié » (出入国管理及び難民認定法). Cette loi énonce dans son article premier que son objectif est de « gérer de manière équitable l’entrée et la sortie de toutes les personnes entrant ou sortant du territoire national, ainsi que le séjour de tous les étrangers résidant dans le pays ». Le terme « gestion équitable » symbolise l’équilibre entre deux intérêts nationaux essentiels que l’administration japonaise de l’immigration s’efforce de poursuivre. D’une part, il est nécessaire d’accueillir sans heurts des talents compétents, des capitaux et des visiteurs indispensables à la vitalisation de l’économie, à l’innovation technologique et au maintien de la position du Japon dans la communauté internationale. D’autre part, il est tout aussi important de maintenir un système de gestion rigoureux pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public et le marché du travail intérieur. Ce principe fondamental d’équilibre entre promotion et régulation guide la conception de l’ensemble du système de gestion de l’immigration au Japon, depuis les pouvoirs de l’Agence des services d’immigration et de résidence jusqu’aux conditions d’entrée pour les individus étrangers. Par conséquent, pour comprendre ce système, il est essentiel de saisir non seulement les procédures individuelles, mais aussi la philosophie juridique et la structure administrative qui les sous-tendent.
Les principes fondamentaux de la gestion des entrées et sorties au Japon
Le principe juridique le plus fondamental qui soutient l’ensemble du système de gestion des entrées et sorties au Japon est celui de la souveraineté nationale. Ce principe repose sur l’idée, établie par le droit international coutumier, qu’un État a le droit souverain de refuser l’entrée sur son territoire à des étrangers susceptibles de nuire à sa sécurité ou à ses intérêts. Plus précisément, le pouvoir de décider quels étrangers peuvent entrer sur le territoire d’un État et dans quelles conditions est généralement laissé à la discrétion de cet État. Une conséquence importante de ce principe de droit international est que pour un étranger, entrer et séjourner au Japon n’est pas un droit inné garanti, mais plutôt une sorte de permission accordée à la discrétion du gouvernement japonais. Cette notion ne se limite pas à une théorie juridique abstraite. Elle constitue la source de légitimité juridique qui, comme le montre l’arrêt de l’affaire McClean, permet aux tribunaux japonais d’accorder aux autorités administratives, y compris au ministre de la Justice, un très large pouvoir discrétionnaire en matière de renouvellement de permis de séjour et d’autres questions similaires. Comprendre ce principe fondamental de souveraineté nationale est la clé pour saisir pourquoi le système de gestion des entrées et sorties au Japon accorde une grande marge de manœuvre discrétionnaire aux organes administratifs.
L’organisation en charge de la gestion de l’immigration au Japon : l’Agence des Services d’Immigration et de Résidence
L’Agence des Services d’Immigration et de Résidence, un organisme spécialisé dans l’administration des affaires d’immigration, est établie au sein du Ministère de la Justice au Japon. Cette organisation est communément connue sous l’abréviation “Immigration”. En avril 2019 (ère Reiwa 1), le Bureau de l’Immigration, qui était auparavant une division interne du Ministère de la Justice, a été restructuré en une agence externe avec des pouvoirs et une indépendance accrus, devenant l’Agence des Services d’Immigration et de Résidence. Cette réorganisation reflète une augmentation qualitative et quantitative des défis auxquels l’administration de l’immigration est confrontée, tels que l’augmentation significative du nombre d’étrangers résidant au Japon et la création de nouveaux statuts de résidence pour répondre à la pénurie de main-d’œuvre de plus en plus grave. Ce changement n’est pas seulement un changement de nom ; il reflète un tournant important dans la stratégie nationale du Japon, visant à équilibrer la demande d’accueil d’étrangers pour sécuriser la main-d’œuvre et la demande de maintien de la sécurité nationale et de l’ordre social.
Les principales fonctions de l’Agence des Services d’Immigration et de Résidence se divisent en quatre piliers. Premièrement, le “contrôle des entrées et sorties” dans les aéroports et les ports maritimes, qui constitue le cœur des mesures frontalières pour gérer les étrangers qui souhaitent entrer au Japon et ceux qui en sortent. Deuxièmement, la “révision et la gestion de la résidence”, qui implique l’examen des demandes de renouvellement de la période de résidence et de changement de statut de résidence des étrangers déjà présents au Japon, ainsi que la gestion des données relatives aux résidents étrangers. Troisièmement, le “soutien à la résidence”, une fonction relativement nouvelle qui fournit des informations et des conseils pour aider les étrangers à vivre harmonieusement en tant que membres de la société japonaise, y compris l’exploitation des Centres de soutien à la résidence pour étrangers (FRESC). Quatrièmement, l'”examen des infractions et l’expulsion”, qui consiste à enquêter sur les étrangers en violation de la loi japonaise sur l’immigration et le statut de réfugié et, si nécessaire, à procéder à des mesures d’expulsion du pays.
La transformation de cette structure organisationnelle a une signification qui va au-delà de la simple réorganisation administrative. Elle indique que l’organisme chargé de la gestion de l’immigration assume désormais officiellement, en plus de son rôle traditionnel de gestion et de contrôle stricts, un rôle de soutien à l’accueil et à l’intégration des étrangers dans la société. Ce double rôle est un choix stratégique pour répondre aux changements démographiques auxquels le Japon est confronté et aux nécessités économiques.
| Élément | Ancien Bureau de l’Immigration | Agence actuelle des Services d’Immigration et de Résidence |
| Statut juridique | Division interne du Ministère de la Justice | Agence externe du Ministère de la Justice |
| Rôle principal | Principalement axé sur le contrôle de l’immigration et l’exécution de la loi | Rôles élargis incluant la gestion de l’immigration, la gestion de la résidence, le soutien à la résidence et l’ajustement stratégique |
| Portée de l’autorité | Fonctionne en tant que partie du Ministère de la Justice | Institution dotée d’une autorité et d’un budget renforcés, avec une fonction de commandement |
Le processus d’entrée : les procédures d’atterrissage au Japon
Pour entrer au Japon, les étrangers doivent obtenir une autorisation d’atterrissage en suivant un processus légal. Ce processus est fondé sur les “conditions d’atterrissage” définies à l’article 7 de la loi japonaise sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié, qui énonce clairement cinq exigences que les étrangers doivent remplir pour être autorisés à atterrir.
Premièrement, il est requis de posséder un passeport valide et, en principe, un visa valide délivré par le chef d’une mission diplomatique à l’étranger ou par le ministre des Affaires étrangères. Deuxièmement, les informations fournies dans la demande doivent être véridiques concernant les activités prévues au Japon. Troisièmement, ces activités doivent correspondre à l’une des catégories de statut de résidence définies par la loi japonaise sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié. Quatrièmement, la durée prévue du séjour au Japon doit être conforme aux dispositions légales. Enfin, cinquièmement, il ne faut pas être sujet aux motifs de refus d’atterrissage qui seront mentionnés ultérieurement.
L’examen effectif est réalisé par des inspecteurs de l’immigration dans les ports d’entrée situés dans les aéroports et les ports maritimes du Japon. Les étrangers doivent fournir des informations d’identification personnelle telles que les empreintes digitales et la photographie du visage lors de la demande d’atterrissage. Ensuite, à travers un entretien avec l’inspecteur de l’immigration, il est évalué si les cinq conditions d’atterrissage mentionnées précédemment sont remplies. Si l’inspecteur de l’immigration détermine que toutes les conditions sont satisfaites, un cachet de “permission d’atterrissage” est apposé sur le passeport de l’étranger, ce qui lui permet alors d’atterrir légalement au Japon pour la première fois. Cette série de processus, allant de la demande de visa jusqu’à l’examen final à la frontière, est conçue pour s’assurer que les étrangers entrant au Japon répondent de manière fiable aux exigences légales.
Garantir l’équité et la sécurité : Motifs de refus d’entrée en territoire japonais
Parmi les cinq conditions requises pour l’entrée sur le territoire, celle qui joue un rôle crucial dans le maintien de la sécurité et de l’ordre public au Japon est l’exigence de ne pas être sujet à un motif de refus d’entrée. L’article 5 de la Loi japonaise sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié (Immigration Control and Refugee Recognition Act) énumère spécifiquement les types d’étrangers dont l’entrée ne devrait pas être autorisée, dans le but de protéger les intérêts de la société japonaise. Cette disposition assure légalement l’aspect de « contrôle rigoureux » dans la gestion de l’immigration.
Les motifs de refus d’entrée sont variés, mais selon la classification de l’Agence des services d’immigration et de résidence au Japon, ils peuvent être principalement répartis en plusieurs catégories. La première concerne les personnes dont l’entrée est indésirable d’un point de vue de santé publique, incluant par exemple les patients atteints de certaines maladies infectieuses. La deuxième catégorie comprend les individus considérés comme ayant une forte antisocialité, tels que les membres d’organisations criminelles. La troisième catégorie regroupe ceux qui ont été précédemment expulsés du Japon ou qui ont été condamnés pour des crimes graves à l’intérieur ou à l’extérieur du Japon. Cela constitue un critère important pour évaluer le risque de récidive et la conformité avec l’ordre juridique japonais. La quatrième catégorie concerne les personnes susceptibles de commettre des actes nuisibles aux intérêts nationaux ou à la sécurité publique du Japon, comme les terroristes ou ceux engagés dans des activités d’espionnage. Enfin, la cinquième catégorie s’applique sur la base de la réciprocité. Ces dispositions démontrent que le contrôle des frontières japonaises fonctionne non seulement comme une gestion des mouvements de personnes mais aussi comme une ligne de défense essentielle pour protéger la nation contre diverses menaces.
Gestion des étrangers résidant au Japon
Lorsqu’un étranger obtient l’autorisation de débarquer et de résider au Japon, ses activités sont légalement définies par le « statut de résidence » déterminé au moment de son arrivée. Ce système de statut de résidence constitue le fondement de la gestion de la résidence, mais en parallèle, plusieurs obligations administratives importantes de déclaration sont imposées aux entreprises et aux étrangers eux-mêmes, dans le but de saisir avec précision la situation de résidence.
L’une d’elles est la « déclaration par l’organisation affiliée », basée sur l’article 19-16 de la loi japonaise sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance des réfugiés. Cette disposition oblige les entreprises qui emploient des étrangers résidant à moyen et long terme, ainsi que les institutions éducatives qui les accueillent, à déclarer à l’Agence des services d’immigration et de résidence, dans les 14 jours suivant le début ou la fin d’un contrat avec cet étranger (par exemple, lorsque l’employé démissionne).
En correspondance, l’article 19-17 de la même loi établit la « déclaration par le résident à moyen et long terme ». Cela impose à l’étranger lui-même l’obligation de déclarer, dans les 14 jours suivant l’événement, tout changement de nom ou d’adresse de l’organisation à laquelle il appartient, la disparition de l’organisation, ou son départ ou transfert de celle-ci.
Ces obligations de déclaration ne sont pas de simples procédures administratives. Elles fonctionnent comme un mécanisme de collecte de données extrêmement important, permettant au gouvernement de comprendre presque en temps réel les mouvements des talents étrangers à l’intérieur du Japon. En obtenant des informations à la fois des entreprises et des individus, cela garantit l’exactitude des données et permet de détecter rapidement si un étranger a potentiellement perdu la base légale de son séjour (par exemple, s’il n’a pas trouvé de nouvel emploi après avoir quitté son entreprise). Pour les entreprises, négliger cette déclaration n’est pas seulement une violation de la procédure, mais peut être considéré comme un manquement à la coopération avec le système de gestion de résidence qui constitue la base de la sécurité nationale et de la politique économique du pays, et peut entraîner une évaluation défavorable dans les futures demandes de statut de résidence.
De plus, lorsqu’un étranger résidant au Japon souhaite sortir temporairement du pays et y entrer à nouveau avec le même statut de résidence, il doit généralement obtenir au préalable une « autorisation de réentrée ». En utilisant ce système, établi par l’article 26 de la loi japonaise sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance des réfugiés, il est possible de réentrer en maintenant le statut de résidence qu’il avait avant de quitter le pays.
L’étendue du pouvoir discrétionnaire administratif : des cas de jurisprudence clés
Pour comprendre l’application de l’administration de l’immigration au Japon, il est extrêmement important de connaître les cas de jurisprudence de la Cour suprême qui définissent l’étendue du pouvoir discrétionnaire des autorités administratives, en particulier celui du Ministre de la Justice. Un cas emblématique est le jugement de la Cour suprême du 4 octobre 1978 (Showa 53), communément appelé l’arrêt McCarran. Dans cette affaire, la Cour suprême a reconnu que le Ministre de la Justice disposait d’un pouvoir discrétionnaire très étendu pour décider d’accorder ou non le renouvellement du permis de séjour d’un étranger.
La raison évoquée par la Cour était que pour décider de l’octroi ou du refus du renouvellement d’un permis de séjour, il est nécessaire de prendre en compte de manière globale non seulement la situation personnelle du demandeur, mais aussi des éléments d’une grande importance publique tels que la situation politique, économique et sociale au Japon, les relations internationales et les considérations diplomatiques. La Cour a conclu que de telles décisions hautement politiques devraient, de par leur nature, être laissées à la discrétion spécialisée et politique du Ministre de la Justice, responsable de l’administration de l’immigration.
De plus, ce jugement a strictement limité les cas dans lesquels le tribunal peut intervenir dans les décisions du Ministre de la Justice. La Cour a indiqué que le tribunal ne peut annuler une décision que si elle « manque totalement de fondement factuel ou si son inadéquation est clairement évidente au regard des normes sociales ». Ce seuil extrêmement élevé a pour effet de protéger largement les décisions administratives du contrôle judiciaire.
Les conséquences pratiques de ce précédent sont significatives. Elles impliquent que contester en justice une décision de refus de permis de séjour, par exemple, est extrêmement difficile. Par conséquent, pour que les entreprises puissent intégrer des talents étrangers en toute fluidité, il est stratégiquement essentiel d’adopter une approche préventive et proactive, plutôt que de compter sur des litiges a posteriori. Cela implique de préparer des documents convaincants qui répondent à tous les critères dès la phase de demande et de veiller scrupuleusement au respect des obligations de déclaration et autres exigences de conformité. Cet arrêt est l’exemple le plus clair de la manière dont le principe de souveraineté nationale est concrétisé dans les décisions judiciaires au Japon.
Résumé
Le système japonais de contrôle de l’immigration et de gestion de la résidence est un cadre juridique et administratif complexe, construit sur le principe de la souveraineté nationale et visant à équilibrer deux objectifs : les exigences économiques et la sécurité nationale. Son application est assurée par l’Agence des services d’immigration, une institution spécialisée qui opère sous la large discrétion du Ministre de la Justice, en cherchant à concilier rigueur et fluidité. Comprendre précisément ce système et y répondre adéquatement est un enjeu de gestion essentiel pour les entreprises qui se déploient à l’échelle mondiale.
Le cabinet d’avocats Monolith a une solide expérience dans le conseil à de nombreux clients nationaux sur des questions juridiques liées au système japonais de contrôle de l’immigration, comme expliqué dans cet article. Notre cabinet compte plusieurs experts qui, en plus de détenir des qualifications d’avocats japonais, possèdent également des qualifications d’avocats étrangers et parlent anglais, nous permettant d’offrir un soutien juridique complet qui intègre une compréhension approfondie du droit national et une perspective internationale. Si vous rencontrez des défis complexes liés à l’immigration et à la gestion de la résidence, n’hésitez pas à consulter notre cabinet.
Category: General Corporate