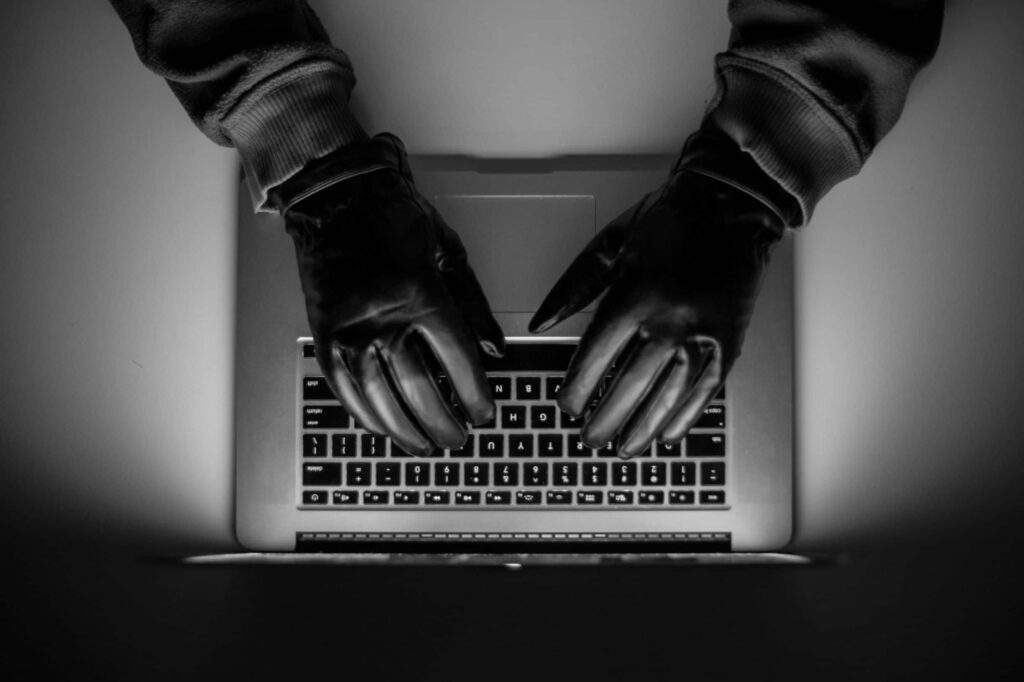Points juridiques sur la création d'entreprise au Japon : Autorité des fondateurs, acceptation des actifs, explication des paiements fictifs

La création d’une entreprise est la première étape pour lancer une nouvelle activité. Un rôle central dans cette phase cruciale est joué par le “promoteur”. Cependant, les pouvoirs du promoteur ne sont pas illimités. Le droit des sociétés japonais définit des limites aux pouvoirs du promoteur afin de protéger la société en formation, les futurs actionnaires et les partenaires commerciaux. En particulier, lors de la formation de la base financière de l’entreprise, des règles strictes sont établies. Le processus de création d’une entreprise n’est pas simplement une succession de démarches administratives, mais un acte qui construit le fondement juridique pour la santé future de l’entreprise. Pour prévenir les risques juridiques qui peuvent survenir au cours de ce processus, il est essentiel de comprendre précisément les réglementations du droit des sociétés.
L’une de ces réglementations est la “prise en charge des biens”. Il s’agit d’un contrat par lequel le promoteur s’engage à acquérir certains biens pour la société après sa création. Comme cette opération comporte des risques de préjudice injuste pour les biens de la société, le droit des sociétés japonais exige des procédures strictes telles que l’inscription dans les statuts ou l’examen par un inspecteur nommé par le tribunal. Négliger ces procédures peut entraîner l’invalidité du contrat, avec des conséquences juridiques graves.
Un autre thème important est le “faux versement de capital”. Il s’agit d’une action qui crée l’apparence que le capital social a été effectivement versé, falsifiant ainsi la base financière de l’entreprise. Selon la jurisprudence japonaise, même si de telles pratiques frauduleuses sont identifiées, tant qu’il y a un mouvement formel d’argent, le versement est considéré comme valide. Cependant, les promoteurs et les administrateurs impliqués peuvent non seulement être tenus de payer à nouveau l’argent à la société, mais ils peuvent également être sujets à des sanctions pénales.
Cet article se concentre sur trois thèmes importants dans le droit des sociétés japonais lors de la création d’une entreprise : “la portée des pouvoirs du promoteur”, “les exigences légales pour la prise en charge des biens” et “les conséquences juridiques du faux versement de capital”. Ces réglementations sont essentielles pour assurer le principe d’un capital suffisant, qui est la base d’une gestion saine de l’entreprise.
Les pouvoirs des fondateurs et leurs limites sous le droit japonais
Dans le processus de création d’une société, les fondateurs jouent un rôle central. Selon l’article 25, paragraphe 1 de la loi japonaise sur les sociétés (会社法), les fondateurs sont définis comme les personnes qui établissent les statuts, qui sont les règles fondamentales de la société, et qui les signent ou y apposent leur sceau. Les fondateurs ont le pouvoir d’agir en tant qu’organes d’une “société en formation” qui n’existe pas encore légalement, afin de réaliser les actes nécessaires à la constitution de la société.
Ce pouvoir inclut la création des statuts, la décision sur les types d’actions à émettre lors de la création, la souscription des actions pour devenir actionnaire, la nomination des administrateurs et des commissaires aux comptes au moment de la création, ainsi que la désignation des institutions financières pour la garde des fonds versés pour les actions. Toutes ces actions sont essentielles pour donner naissance légalement à la société et pour qu’elle puisse commencer ses activités.
Cependant, les pouvoirs des fondateurs sont strictement limités à l’objectif de “création de la société”. Les actes qui dépassent ce cadre ne sont généralement pas attribués à la société après sa création. Par exemple, les activités commerciales que la société devrait entreprendre après sa constitution, si elles sont initiées avant la formation de la société, sont généralement jugées hors du champ des pouvoirs des fondateurs. Cela pourrait inclure, par exemple, l’achat en gros de marchandises, la signature de contrats de location à long terme pour des biens immobiliers d’entreprise ou l’emprunt de sommes importantes.
La décision de savoir si les actes d’un fondateur se situent dans les limites de ses pouvoirs se fait sur la base de savoir s’ils sont objectivement nécessaires à la création de la société en tant qu'”actes préparatoires à l’ouverture”. À cet égard, un arrêt de la Cour suprême du Japon en date du 18 septembre 1973 (昭和48年) fournit une orientation importante. Cet arrêt a jugé que même les actes d’une société en formation, s’ils se situent dans le cadre de son objectif, c’est-à-dire s’ils sont objectivement nécessaires en tant qu’actes préparatoires à l’ouverture, sont attribués à la société après sa création. Inversement, les droits et obligations découlant de transactions qui dépassent ce cadre sont, en principe, attribués à la personne du fondateur qui a effectué l’acte, et la société après sa création n’est pas liée par ceux-ci. Par conséquent, les fondateurs doivent toujours faire attention à ce que leurs actes restent dans les limites de l’objectif de création de la société.
Les exigences strictes de l’acceptation de biens sous le droit des sociétés japonais
Pour assurer la base patrimoniale d’une entreprise, le droit des sociétés au Japon impose des régulations spéciales lorsque des biens autres que de l’argent sont apportés en tant que capital ou lorsque le patrimoine de l’entreprise est formé à travers certaines transactions. L’une de ces régulations concerne l’« acceptation de biens ».
L’acceptation de biens, telle que définie à l’article 28, paragraphe 2 du droit des sociétés japonais, est un contrat par lequel un promoteur accepte de recevoir certains biens d’un tiers spécifique, conditionnellement à la constitution de la société. Cela peut concerner, par exemple, l’achat prévu de biens immobiliers ou d’équipements industriels à utiliser dans l’entreprise après sa création, auprès d’une personne déterminée.
Bien que similaire à l’apport en nature (où des biens sont apportés en tant que capital au lieu d’un paiement en espèces), l’acceptation de biens est juridiquement différente. Elle suppose un processus en deux étapes : d’abord, recevoir un paiement en espèces des actionnaires, puis utiliser cet argent pour acheter les biens spécifiques.
Le droit des sociétés japonais impose des régulations strictes sur l’acceptation de biens pour protéger le principe de l’augmentation du capital de l’entreprise. Si un contrat est conclu pour acheter des biens à un prix excessivement élevé, cela peut réduire substantiellement les actifs de l’entreprise et causer un préjudice aux autres actionnaires et créanciers. Pour prévenir de telles situations, l’acceptation de biens, en tant que « question d’établissement atypique », ne peut être reconnue valide que si elle remplit les exigences légales strictes suivantes.
Premièrement, il est nécessaire d’inscrire dans les statuts de la société la description des biens à recevoir, leur valeur et le nom ou la dénomination du cédant (article 28, paragraphe 2 du droit des sociétés japonais). Un contrat d’acceptation de biens qui omet cette inscription dans les statuts est considéré comme n’ayant pas d’effet.
Deuxièmement, en principe, la valeur des biens inscrits dans les statuts doit être examinée par un inspecteur nommé par le tribunal pour s’assurer qu’elle est appropriée (article 33, paragraphe 1 du droit des sociétés japonais). L’inspecteur évalue la valeur des biens de manière objective et rapporte ses conclusions au tribunal.
Cependant, une enquête de l’inspecteur n’est pas toujours nécessaire. L’article 33, paragraphe 10 du droit des sociétés japonais prévoit les exceptions suivantes :
- Si la valeur totale des biens inscrits dans les statuts ne dépasse pas 5 millions de yens.
- Si les biens à recevoir sont des valeurs mobilières ayant un prix de marché et que la valeur inscrite dans les statuts ne dépasse pas ce prix de marché.
- Si la valeur inscrite dans les statuts est certifiée comme étant appropriée par des professionnels tels que des avocats, des comptables agréés ou des fiscalistes (y compris une évaluation de la valeur).
Un contrat d’acceptation de biens qui ne remplit pas l’une de ces exigences strictes est juridiquement invalide. Cette invalidité est absolue et ne peut être validée a posteriori par une assemblée générale des actionnaires. Par exemple, le jugement du Tribunal de district de Tokyo en date du 27 février 1991 (1991年2月27日) a clairement reconnu l’invalidité d’une acceptation de biens qui omettait l’inscription dans les statuts. Par conséquent, lors de la création d’une entreprise, il est extrêmement important de respecter scrupuleusement ces exigences légales.
Les risques et conséquences juridiques du paiement fictif sous le droit japonais
Le capital social d’une entreprise constitue la base de ses activités commerciales. C’est pourquoi la loi japonaise sur les sociétés impose aux fondateurs et aux souscripteurs d’actions l’obligation de verser en espèces la contrepartie des actions souscrites. Cependant, le “paiement fictif” est une pratique frauduleuse qui consiste à échapper à cette obligation de paiement.
Le paiement fictif est un terme général désignant une action qui, bien qu’elle semble avoir été effectuée en apparence, n’assure pas réellement la propriété des actifs de l’entreprise. Une méthode typique est le “dépôt de garantie”. Dans ce cas, le fondateur conspire avec l’institution de traitement des paiements (comme une banque), emprunte de l’argent pour effectuer le paiement, puis rembourse immédiatement cet emprunt une fois l’enregistrement de la création de l’entreprise terminé. En conséquence, bien que le montant équivalent au capital social soit temporairement crédité sur le compte bancaire de l’entreprise, il est rapidement retiré, et ainsi, les actifs de l’entreprise ne sont pas réellement constitués.
Cette pratique est problématique car elle compromet gravement le principe de suffisance du capital, qui est au cœur de la crédibilité de l’entreprise, en créant une base patrimoniale dépourvue de substance réelle.
Il est intéressant de noter que le système juridique japonais réglemente les effets juridiques du paiement fictif sous deux aspects. D’abord, en ce qui concerne la validité même du paiement, celui-ci est considéré comme valide. Depuis un arrêt de la Cour suprême du Japon en date du 6 décembre 1963 (1963), la jurisprudence japonaise a constamment jugé que, même si l’argent était emprunté et destiné à être remboursé rapidement, le paiement est valable dès lors qu’un transfert d’argent réel a eu lieu. Cette approche vise à protéger la sécurité des transactions et est également reprise dans l’article 64, paragraphe 1 de la loi japonaise sur les sociétés actuelle.
Cependant, le fait que le paiement soit valide ne signifie pas que les fondateurs sont exempts de responsabilité. Au contraire, ils sont soumis à une responsabilité sévère. L’article 64, paragraphe 1 de la loi japonaise sur les sociétés stipule que les fondateurs et les directeurs au moment de la création de l’entreprise sont solidairement tenus de payer à l’entreprise le montant équivalent au capital versé. Cette disposition vise à compenser les actifs perdus par l’entreprise en raison du paiement fictif et à assurer substantiellement le capital.
De plus, le paiement fictif n’entraîne pas seulement une responsabilité civile, mais peut également être sujet à des sanctions pénales. Faire émettre un certificat de dépôt de paiement frauduleux par l’institution de traitement des paiements peut constituer un délit de faux en écriture publique selon l’article 157, paragraphe 1 du Code pénal japonais. En outre, l’article 965 de la loi japonaise sur les sociétés prévoit des sanctions sévères pour des actes tels que la réalisation d’un dépôt de garantie dans le but de dissimuler un paiement, avec des peines allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement ou une amende de cinq millions de yens, ou les deux. Ainsi, le paiement fictif, en tant qu’acte frauduleux qui ébranle les fondations de l’entreprise, est strictement réglementé tant sur le plan civil que pénal.
Comparaison entre la prise de biens et l’apport en nature sous le droit des sociétés japonais
La prise de biens et l’apport en nature sont tous deux liés à la base patrimoniale d’une société et, en raison du risque qu’ils représentent pour la solidité du capital, ils sont soumis à une réglementation stricte (éléments de constitution atypique) selon la loi japonaise sur les sociétés. Ils présentent des similitudes procédurales, notamment l’obligation d’être mentionnés dans les statuts et, en principe, d’être examinés par un inspecteur. Cependant, leur nature juridique et leurs objectifs diffèrent.
L’apport en nature consiste pour un fondateur ou autre à contribuer à la société non pas en argent, mais en biens tels que des biens immobiliers, des valeurs mobilières ou des droits de propriété intellectuelle. L’objectif est de permettre à ceux qui possèdent des actifs autres que monétaires de participer à la gestion de l’entreprise en tant que capital. En contrepartie, des actions correspondant à la valeur des biens apportés leur sont attribuées.
En revanche, la prise de biens est un contrat par lequel, sur la base d’un apport en espèces, des biens spécifiques sont achetés auprès de personnes spécifiques en utilisant les fonds collectés. L’objectif est de sécuriser à l’avance des biens spécifiques nécessaires à l’entreprise après sa constitution. La contrepartie n’est pas des actions attribuées, mais de l’argent payé à partir des fonds versés.
Cette différence de nature juridique distingue clairement les relations entre les deux. L’apport en nature est un contrat entre le contributeur et la société en formation, tandis que la prise de biens est un contrat entre le fondateur et le cédant du bien (un tiers). Le tableau suivant résume les principales différences entre les deux.
| Élément | Prise de biens | Apport en nature |
| Définition | Contrat par lequel le fondateur acquiert des biens spécifiques, conditionné par la constitution de la société. | Contribution à la société en biens, tels que des biens immobiliers ou des valeurs mobilières, au lieu d’argent. |
| Article de référence | Article 28, paragraphe 2 de la loi japonaise sur les sociétés | Article 28, paragraphe 1 de la loi japonaise sur les sociétés |
| Objectif | Assurer la sécurisation de biens spécifiques nécessaires après la constitution de la société. | Permettre à ceux qui possèdent des biens autres que monétaires de les utiliser comme capital dans la gestion de l’entreprise. |
| Parties concernées | Fondateur et cédant du bien (un tiers). | Fondateur (ou souscripteur d’actions) et société en formation. |
| Paiement de la contrepartie | Le paiement est effectué après la constitution de la société à partir des fonds versés. | Des actions sont attribuées. |
| Réglementation | En tant qu’élément de constitution atypique, la mention dans les statuts et l’inspection par un inspecteur sont en principe nécessaires. | En tant qu’élément de constitution atypique, la mention dans les statuts et l’inspection par un inspecteur sont en principe nécessaires. |
| Conséquences d’une infraction | Le contrat est déclaré nul. | La procédure d’apport en nature est déclarée nulle et une obligation de versement en espèces peut en découler. |
Résumé
Dans cet article, nous avons expliqué, sur la base des lois et de la jurisprudence, des aspects cruciaux de la création d’entreprise sous le droit des sociétés au Japon, à savoir la portée de l’autorité des fondateurs, les exigences pour l’acceptation des apports en nature, et les problèmes liés aux versements fictifs. Ces réglementations constituent le fondement de la protection de l’assise financière de l’entreprise et de la défense des intérêts des actionnaires et des créanciers. En particulier, les procédures strictes concernant les apports en nature et les sanctions civiles et pénales sévères contre les versements fictifs démontrent l’importance que le droit des sociétés japonais accorde au principe de la suffisance du capital. Comprendre et respecter précisément ces règles est la première étape vers une gestion d’entreprise saine et durable. La création d’une entreprise n’est pas une simple formalité, mais un processus essentiel pour consolider les fondations juridiques.
Le cabinet d’avocats Monolith possède une vaste expérience dans la gestion de ces questions juridiques complexes lors de la phase de création d’entreprise. Nous avons fourni une large gamme de services juridiques adaptés aux situations individuelles de nos clients, y compris des conseils sur les pouvoirs des fondateurs, l’assistance dans la rédaction des statuts pour les apports en nature et les contributions en espèces, ainsi que l’établissement de systèmes de conformité pour les versements de capital. Notre cabinet compte plusieurs experts qui, en plus d’être qualifiés en tant qu’avocats au Japon, possèdent des qualifications d’avocats étrangers et sont anglophones, ce qui nous permet de soutenir les affaires de nos clients avec une perspective internationale. Si vous avez des préoccupations ou des questions concernant les thèmes abordés dans cet article, n’hésitez pas à consulter notre cabinet.
Category: General Corporate