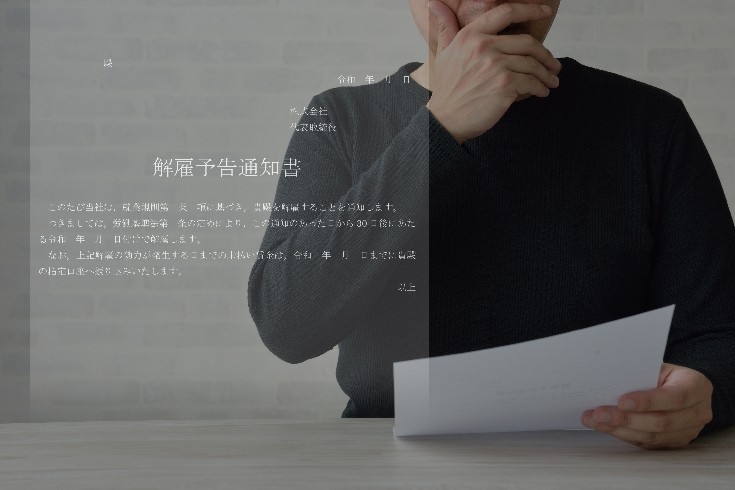Cadre juridique concernant les travailleurs à contrat à durée déterminée au Japon : Un guide pour les dirigeants

Les contrats de travail à durée déterminée constituent une option stratégique importante pour de nombreuses entreprises, que ce soit pour répondre à des projets spécifiques, à des besoins saisonniers, ou pour établir une période d’essai. Cette forme de contrat offre un avantage significatif en permettant de sécuriser la main-d’œuvre nécessaire avec flexibilité. Cependant, le système juridique du travail au Japon impose des réglementations strictes pour assurer la stabilité de l’emploi des travailleurs sous contrat à durée déterminée. En particulier, le cadre légal centré autour de la Loi japonaise sur les contrats de travail définit des règles essentielles que les entreprises doivent respecter concernant la durée des contrats, la conversion en contrats de travail à durée indéterminée, et les procédures à suivre à la fin du contrat. Opérer des contrats à durée déterminée sans comprendre ces régulations peut entraîner des conflits juridiques imprévus et des risques financiers. Une caractéristique du système légal au Japon est la tendance à considérer les contrats à durée déterminée non pas comme une série de contrats indépendants et isolés, mais plutôt comme une relation d’emploi continue qui peut évoluer juridiquement avec chaque renouvellement. À chaque renouvellement du contrat, les attentes du travailleur quant à la continuité de l’emploi sont de plus en plus protégées légalement, et en conséquence, la marge de manœuvre de l’employeur concernant la fin du contrat se réduit. Par conséquent, la conclusion du premier contrat ne représente pas la fin d’un accord statique, mais le début d’une relation qui peut évoluer juridiquement, ce qui constitue la première étape de la gestion des risques. Cet article vise à aider les dirigeants d’entreprise et les responsables juridiques à comprendre le cadre légal principal concernant les travailleurs sous contrat à durée déterminée dans le droit du travail japonais et à y répondre de manière appropriée.
Durée des contrats de travail à durée déterminée sous le droit japonais
Lors de la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée, il est essentiel de comprendre d’abord la limite maximale de la durée d’un contrat. L’article 14, paragraphe 1 de la Loi japonaise sur les normes du travail stipule que, pour empêcher que les travailleurs soient indûment liés par des contrats de longue durée, la durée maximale d’un contrat de travail est en principe fixée à trois ans. Cette disposition fixe uniquement une limite pour la durée d’un seul contrat et ne limite pas le nombre de fois qu’un contrat peut être renouvelé.
Cependant, il existe plusieurs exceptions importantes à ce principe. Premièrement, pour les contrats avec des travailleurs possédant des connaissances spécialisées avancées, des compétences ou de l’expérience, la limite peut être étendue jusqu’à cinq ans. L’appartenance à cette catégorie de « connaissances spécialisées avancées, etc. » n’est pas déterminée par le jugement subjectif de l’employeur, mais par des critères objectifs établis par la loi. Par exemple, cela peut concerner des personnes titulaires d’un doctorat, des médecins ou des avocats, des architectes de premier niveau, ou encore des ingénieurs systèmes et des designers avec une certaine expérience professionnelle et un salaire annuel (par exemple, supérieur à 10,75 millions de yens). Deuxièmement, lors de la conclusion d’un contrat avec un travailleur âgé de 60 ans ou plus, la limite est également de cinq ans. En outre, des contrats définissant la durée nécessaire à l’achèvement d’un projet spécifique, comme la construction d’un barrage, peuvent être conclus pour la durée nécessaire à l’achèvement de ce projet.
En revanche, il n’existe pas de limite minimale de durée de contrat définie par la loi. Néanmoins, l’article 17, paragraphe 2 de la Loi japonaise sur les contrats de travail impose à l’employeur le devoir de considération, qui l’oblige à ne pas renouveler de manière répétée des contrats d’une durée inutilement courte au regard de l’objectif du contrat. Ce devoir de considération n’est pas un simple objectif à atteindre. Par exemple, une pratique consistant à renouveler fréquemment des contrats extrêmement courts, comme d’un mois, pour des tâches qui sont en réalité permanentes, pourrait être considérée comme un facteur justifiant l’« attente raisonnable de renouvellement du contrat » du travailleur lorsqu’est contestée la validité d’un « refus de renouvellement de contrat ». Autrement dit, une stratégie contractuelle visant une flexibilité à court terme pourrait finalement augmenter le risque juridique lors de la fin du contrat, un point que les décideurs doivent prendre en compte dans leur gestion.
Conversion en contrat de travail à durée indéterminée (la « Règle des 5 ans ») en droit japonais
L’une des régulations les plus importantes dans la gestion des contrats de travail à durée déterminée au Japon est le système de conversion en contrat de travail à durée indéterminée, communément appelé la « Règle des 5 ans ». L’article 18 de la Loi japonaise sur les contrats de travail stipule que si un contrat à durée déterminée est renouvelé à plusieurs reprises avec le même employeur et que la durée totale des contrats dépasse cinq ans, le travailleur acquiert le droit de demander la conversion de son contrat en un contrat à durée indéterminée (droit de demande de conversion indéterminée).
Pour que ce droit prenne effet, trois conditions doivent être remplies : premièrement, la durée cumulée des contrats à durée déterminée doit dépasser cinq ans ; deuxièmement, il doit y avoir eu au moins un renouvellement de contrat pendant cette période ; et troisièmement, le calcul de cette durée cumulée commence à partir des contrats initiés après le 1er avril 2013. Si un travailleur exerce ce droit après avoir dépassé une durée cumulée de cinq ans, l’employeur est réputé avoir accepté la demande de conversion et ne peut la refuser. Le contrat à durée indéterminée qui en résulte commence le lendemain de l’expiration du dernier contrat à durée déterminée.
Les conditions de travail après la conversion sont, en principe, identiques à celles du dernier contrat à durée déterminée, à l’exception des dispositions relatives à la durée du contrat (fonction, lieu de travail, salaire, etc.). Cependant, il est possible de modifier ces conditions par des dispositions spécifiques dans le règlement intérieur de l’entreprise. Il est important de noter que la conversion en « contrat à durée indéterminée » ne signifie pas nécessairement un emploi en tant que salarié permanent. Les entreprises peuvent créer une nouvelle catégorie d’emploi pour les personnes converties à durée indéterminée. Toutefois, si des différences de traitement sont établies entre ces employés et les salariés permanents, il doit y avoir des raisons objectives et raisonnables basées sur des éléments tels que le contenu du travail, l’étendue des responsabilités et la possibilité de mutation, sans quoi il existe un risque que cela soit considéré comme une différence de conditions de travail irrationnelle interdite par l’article 8 de la Loi sur l’amélioration de la gestion de l’emploi des travailleurs à temps partiel et à durée déterminée (Loi sur les travailleurs à temps partiel et à durée déterminée). Une conception prudente du système est donc requise.
Concernant le calcul de la durée cumulée des contrats, il existe une règle de période d’interruption appelée « cooling-off ». Selon l’article 18, paragraphe 2, de la Loi japonaise sur les contrats de travail, si la durée du dernier contrat à durée déterminée est inférieure à un an, une interruption égale à la moitié de cette durée, définie par un arrêté ministériel, réinitialise le compteur. Si la durée du dernier contrat est d’un an ou plus, une interruption de six mois ou plus entre la fin d’un contrat et le début du suivant exclut la période précédente du calcul cumulatif.
Il existe des exceptions à cette règle des 5 ans. Par exemple, pour les travailleurs hautement qualifiés engagés dans des projets spécifiques ou pour les personnes âgées employées après l’âge de la retraite sous un employeur ayant reçu une certification pour un plan de gestion de l’emploi approprié, le droit de demander la conversion en contrat à durée indéterminée peut être suspendu pendant une certaine période.
En termes de gestion, il est risqué de ne pas renouveler un contrat juste avant l’expiration des cinq ans dans le seul but d’éviter la conversion en contrat à durée indéterminée, car cela pourrait mener à un litige juridique. Pour qu’un tel non-renouvellement soit considéré comme valide, il ne suffit pas de vouloir éviter la conversion ; il doit y avoir des raisons objectives et rationnelles telles que la nécessité pour l’entreprise. Par conséquent, la règle des 5 ans exige essentiellement des entreprises qu’elles réfléchissent tôt au rôle à long terme des travailleurs sous contrat à durée déterminée et qu’elles gèrent leur personnel de manière planifiée.
Fin d’un contrat de travail à durée déterminée en droit japonais : Licenciement en cours de contrat et non-renouvellement à l’échéance
En droit japonais, il existe deux méthodes principales pour mettre fin à un contrat de travail à durée déterminée : le « licenciement », qui intervient avant la fin de la période contractuelle, et le « non-renouvellement » (雇止め), qui se produit lorsque le contrat n’est pas renouvelé à son échéance. Ces deux concepts sont juridiquement distincts et les conditions requises pour que leur validité soit reconnue diffèrent considérablement.
Licenciement en cours de contrat à durée déterminée sous le droit japonais
L’article 17, paragraphe 1, de la Loi japonaise sur les contrats de travail stipule que l’employeur ne peut licencier un travailleur pendant la durée d’un contrat à durée déterminée, à moins qu’il n’existe des raisons impérieuses de le faire avant l’expiration de la période contractuelle. Ces “raisons impérieuses” sont interprétées de manière beaucoup plus stricte que le critère utilisé pour le licenciement d’un travailleur sous contrat à durée indéterminée, qui requiert des raisons “objectivement raisonnables et socialement acceptables”. Les tribunaux considèrent qu’un contrat à durée déterminée est une promesse d’emploi pendant la période convenue et qu’une rupture unilatérale de cette promesse nécessite des circonstances graves rendant difficile l’attente de la continuation du contrat.
Concrètement, des causes de force majeure telles que la faillite de l’entreprise ou la destruction des locaux suite à une catastrophe naturelle, ou encore des problèmes extrêmement graves du côté du travailleur, comme la commission d’un crime sérieux ou l’incapacité de travailler sur une longue période, peuvent constituer des “raisons impérieuses”. En revanche, un simple ralentissement des performances de l’entreprise, l’insuffisance des compétences du travailleur ou des infractions mineures à la discipline ne justifient presque jamais un licenciement en cours de contrat.
En pratique, les cas où le licenciement en cours de contrat a été jugé valide par les tribunaux sont très limités et illustrent leur caractère exceptionnel. Par exemple, des cas où un travailleur avait considérablement menti sur son âge lors de l’embauche pour un poste nécessitant une bonne condition physique (jugement du Tribunal de district de Tokyo, 28 mars 2008), ou des cas de refus injustifié d’une mutation suivis d’absences non autorisées répétées (affaire Kyo-ei Security Services, jugement du Tribunal de district de Tokyo, 28 mai 2019), ou encore de dissimulation d’absences non autorisées tout en travaillant pour une entreprise concurrente (jugement du Tribunal de district de Tokyo, 26 février 2018), sont limités aux situations où une violation significative du principe de bonne foi par le travailleur a été reconnue. Par conséquent, du point de vue de la gestion, il est essentiel de reconnaître qu’un contrat à durée déterminée est une promesse ferme qui, une fois conclue, ne peut être résiliée pendant sa durée, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Ainsi, une sélection prudente lors du recrutement et la définition d’une période contractuelle initiale appropriée sont les mesures de gestion des risques les plus importantes.
La non-reconduction de contrat de travail sous le droit japonais
La non-reconduction de contrat de travail, ou “雇止め” (yatoidome), désigne la décision de ne pas renouveler un contrat de travail à durée déterminée à l’expiration de sa période. Bien que la fin d’un contrat à l’échéance de sa durée soit en principe librement décidée, l’article 19 de la loi japonaise sur les contrats de travail codifie la jurisprudence établie de la “théorie de la non-reconduction” et limite la liberté de l’employeur de ne pas renouveler le contrat dans certains cas.
La théorie de la non-reconduction s’applique principalement dans les deux cas suivants :
- Lorsque des contrats à durée déterminée ont été renouvelés à plusieurs reprises dans le passé et que la non-reconduction peut être considérée, selon les normes sociales, comme équivalente au licenciement d’un travailleur sous contrat à durée indéterminée (type contrat substantiellement indéterminé).
- Lorsqu’il existe des raisons valables de croire que le travailleur s’attendait à ce que son contrat à durée déterminée soit renouvelé à l’expiration de la période contractuelle (type protection des attentes).
Dans ces cas, la non-reconduction par l’employeur est invalide si elle “manque de raisons objectivement rationnelles et n’est pas considérée comme appropriée selon les normes sociales”. Pour déterminer si le travailleur a une “attente raisonnable de renouvellement”, il faut prendre en compte de manière globale la permanence des tâches, le nombre de renouvellements et la durée totale de l’emploi, si les procédures de renouvellement étaient purement formelles, et l’existence de comportements ou de déclarations de la part de la direction suggérant la continuation de l’emploi.
Certaines décisions de justice importantes éclairent la compréhension de cette théorie. L’affaire de l’usine Toshiba Yanagicho (décision de la Cour suprême du 22 juillet 1974) a établi la base de la théorie de la non-reconduction en jugeant invalide la non-reconduction d’un travailleur temporaire engagé dans des tâches permanentes et dont le contrat à court terme avait été formellement renouvelé à plusieurs reprises. Dans l’affaire Hitachi Medico (décision de la Cour suprême du 4 décembre 1986), bien que l’attente du travailleur en matière de renouvellement ait été jugée raisonnable, la non-reconduction a été considérée comme valide en raison de la nécessité impérieuse de fermer l’usine et de réduire le personnel, ce qui indique que même en présence d’une attente raisonnable, la non-reconduction peut être admise s’il existe des raisons objectives et rationnelles qui la justifient.
Un cas récent notable est l’affaire Hakuhodo (décision du tribunal de district de Fukuoka du 17 mars 2020). Dans cette affaire, malgré la présence d’une clause dans le contrat stipulant une “limite de renouvellement de cinq ans”, le tribunal a mis l’accent sur la réalité des renouvellements sur près de 30 ans et a jugé la non-reconduction invalide, reconnaissant que le travailleur avait des raisons valables de s’attendre à un renouvellement. Ce jugement souligne que le libellé du contrat seul ne suffit pas à garantir la sécurité et que la pratique réelle et le comportement de la direction peuvent involontairement créer un droit d’attente légalement protégé pour le travailleur. Par conséquent, pour gérer les risques juridiques liés à la non-reconduction, il est essentiel de bien rédiger les contrats, de renforcer les entretiens et les processus d’évaluation lors du renouvellement, et de former adéquatement les cadres à la communication appropriée.
Comparaison juridique entre le licenciement pendant la période contractuelle et la non-reconduction du contrat en droit japonais
Comprendre clairement les différences juridiques entre deux méthodes de fin de contrat de travail à durée déterminée, le “licenciement pendant la période contractuelle” et la “non-reconduction du contrat”, constitue la base d’une gestion appropriée des ressources humaines. Le tableau suivant résume les principales différences entre ces deux approches.
| Point de comparaison | Licenciement pendant la période contractuelle | Non-reconduction du contrat |
| Base juridique | Article 17 de la Loi sur les contrats de travail du Japon | Article 19 de la Loi sur les contrats de travail du Japon |
| Moment de survenance | Avant l’expiration de la période contractuelle | Au moment de l’expiration de la période contractuelle |
| Exigences de validité | Existence de “raisons impérieuses” | Existence de “raisons objectivement raisonnables” et de “l’équité selon les normes sociales” |
| Rigueur des critères juridiques | Extrêmement stricts | Moins stricts que pour le licenciement pendant la période contractuelle, mais jugés strictement en cas de renouvellements répétés |
| Responsabilité de la preuve | L’employeur doit prouver l’existence de “raisons impérieuses” | Le travailleur avance “l’attente raisonnable” et autres, puis l’employeur doit prouver l’existence de “raisons raisonnables” |
Comme il ressort clairement de cette comparaison, le licenciement pendant la période contractuelle est une mesure exceptionnelle parmi les exceptions, tandis que la non-reconduction du contrat est structurée de manière à ce que sa validité soit rigoureusement examinée en fonction de la réalité des renouvellements de contrat. Reconnaître ces différences et saisir avec précision les exigences juridiques requises dans chaque situation est la clé pour prévenir les conflits avant qu’ils ne surviennent.
Résumé
Lors de l’emploi de travailleurs sous contrat à durée déterminée sous le régime du droit du travail japonais, il est essentiel de comprendre profondément les réglementations strictes qui se cachent derrière leur flexibilité apparente. Comme nous l’avons expliqué dans cet article, les éléments centraux que les entreprises doivent respecter incluent la limite de la durée des contrats, la règle de conversion en contrat à durée indéterminée après un cumul de cinq ans, ainsi que les disciplines juridiques très différentes applicables aux licenciements « pendant la période du contrat » et aux « non-renouvellements de contrat » lors de la fin de celui-ci. En particulier, le fait que le licenciement pendant la période contractuelle soit soumis à des obstacles presque insurmontables, et que la répétition de renouvellements de contrat sans précaution puisse involontairement compliquer la situation légale du non-renouvellement, représente un risque managérial significatif. L’utilisation efficace des travailleurs sous contrat à durée déterminée ne se termine pas simplement par la signature d’un contrat de travail adéquatement rédigé. Elle nécessite une gestion continue qui inclut une planification de personnel stratégique à long terme, la mise en place de processus internes clairs et cohérents pour le renouvellement et la fin des contrats, ainsi qu’une formation appropriée pour les cadres.
Le cabinet d’avocats Monolith possède une solide expérience dans la fourniture de conseils complets sur le droit du travail japonais, y compris les problématiques liées aux contrats à durée déterminée traitées dans cet article, à une clientèle diversifiée tant au Japon qu’à l’international. Notre force réside dans notre profonde expertise du système juridique japonais, renforcée par la présence d’avocats parlant anglais, y compris ceux qualifiés dans des juridictions étrangères. Cela nous permet de comprendre précisément les préoccupations et contextes uniques de nos clients dans un environnement commercial international, et d’offrir un soutien juridique clair et pratique sans barrière linguistique. Que ce soit pour la gestion de l’emploi des travailleurs sous contrat à durée déterminée, l’élaboration de règlements internes ou la gestion des conflits du travail, nous sommes prêts à soutenir vigoureusement votre entreprise du point de vue juridique à chaque étape.
Category: General Corporate