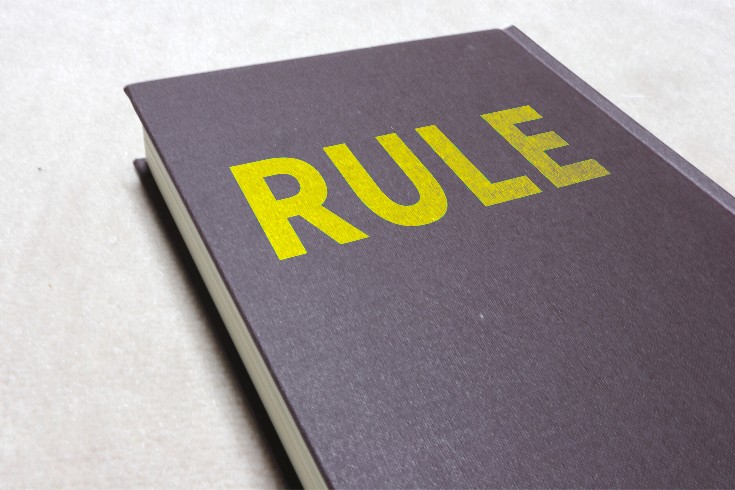Protection des salaires dans le droit du travail japonais : explication des principes fondamentaux que les dirigeants doivent respecter

Le paiement des salaires constitue l’une des obligations les plus fondamentales pour les employeurs et représente un élément central des relations contractuelles de travail au Japon. Dans le cadre du développement d’activités commerciales au Japon, il est crucial de respecter le cadre légal strict régissant le paiement des salaires, ce qui constitue une partie intégrante de la gestion des risques. Ce domaine est principalement régi par deux lois. La première est le “Code civil japonais”, qui établit la relation de contrepartie entre le travail et la “rémunération” sur la base du principe de la liberté contractuelle. La seconde est une loi spéciale, la “Loi sur les normes du travail au Japon”, qui impose des réglementations impératives pour protéger les travailleurs, en partant du principe d’un déséquilibre de pouvoir de négociation entre employeurs et employés. En particulier, les dispositions relatives aux “salaires” définies par la Loi sur les normes du travail ont préséance sur les principes généraux du Code civil et ont un impact direct sur les activités des entreprises. Cet article explique en détail les principes juridiques qui constituent le cœur de la protection des salaires sous la Loi sur les normes du travail japonaise, en se concentrant spécifiquement sur les “cinq principes de paiement des salaires” établis à l’article 24 de la loi, tout en intégrant des références à des articles de loi spécifiques et à des cas de jurisprudence importants. L’objectif est d’aider les cadres d’entreprise, les actionnaires et les responsables juridiques à comprendre précisément ces réglementations complexes, à assurer la conformité et à atténuer efficacement les risques juridiques.
La rémunération sous le droit japonais : l’entrecroisement du Code civil et de la Loi sur les normes du travail
Dans le système juridique japonais, la contrepartie du travail est réglementée par deux perspectives différentes : le “Code civil japonais” et la “Loi japonaise sur les normes du travail”, et comprendre cette distinction est extrêmement important.
La perspective du Code civil japonais : la « rémunération » dans le contrat de travail
L’article 623 du Code civil japonais définit le contrat de travail comme “un accord par lequel une partie s’engage à travailler pour l’autre partie, qui s’engage en retour à lui fournir une rémunération”. Ici, la “rémunération” est considérée comme un droit privé basé sur l’accord entre les parties, c’est-à-dire sur le principe de la liberté contractuelle. Le Code civil ne spécifie pas en détail les modalités de paiement de la rémunération et stipule en principe que le travailleur ne peut réclamer sa rémunération qu’après avoir accompli le travail promis (Article 624, paragraphe 1 du Code civil japonais). Cela signifie que, dans un monde sans la Loi sur les normes du travail, le moment et la méthode de paiement seraient entièrement laissés à l’accord des parties.
La perspective de la Loi japonaise sur les normes du travail : le « salaire » en tant que droit protégé
En revanche, la Loi japonaise sur les normes du travail, en tant que loi publique, établit les normes minimales pour les conditions de travail. L’article 11 de cette loi définit très largement le “salaire” comme “tout ce qui est payé par l’employeur au travailleur en contrepartie du travail, quel que soit le nom donné, y compris les salaires, les allocations, les primes et autres”. En tant que loi spéciale par rapport au Code civil, ses dispositions ont une force obligatoire. Autrement dit, tout accord dans un contrat de travail qui ne répond pas aux normes établies par la Loi sur les normes du travail est invalide en vertu de l’article 13 de cette loi, et les normes légales sont automatiquement appliquées.
La relation entre ces deux lois ne se limite pas à une simple différence de définition. Elle reflète un changement philosophique dans le droit, déplaçant les relations de travail de la sphère de l’autonomie contractuelle privée à celle de la régulation publique où l’État intervient pour fournir une protection minimale. Alors que le Code civil part du principe d’un “accord” entre des parties égales, la Loi sur les normes du travail prend pour hypothèse l’inégalité structurelle des rapports de force entre employeurs et travailleurs, intervenant pour protéger la vie des travailleurs. Ainsi, même si un travailleur a donné son consentement individuel à une méthode de paiement des salaires, si le contenu de cet accord viole les normes établies par la Loi sur les normes du travail, cet accord est juridiquement invalide. Mal comprendre ce point peut conduire à des erreurs graves en matière de conformité.
Le tableau suivant résume les différences conceptuelles entre la “rémunération” selon le Code civil japonais et le “salaire” selon la Loi japonaise sur les normes du travail.
| Caractéristiques | Rémunération selon le Code civil japonais | Salaire selon la Loi japonaise sur les normes du travail |
| Base légale | Article 623 du Code civil japonais | Article 11 de la Loi japonaise sur les normes du travail |
| Concept de base | Obligation contractuelle privée | Droit légalement protégé |
| Principe directeur | Principe de liberté contractuelle | Établissement de normes minimales (protection des travailleurs) |
| Règles de paiement | Principalement basées sur l’accord entre les parties | Réglementation stricte selon les « cinq principes de paiement des salaires » (Article 24 de la Loi sur les normes du travail) |
| Exécution de la loi | Exercice des droits par action civile | Supervision administrative et sanctions pénales par l’Inspection du travail |
Les cinq principes fondamentaux du paiement des salaires : Dispositions clés de la Loi sur les normes du travail japonaise
L’article 24 de la Loi japonaise sur les normes du travail constitue le cœur substantiel des dispositions de protection des salaires et est connu sous le nom des « cinq principes fondamentaux du paiement des salaires ». Ce texte stipule que « le salaire doit être payé en monnaie, directement au travailleur, et dans son intégralité ». « Il doit être versé au moins une fois par mois à une date fixe ». Ces cinq principes ne fonctionnent pas de manière isolée, mais interagissent mutuellement pour former un système global visant à stabiliser la base de vie des travailleurs. Le « paiement en monnaie » et le « paiement direct » garantissent que les salaires parviennent aux travailleurs de manière sûre et utilisable, tandis que le « paiement intégral » préserve leur valeur. Ensuite, le « paiement au moins mensuel » et le « paiement à une date fixe » assurent la prévisibilité des revenus. Comprendre cet objectif global est essentiel pour interpréter les dispositions d’exception de chaque principe.
Le principe du paiement en monnaie courante
En principe, les salaires doivent être payés en espèces dans la monnaie ayant cours légal au Japon, c’est-à-dire en yen japonais . Le paiement en devises étrangères, par chèque ou sous forme de biens matériels, est généralement interdit afin de protéger les travailleurs contre les inconvénients de la conversion et l’instabilité de la valeur .
Ce principe admet des exceptions importantes adaptées à la réalité des activités économiques modernes. L’exception la plus courante est le virement sur un compte bancaire spécifié par le travailleur, avec son consentement explicite . Dans ce cas, le simple consentement du travailleur ne suffit pas ; souvent, il est également nécessaire de conclure un accord collectif de travail concernant la mise en œuvre du virement bancaire . Récemment, grâce à une révision du règlement d’application de la Loi sur les normes du travail, il est également devenu possible de payer les salaires sur le compte d’un prestataire de services de transfert de fonds désigné par le ministre de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, à condition d’avoir le consentement du travailleur (ce qu’on appelle le paiement numérique) . De plus, avec le consentement du travailleur, il est permis de payer les indemnités de départ par chèque, et si un accord collectif de travail le prévoit, de fournir l’allocation de transport sous forme d’abonnement de transport .
Il est important de noter que le “consentement” requis pour l’application de ces exceptions n’est pas irrévocable et peut être retiré à tout moment. Le jugement du tribunal simplifié de Kochi en date du 18 mars 1981 (affaire Mikuni Taxi) a clarifié ce point . Dans cette affaire, un travailleur qui avait initialement consenti au paiement par virement bancaire a par la suite demandé à être payé en espèces, ce que l’employeur a refusé. Le tribunal a jugé que le refus de l’employeur violait le principe du paiement en monnaie courante. Cette décision indique que le principe du paiement en monnaie courante est un droit fondamental des travailleurs et que les exceptions pour commodité (virement bancaire) ne doivent pas entraîner un renoncement permanent à ce droit fondamental. Par conséquent, les entreprises doivent maintenir un système pratique pour payer les salaires en espèces aux travailleurs qui ne consentent pas au virement bancaire ou qui retirent leur consentement.
Le principe du paiement direct des salaires
Afin d’éliminer l’exploitation intermédiaire et de garantir que la rémunération du travail parvienne directement à la main de l’employé, le salaire doit être payé directement à la personne concernée .
Sous ce principe, même si l’employé a désigné un mandataire, le paiement du salaire à cet agent (mandataire volontaire) est illégal . Même si l’employé est mineur, le paiement à son représentant légal, tel qu’un parent, est clairement interdit par l’article 59 de la Loi sur les normes du travail au Japon (Japanese Labor Standards Act) . De plus, même si l’employé a des dettes financières, il n’est pas permis à l’employeur de payer directement le salaire au créancier .
L’exception reconnue est le paiement à un « messager » de la personne concernée . Un messager est quelqu’un qui ne fait que transmettre ou exécuter les décisions de la personne concernée, sans avoir de pouvoir de décision propre. Par exemple, un cas où un membre de la famille vient récupérer une enveloppe de salaire scellée à la place d’un employé hospitalisé pour maladie. Cependant, la distinction entre un agent et un messager peut parfois être floue et comporter des risques juridiques, donc en pratique, le paiement direct à la personne ou le transfert sur un compte bancaire au nom de la personne avec son consentement est la méthode la plus sûre .
Un cas judiciaire marquant qui illustre l’importance de ce principe est le jugement de la Cour suprême du 12 mars 1968 (1968) . Dans cette affaire, un employé avait cédé son droit à recevoir son indemnité de départ (créance salariale) à un tiers. La Cour suprême a jugé que, bien que le contrat de cession de créance entre les parties (l’employé et le cessionnaire) puisse être valide en droit civil, cela n’affecte pas les obligations de l’employeur en vertu de la Loi sur les normes du travail. En d’autres termes, l’employeur a toujours l’obligation de payer directement le salaire (dans ce cas, l’indemnité de départ) à l’employé lui-même, et le cessionnaire ne peut pas exiger le paiement direct de l’employeur. Ce jugement montre que la politique publique de protection des travailleurs peut intervenir dans la force juridique des transactions privées en droit civil et même limiter leurs effets juridiques, symbolisant ainsi le caractère impératif de la Loi sur les normes du travail. Par conséquent, les entreprises doivent continuer à payer l’employé lui-même, même si elles reçoivent une notification de cession de créance salariale de la part des créanciers de l’employé.
Le principe du paiement intégral des salaires sous le droit japonais
En vertu du droit japonais, les salaires doivent être payés dans leur intégralité, et il est en principe interdit à l’employeur de déduire unilatéralement toute somme d’argent des salaires (retenues sur salaire). Cette règle vise à garantir que les travailleurs reçoivent la totalité de la rémunération promise et à assurer la stabilité de leur vie économique.
Il existe cependant des exceptions à ce principe. Premièrement, il est possible de déduire du salaire des éléments tels que l’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation et les cotisations de sécurité sociale, qui sont obligatoires en vertu de la loi, sans accord spécial. Deuxièmement, pour déduire des éléments non basés sur la loi, tels que le loyer d’un logement de fonction ou les cotisations syndicales, il est nécessaire de conclure un accord écrit (accord collectif) avec le syndicat du lieu de travail représentant la majorité des travailleurs (ou, en l’absence de syndicat, avec les représentants de la majorité des travailleurs) qui spécifie les éléments à déduire.
Un point particulièrement complexe en droit est la question de savoir si l’employeur peut compenser ses créances (par exemple, des droits à des dommages-intérêts ou des remboursements de prêts) avec les créances salariales. En principe, une telle compensation unilatérale est interdite car elle viole le principe du paiement intégral des salaires. Cela a été illustré par la décision de la Cour suprême du 2 novembre 1956 (affaire Kansai Seiki), où la Cour n’a pas reconnu la compensation des salaires avec les créances de dommages-intérêts revendiquées par l’employeur.
Cependant, la jurisprudence reconnaît deux exceptions dans des situations limitées. La première est la “compensation ajustée”, qui se réfère à l’acte de régler les paiements excédentaires résultant d’erreurs de calcul des salaires lors des paiements ultérieurs. La décision de la Cour suprême du 18 décembre 1969 (affaire Fukushima Kenkyo) a permis une telle compensation, à condition que le moment de l’excédent et celui de l’ajustement soient raisonnablement proches et que le montant de la compensation ne menace pas la vie économique du travailleur. Cependant, dans des cas où la moitié d’une prime a été compensée sans préavis préalable, cela a été jugé illégal (décision de la Cour d’appel de Tokyo du 9 avril 2008).
La deuxième exception concerne la compensation basée sur le “consentement libre et éclairé” du travailleur. La décision de la Cour suprême du 26 novembre 1990 (affaire Nisshin Steel) est un cas de référence à cet égard. Dans cette affaire, le travailleur avait volontairement demandé à utiliser son indemnité de départ pour rembourser un prêt de l’employeur, et il n’y avait aucune contrainte de la part de l’employeur dans le processus de prise de décision, ce qui a rendu la compensation entre l’indemnité de départ et le prêt valide. Ce précédent montre que la simple présence d’une signature sur un formulaire de consentement n’est pas suffisante ; il faut que ce consentement soit réellement libre et non influencé par le déséquilibre des relations de travail. Compte tenu du haut niveau d’exigence concernant la “qualité du consentement”, la politique la plus sûre pour les entreprises serait de ne pas procéder à des compensations avec les salaires en principe.
Les principes du paiement mensuel et du paiement à date fixe
Ces deux principes fonctionnent conjointement pour apporter régularité et prévisibilité au revenu des travailleurs.
Le “principe du paiement mensuel” stipule qu’il doit y avoir au moins un jour de paiement des salaires pendant le mois calendaire (du premier au dernier jour du mois). Cela s’applique même en cas de salaire annuel, qui doit être divisé en au moins douze paiements mensuels. Par exemple, il est contraire à ce principe de combiner les quelques jours de salaire d’un travailleur qui commence à la fin du mois avec le salaire du mois suivant et de le payer le mois d’après.
Le “principe du paiement à date fixe” exige que le jour de paiement soit clairement spécifié. Il est légal de fixer des dates telles que “le 25 de chaque mois” ou “le dernier jour ouvrable du mois”, mais il est illégal de définir une plage de dates comme “entre le 20 et le 25 de chaque mois” ou de fixer une date qui varie chaque mois, comme “le troisième vendredi de chaque mois”, car la date n’est pas spécifiquement déterminée.
Des exceptions à ces principes sont prévues par l’article 24, paragraphe 2, de la Loi sur les normes du travail japonaise (Japanese Labor Standards Act), qui permettent d’exclure de l’application de ces principes les salaires versés de manière temporaire (comme les allocations de mariage), les bonus et autres indemnités qui, de par leur nature, sont difficiles ou inappropriées à payer à une date fixe chaque mois.
Les risques managériaux découlant d’une violation de la législation
En cas de violation de l’un des cinq principes de paiement des salaires établis à l’article 24 de la Loi sur les normes du travail japonaise, une sanction pénale pouvant aller jusqu’à une amende de 300 000 yens peut être imposée en vertu de l’article 120 de la même loi. En droit du travail au Japon, il est fréquent que non seulement l’individu responsable de la violation, mais aussi l’entreprise en tant que personne morale, soient soumis à des sanctions en vertu de dispositions pénales applicables aux deux parties, ce qui signifie que l’entreprise ne peut échapper à sa responsabilité.
À première vue, une amende de 300 000 yens peut sembler insignifiante, en particulier pour une grande entreprise. Cependant, cette sanction directe n’est souvent que le début d’un risque managérial plus important. Une enquête menée par l’Inspection du travail peut ne pas se limiter à un seul cas de violation, mais peut déboucher sur un audit complet de la gestion du travail de l’entreprise. Cela peut entraîner des recommandations de correction, forçant l’entreprise à modifier ses opérations. De plus, la divulgation publique d’une violation légale peut gravement nuire à la crédibilité sociale de l’entreprise, affectant négativement tout, de ses activités de recrutement aux transactions avec les clients, et même à la levée de fonds. Par conséquent, le respect des principes de paiement des salaires ne devrait pas être perçu uniquement comme un moyen passif d’éviter des amendes, mais plutôt comme un enjeu crucial de la gouvernance d’entreprise, essentiel au soutien de la croissance durable et de la stabilité de l’entreprise.
Résumé
Les cinq principes fondamentaux du paiement des salaires définis par la Loi sur les normes du travail au Japon, à savoir le paiement en monnaie, le paiement direct, le paiement intégral, le paiement au moins une fois par mois et le paiement à une date fixe, ne sont pas de simples directives administratives. Ils représentent des exigences légales strictes et impératives, fondées sur une politique publique forte de protection des travailleurs. Ces principes ne peuvent être modifiés ou annulés par un accord privé avec les employés. Pour toutes les entreprises opérant au Japon, comprendre profondément ces règles et mettre en place un système interne pour assurer leur respect est un devoir essentiel pour construire des relations de travail stables et éviter les risques juridiques. Le cabinet d’avocats Monolith a une solide expérience dans le conseil à une clientèle nationale et internationale sur des questions complexes liées au droit du travail japonais, en particulier en matière de conformité des salaires et de calcul des rémunérations. Notre cabinet compte plusieurs membres maîtrisant le droit japonais, ainsi que des avocats qualifiés dans des juridictions étrangères et anglophones. Cette combinaison de compétences linguistiques et de connaissances juridiques couvrant plusieurs systèmes de droit est particulièrement précieuse pour aider les entreprises étrangères et multinationales à adapter leurs politiques de ressources humaines aux réglementations japonaises. Nous offrons des services juridiques spécialisés allant de la révision et de l’évaluation des risques de votre système de gestion du personnel à la représentation en cas de litige. N’hésitez pas à nous consulter pour toute assistance. Les sources utilisées pour ce rapport sont disponibles ici
Category: General Corporate