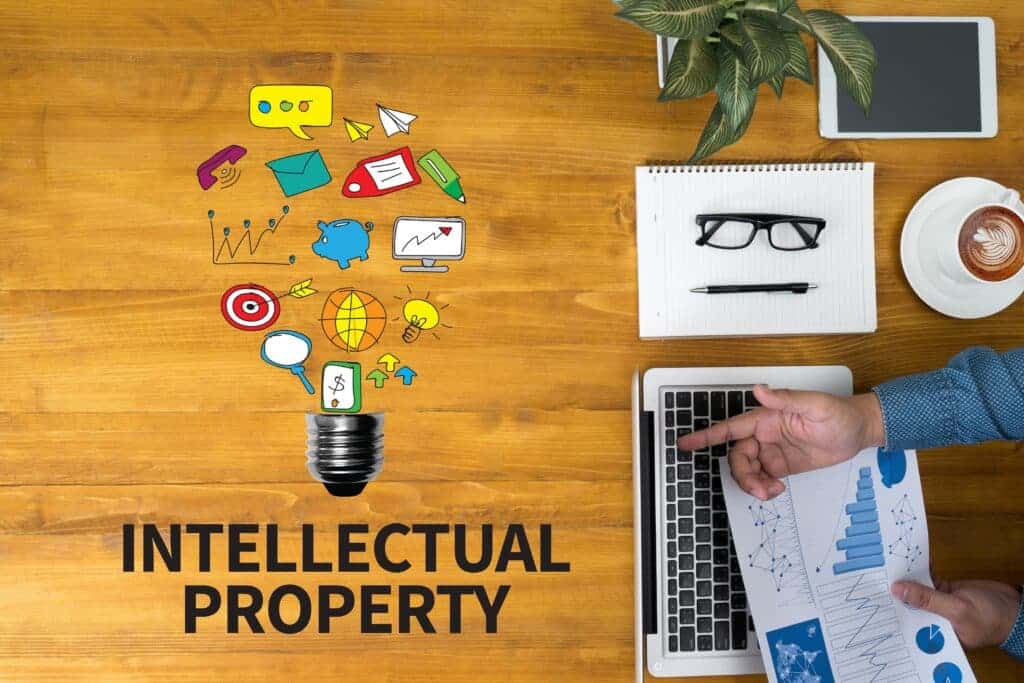Dispositions de protection des droits de l'homme dans le droit du travail japonais et protection des intérêts personnels des travailleurs

Pour les entreprises qui développent leurs activités au Japon, le respect du droit du travail est l’un des enjeux majeurs de la gestion d’entreprise. Cependant, ce respect ne se limite pas à une simple conformité aux réglementations formelles telles que les salaires ou les heures de travail. Au cœur du système juridique du droit du travail japonais réside un principe fondamental de défense des droits humains fondamentaux des travailleurs et de protection de leur dignité personnelle. Ce principe impose aux entreprises l’obligation légale de créer activement un environnement où les travailleurs peuvent maintenir leur dignité et travailler dans un état sain, tant physiquement que mentalement. Comprendre profondément cette obligation est un élément essentiel pour éviter les conflits juridiques potentiels et réaliser une gestion durable de l’organisation. Dans cet article, nous expliquerons, d’un point de vue spécialisé, les deux piliers juridiques fondamentaux qui constituent le cadre de la protection des droits humains dans le droit du travail au Japon. Le premier pilier est le “principe d’égalité de traitement” établi par la Loi sur les normes du travail japonaise, qui interdit le traitement défavorable des travailleurs sur la base de certaines caractéristiques. Le deuxième pilier est le “devoir de considération de la sécurité” qui est explicitement formulé dans la Loi sur les contrats de travail japonaise, un concept plus large qui oblige les entreprises à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la vie et de la santé des travailleurs. En analysant comment ces principes ont été interprétés à travers les décisions des tribunaux et comment ils ont été légalisés en tant qu’obligations spécifiques des entreprises, nous fournirons des connaissances pratiques sur les risques juridiques auxquels les entreprises sont confrontées et les stratégies de gestion de ces risques.
Le principe de traitement égal selon la Loi sur les normes du travail au Japon
En tant que disposition fondamentale de la protection des droits de l’homme dans le droit du travail japonais, l’article 3 de la Loi japonaise sur les normes du travail est d’abord à mentionner. Cet article stipule que “l’employeur ne doit pas discriminer en matière de salaire, d’heures de travail ou d’autres conditions de travail sur la base de la nationalité, de la croyance ou du statut social du travailleur”. Cette disposition concrétise l’idée de l’égalité devant la loi garantie par l’article 14 de la Constitution japonaise dans le contexte des relations d’emploi.
Les motifs de discrimination interdits par cet article sont limitativement énumérés comme étant la “nationalité”, la “croyance” et le “statut social”.
La “nationalité” se réfère à la nationalité possédée par le travailleur, et par exemple, établir sans raison valable une différence de salaire ou d’opportunités de promotion entre un travailleur de nationalité japonaise et un travailleur étranger constituerait une violation de cette disposition.
La “croyance” est interprétée comme un concept large incluant non seulement une foi religieuse spécifique, mais aussi des croyances politiques ou des convictions idéologiques.
Le “statut social” signifie une position sociale innée, c’est-à-dire un statut social qui ne peut être modifié par les efforts personnels. Il est important de noter que les motifs de discrimination interdits par cet article 3 sont limités à ces trois, et que l’article lui-même ne cible pas directement la discrimination basée sur d’autres motifs.
Il est extrêmement important d’interpréter la portée d’application de ce principe de traitement égal. La Cour suprême du Japon a constamment jugé que cette disposition s’applique à la discrimination concernant les “conditions de travail” après la conclusion du contrat de travail, et non à la phase précédant le travail, c’est-à-dire l’embauche elle-même. Cette interprétation a été clairement établie dans le jugement de la Cour suprême du 12 décembre 1973 (1973), communément appelé “l’affaire Mitsubishi Plastics”. Dans cette affaire, un travailleur en période d’essai s’est vu refuser l’emploi permanent parce qu’il avait caché son implication dans les mouvements étudiants lors de l’entretien. La Cour suprême a jugé que les entreprises ont la “liberté d’embauche” et que le choix des personnes à employer, en fonction de leurs idées, est en principe laissé à la discrétion de l’entreprise. Ainsi, il a été établi que l’article 3 de la Loi japonaise sur les normes du travail ne s’applique pas directement à la discrimination au stade de l’embauche.
Cependant, cette “liberté d’embauche” n’est pas illimitée. Si des mesures telles que le licenciement après l’embauche sont basées sur des motifs discriminatoires qui vont à l’encontre du principe de traitement égal, les tribunaux peuvent les juger invalides. Un exemple en est le jugement du tribunal de district de Yokohama du 19 juin 1974, communément appelé “l’affaire Hitachi Manufacturing”. Dans cette affaire, une entreprise a licencié un travailleur qui avait caché être un Coréen résidant au Japon et avait postulé sous un nom japonais, en invoquant la falsification de son parcours. Cependant, le tribunal a examiné le motif réel du licenciement, plutôt que la raison formelle, et a conclu que le véritable motif était la “nationalité” du travailleur. Un tel licenciement basé sur la nationalité est non seulement contraire à l’esprit de l’article 3 de la Loi japonaise sur les normes du travail, mais aussi en violation de l’article 90 du Code civil japonais qui établit l’ordre public et les bonnes mœurs, et a donc été jugé invalide.
Les implications managériales découlant de ces cas sont significatives. Le jugement de l’affaire Mitsubishi Plastics accorde aux entreprises une large discrétion au stade de l’embauche, mais le jugement de l’affaire Hitachi Manufacturing montre que l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire peut être soumis à un examen judiciaire rigoureux si des pratiques discriminatoires sont présentes dans les mesures de personnel après l’embauche. Les entreprises risquent de voir leurs décisions en matière de personnel, qui peuvent sembler légales en surface, être jugées illégales si elles sont fondées sur des intentions discriminatoires interdites par l’article 3 de la Loi japonaise sur les normes du travail. En outre, en ce qui concerne la protection de la “croyance”, bien que les pensées et convictions intérieures des travailleurs soient protégées, si les actions basées sur ces croyances perturbent l’ordre du lieu de travail, comme par exemple des activités de prosélytisme insistantes envers d’autres employés pendant les heures de travail, l’entreprise a le droit de maintenir la discipline en se basant sur le règlement intérieur. Par conséquent, les entreprises doivent établir des normes de comportement claires nécessaires au maintien de l’environnement de travail tout en tenant compte de la liberté intérieure des travailleurs.
L’obligation de protection des intérêts personnels des travailleurs inhérente au contrat de travail sous le droit japonais
Un autre pilier important de la défense des droits de l’homme dans le droit du travail au Japon est l’obligation globale de protection que les entreprises doivent à leurs travailleurs, à savoir l’« obligation de diligence en matière de sécurité ». Cette obligation est explicitement énoncée à l’article 5 de la loi japonaise sur les contrats de travail, qui stipule que « l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer que le travailleur puisse travailler en toute sécurité, en préservant sa vie, son corps, etc. ». Bien que cet article ait été promulgué en 2007, le concept d’obligation de diligence en matière de sécurité est une obligation fondamentale associée au contrat de travail, établie depuis longtemps par la jurisprudence des tribunaux.
L’essence de cette obligation réside dans l’interprétation large de l’expression « sécurité de la vie, du corps, etc. ». À l’origine, cette obligation était principalement discutée dans le contexte de la protection des travailleurs contre les accidents physiques sur les chantiers de construction et dans les usines. Cependant, avec les changements socio-économiques, les tribunaux ont élargi la portée de cette « sécurité » pour inclure non seulement la protection contre les dangers physiques, mais aussi la santé mentale des travailleurs, c’est-à-dire la protection de leur santé mentale. Cette obligation ne se limite pas à une obligation passive d’éviter les comportements dangereux, mais est comprise comme une obligation active d’agir pour créer et maintenir un environnement de travail où les travailleurs peuvent travailler en bonne santé physique et mentale.
Le jugement qui a défini la signification moderne de l’obligation de diligence en matière de sécurité est celui de la Cour suprême du 24 mars 2000, communément appelé « l’affaire Dentsu ». Dans cette affaire, un jeune travailleur en deuxième année d’emploi a développé une dépression et s’est suicidé à la suite d’une charge de travail excessive due à des heures de travail chroniquement longues. La Cour suprême a pour la première fois clairement indiqué que l’obligation de diligence en matière de sécurité de l’entreprise comprend « l’obligation de veiller à ce que la fatigue et la charge psychologique associées à l’exécution du travail ne s’accumulent pas excessivement, au point de nuire à la santé physique et mentale du travailleur ». La Cour a reconnu une violation de l’obligation de diligence en matière de sécurité, car le supérieur avait connaissance des heures de travail considérablement longues du travailleur et de la détérioration de son état de santé, mais n’avait pas pris de mesures pour alléger la charge de travail. Ce jugement, qui a finalement abouti à un règlement à l’amiable pour un montant élevé d’environ 168 millions de yens, illustre l’importance des risques de gestion pour une entreprise en cas de non-respect de cette obligation.
Depuis le jugement de l’affaire Dentsu, l’obligation de diligence en matière de sécurité est devenue un concept central dans la gestion des risques sur les lieux de travail modernes. Les entreprises sont responsables non seulement d’assurer la sécurité de l’environnement de travail physique, mais aussi de prévenir le surmenage, de gérer le stress découlant des relations interpersonnelles sur le lieu de travail et de mettre en place des systèmes pour détecter et répondre rapidement aux signes de troubles de la santé mentale des travailleurs. Cette vaste obligation de diligence en matière de sécurité sert de fondement à des obligations légales plus spécifiques et détaillées, telles que les mesures de prévention du harcèlement qui seront discutées plus loin. En d’autres termes, l’obligation abstraite de « diligence » définie à l’article 5 de la loi japonaise sur les contrats de travail est concrétisée par des lois individuelles qui définissent ce que les entreprises doivent faire à un niveau d’action. Comprendre cette structure est essentiel pour que les entreprises puissent construire un système de conformité intégré qui répond non seulement à la conformité fragmentée, mais aussi à l’exigence fondamentale de la loi de protéger les intérêts personnels des travailleurs.
Comparaison entre le principe d’égalité de traitement et l’obligation de précaution en matière de sécurité sous le droit japonais
Le “principe d’égalité de traitement” et l'”obligation de précaution en matière de sécurité”, que nous avons expliqués jusqu’à présent, partagent l’objectif commun de protéger la dignité et les droits humains des travailleurs. Cependant, ils diffèrent clairement dans leur nature juridique et le contenu des obligations qu’ils imposent aux entreprises. Le principe d’égalité de traitement est une “obligation de non-action” qui interdit le traitement discriminatoire basé sur des raisons spécifiques telles que la nationalité, les croyances ou le statut social. Il ordonne aux entreprises de ne pas commettre certains actes, en mettant l’accent sur l’assurance de l’équité entre les travailleurs. D’autre part, l’obligation de précaution en matière de sécurité est une “obligation d’action” qui exige des entreprises qu’elles prennent activement les précautions nécessaires pour protéger la vie et la santé physique et mentale des travailleurs. Elle vise à fournir à tous les travailleurs une base de conditions de travail sûres et saines.
Pour clarifier ces différences, le tableau suivant compare les caractéristiques des deux.
| Éléments de comparaison | Principe d’égalité de traitement | Obligation de précaution en matière de sécurité |
| Base juridique | Article 3 de la Loi sur les normes du travail du Japon | Article 5 de la Loi sur les contrats de travail du Japon |
| Objet de protection | Conditions de travail équitables, sans discrimination basée sur des attributs spécifiques (nationalité, croyances, statut social) | Sécurité incluant la vie, le corps et la santé mentale des travailleurs |
| Nature de l’obligation | Obligation de non-action interdisant un traitement défavorable pour des raisons spécifiques | Obligation d’action proactive pour assurer un environnement de travail sûr |
| Portée d’application | Conditions de travail générales après l’embauche | Environnement de travail général dans l’ensemble de la relation contractuelle de travail |
Comme le montre cette comparaison, le principe d’égalité de traitement concerne la “justice” des conditions de travail, tandis que l’obligation de précaution en matière de sécurité concerne la “salubrité” de l’environnement de travail. Les entreprises doivent respecter ces deux obligations simultanément et indépendamment. Par exemple, même si une entreprise offre des conditions de travail égales à tous les travailleurs, si l’environnement de travail global est médiocre en raison de surmenage ou de relations interpersonnelles inappropriées, elle pourrait être accusée de violer l’obligation de précaution en matière de sécurité. Inversement, même si un environnement de travail physiquement sûr est maintenu, l’emploi de travailleurs d’une certaine nationalité à un salaire déraisonnablement bas constituerait une violation du principe d’égalité de traitement. Par conséquent, pour une gestion efficace du personnel et une prévention des risques, il est essentiel de comprendre précisément les différences entre ces deux obligations et de mettre en place un système interne adapté à chacune d’elles.
Concrétisation des obligations légales de protection des intérêts personnels
L’obligation générale de précaution mentionnée précédemment ne se limite pas à un principe abstrait, mais est concrétisée par des lois spécifiques qui définissent les mesures que les entreprises doivent prendre. L’exemple le plus représentatif est la loi connue sous le nom de “loi de prévention du harcèlement au pouvoir”, qui est la loi japonaise révisée sur la promotion globale des politiques de travail. Cette loi impose légalement aux entreprises de prendre des mesures concrètes de gestion de l’emploi pour prévenir le harcèlement au pouvoir sur le lieu de travail. La codification de cette loi est révolutionnaire en ce qu’elle transforme le concept global de l’obligation de précaution en actions d’entreprise pratiques et vérifiables.
La loi exige des entreprises plus qu’une simple déclaration interdisant les actes de harcèlement. Elle impose plutôt la création et l’exploitation d’un système interne systématique pour prévenir le harcèlement avant qu’il ne se produise et pour y répondre de manière appropriée s’il se produit. Cette obligation est composée des quatre éléments principaux suivants.
Premièrement, il s’agit de “clarifier et de faire connaître et sensibiliser à la politique de l’employeur, etc.” Les entreprises doivent établir une politique claire selon laquelle le harcèlement au pouvoir n’est pas toléré sur le lieu de travail et doivent indiquer spécifiquement quels comportements constituent du harcèlement. De plus, elles doivent inscrire dans les règlements internes de l’entreprise la politique de traiter sévèrement les auteurs de harcèlement et les sanctions spécifiques qui seront appliquées, et s’assurer que tous les travailleurs sont pleinement informés de ces politiques par le biais de formations et de communications internes.
Deuxièmement, il s’agit de “mettre en place les structures nécessaires pour répondre de manière appropriée aux consultations”. Les entreprises doivent mettre en place des points de contact spécialisés pour les consultations sur le harcèlement, dont l’existence doit être connue de tous les travailleurs. De plus, il est obligatoire que le personnel des points de contact soit formé et dispose de manuels pour répondre de manière équitable et appropriée aux cas, tout en protégeant la vie privée des consultants.
Troisièmement, il s’agit de “répondre rapidement et de manière appropriée au harcèlement sur le lieu de travail après qu’il se soit produit”. Lorsqu’une consultation est reçue, l’entreprise doit rapidement enquêter sur les faits. Si les faits sont confirmés, des mesures de considération pour les travailleurs victimes (telles que des changements d’affectation) doivent être prises rapidement, et des sanctions disciplinaires appropriées doivent être appliquées aux auteurs conformément aux règlements internes. De plus, il est obligatoire de prendre des mesures pour prévenir la récurrence de cas similaires.
Quatrièmement, dans le cadre de la mise en œuvre de ces mesures, “la protection de la vie privée des consultants et l’interdiction de traitement défavorable” sont requises. Des mesures doivent être prises pour éviter que la vie privée des consultants et des personnes qui coopèrent avec les enquêtes ne soit violée, et il doit être clairement établi et communiqué aux travailleurs qu’aucun traitement défavorable, tel que le licenciement ou la rétrogradation, ne doit être appliqué pour des raisons telles que la consultation sur le harcèlement ou la coopération avec la vérification des faits.
Ces obligations légales signifient que l’exécution de l’obligation de précaution est évaluée non pas sur la base de la bonne foi ou des objectifs d’effort de l’entreprise, mais sur des processus et des procédures spécifiques. En cas de litige juridique, les tribunaux et les autorités administratives du travail examineront non seulement si l’entreprise a formellement mis en place ces systèmes, mais aussi si elle les a effectivement fait fonctionner efficacement. Par conséquent, il est extrêmement important pour les entreprises de construire et d’exploiter ces mesures non pas comme une simple “liste de vérification”, mais comme un mécanisme de gouvernance d’entreprise efficace pour protéger substantiellement les intérêts personnels des travailleurs, afin de remplir leurs responsabilités légales.
Résumé
Comme nous l’avons examiné dans cet article, le droit du travail japonais offre un cadre juridique solide qui va au-delà de la simple régulation des conditions de travail pour protéger la dignité fondamentale et les intérêts personnels des travailleurs. Le principe d’égalité de traitement, basé sur l’article 3 de la Loi sur les normes du travail japonaises (Japanese Labor Standards Act), interdit la discrimination fondée sur des attributs immuables tels que la nationalité, la croyance ou le statut social, garantissant ainsi l’équité sur le lieu de travail. D’autre part, l’obligation de diligence en matière de sécurité, ancrée dans l’article 5 de la Loi sur les contrats de travail japonaise (Japanese Labor Contract Act), impose aux entreprises de garantir le bien-être global des travailleurs, de la sécurité physique à la santé mentale. Ces principes ont évolué en normes d’action claires que les entreprises doivent suivre, grâce à l’accumulation de décisions judiciaires au fil des ans et à des mesures législatives concrètes telles que la légalisation des mesures de prévention du harcèlement au travail. Le non-respect de ces obligations peut entraîner non seulement des risques juridiques directs, tels que des réclamations de dommages-intérêts élevés ou des directives administratives, mais aussi avoir un impact négatif grave sur la réputation sociale de l’entreprise et le moral des employés.
Le cabinet d’avocats Monolith a une solide expérience dans la fourniture de conseils approfondis à de nombreuses entreprises clientes, tant nationales qu’internationales, concernant ces obligations complexes et profondes inhérentes au droit du travail japonais. Notre force réside dans notre connaissance approfondie du système juridique japonais combinée à une compréhension de l’environnement commercial international. Notre cabinet compte plusieurs avocats anglophones possédant également des qualifications juridiques étrangères, ce qui nous permet de soutenir la construction de systèmes de conformité pratiques et efficaces adaptés au contenu des activités et à la culture organisationnelle de chaque entreprise, avec une perspective internationale. Nous sommes prêts à soutenir vigoureusement votre entreprise dans la gestion de la protection des intérêts personnels des travailleurs, un enjeu crucial dans la gestion moderne, du point de vue juridique.
Category: General Corporate