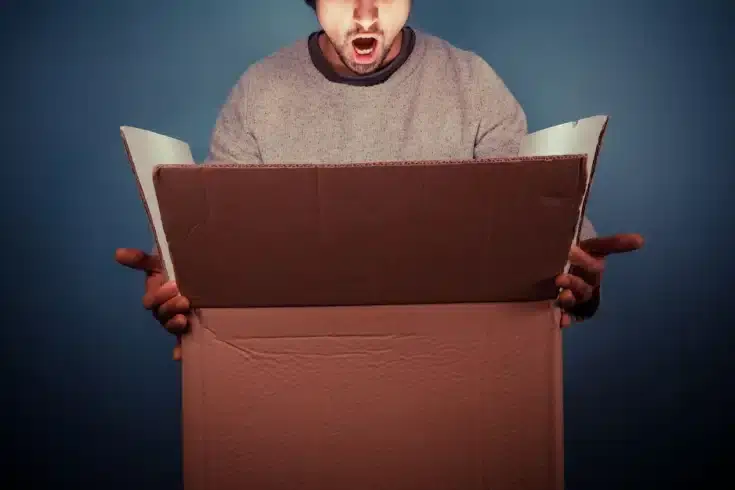La vente commerciale dans le droit commercial japonais : différences avec le code civil et points clés en pratique

Dans le système juridique japonais, les transactions entre entreprises, en particulier la vente de biens, sont régies par des règles spéciales qui diffèrent des contrats standards entre citoyens. Ces règles spéciales sont établies par le Code de commerce japonais. Bien que de nombreuses activités commerciales soient basées sur les principes généraux du droit des contrats définis par le Code civil japonais, les transactions entre commerçants, c’est-à-dire entre entités agissant dans le cadre d’une activité commerciale, sont principalement régies par le Code de commerce. Ces contrats de vente dans le cadre du commerce sont appelés “ventes commerciales”. Les dispositions du Code de commerce sont conçues pour refléter la réalité des transactions commerciales, en mettant l’accent sur la rapidité, la certitude et la stabilisation précoce des relations juridiques. Par conséquent, elles diffèrent considérablement des principes du Code civil et caractérisent parfois des obligations strictes pour les opérateurs économiques ou, à l’inverse, des droits puissants. Par exemple, l’acheteur est soumis à une obligation très stricte d’inspection et de notification des marchandises reçues, tandis que le vendeur a le droit de revendre rapidement les marchandises si l’acheteur refuse de les recevoir, afin de récupérer les dommages. Comprendre ces dispositions est essentiel pour mener des affaires sur le marché japonais, non seulement pour approfondir la connaissance des lois, mais aussi pour mener des négociations contractuelles de manière avantageuse et éviter des risques imprévus. Cet article explique l’importance pratique des règles spécifiques applicables aux ventes commerciales au Japon, en les comparant avec le Code civil et en illustrant avec des exemples concrets de jurisprudence.
Différences fondamentales entre la vente commerciale et la vente civile sous le droit japonais
Dans le système de droit privé du Japon, le Code civil japonais occupe la position de “loi générale” applicable à la vie sociale dans son ensemble. En revanche, le Code de commerce japonais est considéré comme une “loi spéciale” qui s’applique exclusivement au domaine spécifique des activités commerciales des commerçants. Selon le principe de la primauté du droit spécial sur le droit général, lorsque une transaction est qualifiée de vente commerciale, les règles du Code de commerce ont priorité sur celles du Code civil pour les questions réglementées par les deux codes. L’article 1, paragraphe 2, du Code de commerce japonais établit clairement l’ordre de priorité en stipulant que, pour les affaires commerciales, le Code de commerce s’applique en premier lieu, suivi par les usages commerciaux en l’absence de dispositions dans le Code de commerce, et enfin le Code civil si aucun usage commercial n’est applicable.
La distinction entre ces deux lois repose sur la différence de leurs objectifs. Alors que le Code civil privilégie la protection des droits individuels et permet une résolution flexible et parfois prolongée, le Code de commerce donne la priorité à la rapidité et à la certitude des transactions entre commerçants, qui ont pour but la recherche du profit. Cette philosophie se reflète fortement dans les dispositions concrètes du Code de commerce. Par exemple, en matière de représentation dans les actes de commerce, contrairement au Code civil qui exige que l’agent agisse ouvertement pour le compte du principal, le Code de commerce élimine cette exigence, favorisant ainsi l’accélération des transactions. De plus, lorsque plusieurs personnes contractent une dette par le biais d’une opération commerciale, le principe de la dette solidaire, qui facilite le recouvrement des créances, prévaut sur le principe de la dette divisée du Code civil. Ainsi, les dispositions du Code de commerce offrent un cadre prévisible et rationnel qui repose sur l’hypothèse que les opérateurs économiques possèdent des connaissances spécialisées avancées et une tolérance au risque, et encouragent une gestion autonome des risques et des actions rapides de la part des parties concernées.
L’obligation extrêmement importante de l’acheteur : l’inspection et la notification de l’objet de la vente
Dans les transactions commerciales, l’une des obligations les plus importantes et les plus strictes que l’acheteur doit respecter est celle de l’inspection et de la notification de l’objet de la vente, telle que définie à l’article 526 du Code de commerce japonais (商法, Shōhō). Cette disposition incarne les principes du droit commercial japonais, qui visent à accélérer la conclusion des transactions et à stabiliser rapidement les relations juridiques. Si l’acheteur ne comprend pas correctement son contenu, il risque de subir des désavantages considérables.
Le contenu des réglementations et leur rationalité sous le droit commercial japonais
L’article 526, paragraphe 1, du Code de commerce japonais stipule que, dans les transactions de vente entre commerçants, l’acheteur doit « sans délai » inspecter l’objet de la vente dès sa réception. Le paragraphe 2 du même article précise que si cette inspection révèle que l’objet ne correspond pas à la nature, à la qualité ou à la quantité stipulées dans le contrat (non-conformité contractuelle), l’acheteur doit « immédiatement » en notifier le vendeur. À défaut de cette notification, l’acheteur perd le droit de résilier le contrat, de demander une réduction du prix ou de réclamer des dommages-intérêts. Cet effet de perte de droits est appelé « effet de déchéance » et constitue une restriction significative des droits de l’acheteur.
De plus, même si la non-conformité contractuelle n’est pas immédiatement détectable en raison de sa nature, l’acheteur a l’obligation de la découvrir et d’en notifier le vendeur dans un délai de six mois suivant la livraison de l’objet. Si la découverte et la notification ne sont pas effectuées dans ce délai de six mois, l’acheteur perd également ses droits.
La raison d’être de ces dispositions strictes est de protéger le vendeur et d’apporter une résolution rapide aux transactions commerciales. Le vendeur est ainsi libéré de la possibilité de recevoir des réclamations de l’acheteur sur une longue période, ce qui lui permet de gérer son entreprise de manière stable. La loi attend de l’acheteur, en tant que commerçant doté de connaissances spécialisées, qu’il procède à une inspection et une notification rapides.
Les effets rigoureux de la déchéance de droits sous le droit commercial japonais
Un arrêt de la Cour suprême du Japon en date du 20 octobre 1992 (1992) illustre à quel point la perte de droits en vertu de l’article 526 du Code de commerce japonais peut être implacable. Cette décision a établi qu’une fois que l’acheteur perd ses droits à résilier le contrat ou à réclamer des dommages-intérêts pour ne pas avoir respecté ses obligations d’inspection et de notification, il ne peut plus non plus exiger du vendeur la livraison d’un bien conforme au contrat (exécution parfaite).
Cela renverse l’attente naïve selon laquelle, même si l’acheteur ne peut plus réclamer des dommages-intérêts pour avoir retardé la notification, il ne perdrait pas le droit de demander le produit tel qu’il avait été initialement convenu dans le contrat. Cette jurisprudence démontre l’importance que le droit commercial japonais accorde à la finalité des transactions. Si l’acheteur n’agit pas rapidement, la loi accepte que l’acheteur reste avec un produit non conforme au contrat, scellant ainsi la transaction. Cela souligne l’impératif pour les entreprises de mettre en place un système d’inspection des marchandises après réception extrêmement rigoureux.
L’« malveillance » du vendeur et son interprétation contemporaine sous le droit japonais
Certes, il existe des exceptions aux règles strictes de l’article 526 du Code de commerce japonais. Le paragraphe 3 de cet article stipule que si le vendeur a livré la marchandise au client en étant « malveillant », c’est-à-dire en connaissant les défauts sans en informer l’acheteur, alors l’obligation de l’acheteur d’inspecter et de notifier est levée, et il ne perd pas ses droits .
Concernant l’interprétation de cette « malveillance », les décisions judiciaires récentes au Japon montrent une tendance remarquable. Le jugement du Tribunal supérieur de Tokyo en date du 8 décembre 2022 (Reiwa 4) a traité d’un cas où une erreur d’impression sur l’étiquette à code-barres d’un vêtement était en question. Il a été décidé que même si le vendeur n’était pas conscient du défaut (malveillance), si son ignorance résultait d’une « négligence grave », cela pourrait être considéré de la même manière que s’il y avait eu malveillance. Ce jugement indique que si le système de contrôle de qualité du vendeur présente des lacunes significatives et qu’une erreur grave a été négligée, alors même qu’il n’y avait pas de conscience subjective du défaut, le vendeur ne peut pas bénéficier de la protection offerte par l’article 526 du Code de commerce. Cela peut être interprété comme un effort de la justice pour corriger l’application de règles trop strictes dans des cas où une injustice flagrante pourrait survenir, ouvrant ainsi une voie importante de recours pour l’acheteur.
La compensation pour inaction illustrée par la jurisprudence japonaise
Un exemple où l’obligation d’inspection et de notification, applicable à des actifs complexes tels que l’immobilier, a entraîné de sévères conséquences pour l’acheteur est illustré par le jugement du Tribunal de district de Tokyo en date du 28 octobre 1992 (1992). Dans cette affaire, l’acheteur, un professionnel de l’immobilier, a acquis un terrain et, environ un an et demi après la livraison, a découvert une grande quantité de déchets industriels enfouis dans le sol. Bien que le tribunal ait reconnu l’existence de ces déchets comme un défaut de conformité du contrat, il a refusé d’accorder une indemnisation pour les frais d’élimination des déchets au motif que l’acheteur, bien qu’étant un professionnel, avait négligé d’inspecter le terrain sans délai et d’en informer le vendeur, conformément à l’article 526 du Code de commerce japonais. Ce jugement souligne l’importance pratique de l’obligation d’inspection, qui s’étend aux biens immobiliers et non seulement aux biens mobiliers, et montre à quel point l’exigence d’agir “sans délai” est interprétée de manière stricte.
Modification de l’article 526 du Code de commerce par une clause contractuelle : l’importance des conventions spéciales sous le droit commercial japonais
Alors que l’article 526 du Code de commerce japonais impose des dispositions très strictes pour l’acheteur, il est possible de modifier ces dispositions par un accord entre les parties. En droit, de telles dispositions que les parties peuvent exclure par leur volonté sont appelées « dispositions facultatives ». Par conséquent, en intégrant dans le contrat de vente une convention spéciale différente de l’article 526 du Code de commerce, les parties peuvent gérer leurs propres risques.
L’importance de cette convention spéciale a été clairement démontrée par un jugement du Tribunal de district de Tokyo en date du 20 janvier 2011 (2011). Dans cette affaire, l’acheteur d’un terrain a découvert une contamination du sol environ 11 mois après la livraison et a réclamé au vendeur environ 15 millions de yens pour les frais de remédiation. Le vendeur a refusé de payer, invoquant la limite de six mois imposée par l’article 526 du Code de commerce.
Cependant, le contrat de vente en question contenait une clause stipulant que « les vices cachés seront traités par le vendeur conformément aux dispositions du Code civil ». Le tribunal a interprété cette clause comme un accord entre les parties pour exclure intentionnellement les règles strictes du Code de commerce (article 526) et appliquer des règles plus favorables à l’acheteur du Code civil (une notification dans l’année suivant la découverte de la non-conformité suffit). En conséquence, il a été jugé que le vendeur était responsable de la contamination du sol découverte après la période de six mois, et la demande d’indemnisation a été acceptée.
Cette jurisprudence montre qu’une seule phrase dans un contrat peut complètement renverser la répartition des risques établie par la loi et entraîner des conséquences financières de l’ordre de plusieurs dizaines de millions de yens. L’existence de l’article 526 du Code de commerce façonne la dynamique même des négociations contractuelles. Un vendeur informé pourrait choisir de se taire sur ce point afin de bénéficier des règles par défaut de la loi qui lui sont favorables. D’autre part, un acheteur informé exigera fermement l’extension de la période d’inspection ou l’inclusion d’une clause excluant explicitement l’application de l’article 526 du Code de commerce dans le contrat. Cela met en évidence que la connaissance de la loi n’est pas seulement une question de conformité, mais un outil de négociation stratégique directement lié aux intérêts de l’entreprise.
Les droits du vendeur : La revente des biens refusés (Droit de vente forcée sous le droit commercial japonais)
Le droit commercial japonais impose des obligations strictes à l’acheteur tout en accordant au vendeur des droits puissants pour conclure rapidement la transaction. Un exemple emblématique est le “droit de vente forcée”, établi à l’article 524 du Code de commerce japonais. Ce droit permet au vendeur de disposer d’un bien lorsque l’acheteur refuse sans raison valable de le recevoir ou est incapable de le faire, afin de récupérer les pertes subies.
Plus précisément, le vendeur peut, après avoir donné un préavis raisonnable à l’acheteur, mettre l’objet en vente aux enchères. De plus, si l’objet est susceptible de se détériorer ou de perdre de la valeur, le vendeur peut procéder à la vente aux enchères sans même ce préavis.
La force de ce droit est évidente lorsqu’on le compare aux règles du Code civil japonais. En effet, sous le Code civil, le vendeur doit généralement obtenir l’autorisation du tribunal pour mettre un bien aux enchères dans une situation similaire. Le Code de commerce élimine cette barrière procédurale judiciaire, permettant au vendeur d’agir rapidement.
Un autre point important concerne le traitement du produit de la vente aux enchères. Le vendeur peut directement l’imputer sur le prix de vente. Cela permet au vendeur d’éviter les tracas d’intenter une action en justice pour recouvrer une créance et de récupérer immédiatement des fonds. Le droit de vente forcée est un outil de réduction des pertes extrêmement pratique pour libérer le vendeur du risque de stockage de marchandises invendues et de l’augmentation des coûts de stockage. Ce droit complète l’obligation de l’acheteur d’inspecter et de notifier, les deux facilitant la résolution rapide des impasses dans les transactions commerciales et favorisant la résolution finale, conformément aux objectifs du droit commercial japonais.
Les obligations de l’acheteur : conservation et consignation des biens après résiliation du contrat sous le droit commercial japonais
Dans le cadre des transactions commerciales, il est essentiel de prêter attention aux obligations spécifiques de l’acheteur après la résiliation d’un contrat. Même si l’acheteur résilie légitimement le contrat en raison de la non-conformité des marchandises, les articles 527 et 528 du Code de commerce japonais imposent certaines obligations à l’acheteur.
Plus précisément, l’acheteur doit, même après avoir résilié le contrat, conserver ou consigner l’objet reçu aux frais du vendeur. Cette obligation s’applique également dans le cas où des marchandises différentes de celles commandées sont livrées ou si la quantité livrée dépasse celle commandée. Si les biens risquent d’être perdus ou endommagés, l’acheteur doit obtenir l’autorisation du tribunal pour les vendre aux enchères et conserver ou consigner le produit de la vente.
Cette obligation, qui peut sembler contre-intuitive à première vue, a été établie pour protéger les droits de propriété du vendeur dans les transactions entre commerçants éloignés géographiquement. Elle vise à empêcher que les marchandises soient simplement abandonnées et perdent de leur valeur, en faisant de l’acheteur un gestionnaire temporaire jusqu’à ce que le vendeur prenne des mesures appropriées, telles que la récupération des biens. L’objectif de cette disposition est clair au vu de son champ d’application. L’article 527, paragraphe 4, du Code de commerce japonais stipule que cette obligation de conservation ne s’applique pas lorsque les établissements du vendeur et de l’acheteur sont situés dans la même municipalité, car dans ce cas, le vendeur peut facilement récupérer les marchandises et il n’est pas nécessaire d’imposer une telle charge à l’acheteur. Cette disposition reflète la considération rationnelle du droit commercial pour résoudre les problèmes pratiques des transactions nationales et internationales.
Comparaison entre le Code civil et le Code de commerce au Japon : Résumé des principales différences
Comme nous l’avons expliqué précédemment, les transactions commerciales au Japon sont régies par de nombreuses règles spéciales qui diffèrent de celles des transactions civiles. Comprendre ces différences est la première étape dans la gestion des risques lors des transactions entre entreprises. Voici un tableau récapitulatif des principales différences abordées dans cet article.
| Points de réglementation | Principes dans le Code civil japonais | Règles spéciales dans le Code de commerce japonais |
| Obligation de notification d’inspection de l’acheteur | Pas de disposition spécifique. Il suffit de notifier dans l’année suivant la découverte de la non-conformité (Article 566 du Code civil japonais). | Obligation d’inspecter « sans délai » après réception de l’objet et de notifier « immédiatement ». Pour les non-conformités non immédiatement détectables, la notification est nécessaire dans les six mois suivant la livraison. Le non-respect de cette obligation entraîne la perte des droits (Article 526 du Code de commerce japonais). |
| Droits du vendeur en cas de refus de réception par l’acheteur | Peut procéder à une vente aux enchères avec l’autorisation du tribunal. Le prix doit être consigné (Article 497 du Code civil japonais). | Possibilité de vente aux enchères sans autorisation judiciaire (vente de gré à gré). Le prix peut être directement imputé sur le montant de la vente (Article 524 du Code de commerce japonais). |
| Obligations de l’acheteur après résiliation du contrat | Obligation de restituer l’objet (obligation de remise en état). | En cas de transaction à distance, obligation de conserver ou de consigner l’objet aux frais du vendeur (Article 527 du Code de commerce japonais). |
Ce tableau montre que les transactions entre entreprises (B2B) présentent un profil de risque fondamentalement différent de celui des transactions avec les consommateurs (B2C) ou des transactions entre particuliers (C2C). La différence des règles concernant l’obligation de notification d’inspection de l’acheteur est particulièrement importante dans la pratique.
Résumé
Les règles de la vente commerciale définies par le droit commercial japonais constituent un système juridique spécialement conçu pour les transactions entre entreprises, privilégiant la rapidité et la certitude. Ce système se distingue des principes généraux du droit civil en imposant aux parties des obligations strictes et des droits puissants pour stabiliser rapidement les transactions. En particulier, l’obligation d’inspection et de notification de l’acheteur établie par l’article 526 du droit commercial japonais est un élément crucial que tous les opérateurs économiques doivent comprendre en profondeur, en raison de sa rigueur et des conséquences graves de la perte de droits qui peuvent en découler. Si cette obligation est négligée, même en présence de défauts évidents dans le produit, l’acheteur peut se voir complètement privé de recours légaux. Cependant, ces dispositions peuvent être modifiées par accord entre les parties, et une simple clause contractuelle peut considérablement changer la localisation des risques. Par conséquent, dans les ventes commerciales, il est essentiel de comprendre les règles par défaut de la loi pour négocier des contrats de manière stratégique afin de protéger la position de votre entreprise.
Le cabinet d’avocats Monolith possède une vaste expérience dans la fourniture de services juridiques liés à la vente commerciale pour de nombreux clients au Japon. Notre cabinet compte plusieurs membres qui sont des avocats qualifiés à l’étranger et anglophones, ce qui nous permet d’offrir un soutien complet en japonais et en anglais, allant de la création et de la révision de contrats aux résolutions de conflits dans le cadre de transactions internationales. Nous sommes prêts à soutenir vigoureusement votre entreprise du point de vue juridique, alors n’hésitez pas à nous consulter.
Category: General Corporate