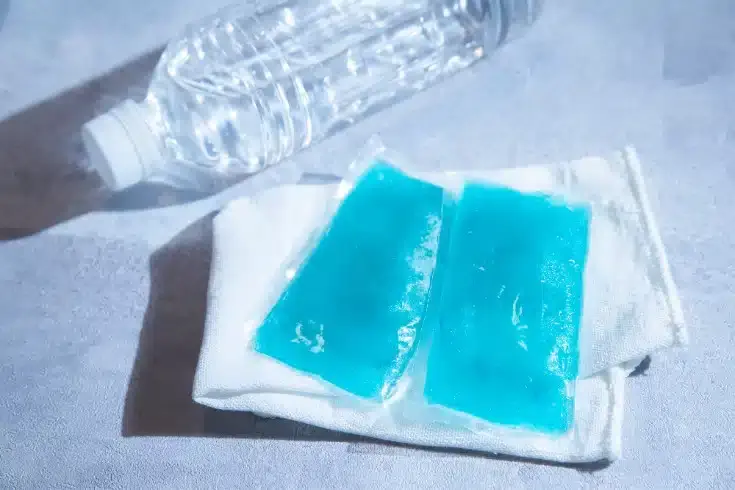Les principes des heures de travail et des jours de repos dans le droit du travail japonais, et le travail en heures supplémentaires et pendant les jours fériés

Dans la gestion des ressources humaines, qui constitue le fondement de l’activité des entreprises, la régulation des heures de travail et des jours de repos est l’un des éléments les plus fondamentaux et essentiels. Le droit du travail au Japon, et en particulier la Loi sur les normes du travail japonaise (Japanese Labor Standards Act), établit des principes stricts concernant les heures de travail et les jours de repos afin de protéger la santé et le bien-être des travailleurs. Ces réglementations ne peuvent pas être librement définies par de simples règlements internes ou des contrats entre les parties, mais doivent suivre les limites et les procédures établies par la loi, et leur respect est obligatoire pour toutes les entreprises. En principe, le travail au-delà des heures légales ou pendant les jours de repos légaux est interdit par la loi, et des sanctions peuvent être appliquées en cas de violation. Pour lever exceptionnellement cette interdiction et ordonner légalement des heures supplémentaires ou du travail pendant les jours de repos, il est nécessaire de conclure un accord spécifique entre employeurs et employés, connu sous le nom d’accord “36” (sabu-roku kyoutei), et de le déclarer auprès des autorités administratives suivant une procédure stricte. Cet article commence par clarifier la définition des “heures de travail” dans le droit japonais à travers la jurisprudence, puis explique les principes de base des heures de travail et des jours de repos. Ensuite, il détaille le cadre des heures supplémentaires et du travail pendant les jours de repos basé sur l’accord 36, ainsi que les obligations de paiement de la rémunération majorée qui l’accompagnent. Enfin, nous examinerons également la position des “cadres dirigeants”, une exception importante à ces principes, en étudiant ses critères stricts à travers des cas de jurisprudence. Comprendre et respecter précisément ces réglementations est essentiel pour assurer la conformité et construire des relations de travail saines.
Définition des « heures de travail » selon le droit du travail au Japon
Comprendre la définition légale des « heures de travail » est essentiel pour appréhender le droit du travail au Japon. En effet, la question de savoir si un certain temps est considéré comme du temps de travail est cruciale pour l’obligation de paiement des salaires, en particulier pour le calcul des salaires majorés. La jurisprudence de la Cour suprême du Japon établit de manière cohérente que les « heures de travail » ne sont pas déterminées par les dispositions du contrat de travail ou du règlement intérieur, mais sont objectivement jugées comme étant le temps pendant lequel le travailleur est sous les ordres et la direction de l’employeur. Cette notion d’être « sous ordres » inclut non seulement les instructions explicites, mais aussi les instructions implicites ou les situations où un certain comportement est imposé, ce qui signifie que la portée des heures de travail peut être plus large que ce que l’entreprise anticipe.
Il existe deux cas de jurisprudence importants qui illustrent ce critère. Le premier concerne les activités préparatoires au travail dans l’affaire de l’usine de construction navale de Mitsubishi Heavy Industries à Nagasaki (arrêt de la Cour suprême du Japon du 9 mars 2000). Dans cette affaire, il a été contesté si le temps passé par les employés de l’usine à enfiler des vêtements de travail et des équipements de protection dans le vestiaire avant l’heure de début du travail et à se déplacer vers le lieu de travail était considéré comme du temps de travail. La Cour suprême a jugé que, puisque l’entreprise avait imposé le port de ces vêtements pour des raisons de sécurité et de santé et avait donné des instructions pour les enfiler dans un lieu désigné au sein de l’établissement, ces actions étaient considérées comme étant sous les ordres de l’employeur. Autrement dit, même si ces actions ne sont pas le travail en lui-même, elles sont des activités préparatoires essentielles pour le travail et le temps pendant lequel les employés sont contraints par les instructions de l’entreprise, tant en termes de lieu que de temps, est considéré comme du temps de travail légal.
Le second cas concerne le temps d’attente (temps d’inactivité) dans l’affaire de la gestion de l’immeuble Daiboshi (arrêt de la Cour suprême du Japon du 28 février 2002). Dans cette affaire, il a été question de savoir si le temps de sommeil pendant les 24 heures de service des employés chargés de la gestion des installations d’un bâtiment était considéré comme du temps de travail. Les employés étaient tenus de rester en attente dans la salle de repos et de répondre immédiatement en cas d’alarme ou de communication urgente. La Cour suprême a jugé que, dans de telles circonstances, même si les employés dormaient réellement et qu’aucun incident ne se produisait, ils n’étaient pas « complètement libérés du travail » et étaient donc sous les ordres de l’employeur. En d’autres termes, le temps passé en attente, prêt à s’engager dans le travail à tout moment, même s’il est désigné comme « pause » ou « sommeil », est légalement considéré comme du temps de travail.
Comme le montrent ces cas de jurisprudence, la reconnaissance des heures de travail est jugée objectivement, non pas sur la base de la dénomination formelle ou du contenu du contrat, mais en fonction de la réalité de savoir si le travailleur est sous la gestion de l’employeur et si sa liberté d’action est restreinte. Cela suggère que les entreprises peuvent involontairement générer des « heures de travail cachées », entraînant un risque de réclamations pour salaires impayés.
Principes des heures de travail et des jours de repos sous le droit japonais
La Loi sur les normes du travail au Japon (Japanese Labor Standards Act) établit deux grands principes en tant que normes minimales pour les heures de travail et les jours de repos, qui s’appliquent à tous les lieux de travail, indépendamment de la taille de l’entreprise ou du secteur d’activité.
Premièrement, il y a la limite supérieure des heures de travail. L’article 32 de la Loi sur les normes du travail au Japon stipule que l’employeur ne doit pas faire travailler un employé plus de 40 heures par semaine, hors temps de pause, et pas plus de 8 heures par jour. Ce sont les “heures de travail légales”, et tout travail au-delà de ces limites est en principe illégal. Cette double limite de “8 heures par jour et 40 heures par semaine” est stricte et ne permet pas de dépasser l’une ou l’autre.
Deuxièmement, il y a l’obligation d’accorder des jours de repos. L’article 35 de la Loi sur les normes du travail au Japon impose à l’employeur de fournir au moins un jour de repos par semaine à l’employé. C’est le “principe du repos hebdomadaire”. À titre d’exception, le paragraphe 2 du même article permet d’accorder “au moins quatre jours de repos sur une période de quatre semaines”, mais cela est destiné à des formes de travail irrégulières, le principe étant un jour de repos par semaine. Le “jour de repos” mentionné ici est basé sur le calendrier (24 heures de minuit à minuit) et désigne un jour où l’employé est complètement exempté de son obligation de travail en vertu du contrat de travail.
En pratique, ces principes des heures de travail légales et des jours de repos légaux ont des conséquences importantes. Par exemple, dans une entreprise où les heures de travail quotidiennes sont fixées à 8 heures, travailler 5 jours par semaine équivaut à 40 heures de travail par semaine (8 heures x 5 jours), atteignant ainsi la limite supérieure des heures de travail légales. Si l’employé travaille un sixième jour, cela constituerait une violation de la limite de 40 heures par semaine. Par conséquent, une entreprise qui adopte un système de travail de 8 heures par jour doit, en réalité, établir deux jours de repos par semaine pour respecter à la fois le principe du repos hebdomadaire (un jour de repos par semaine) et la limite de 40 heures par semaine.
Ces deux jours de repos diffèrent juridiquement. Un jour est un “jour de repos légal” obligatoire en vertu de l’article 35 de la Loi sur les normes du travail au Japon, et l’autre est un “jour de repos prévu” (jour de repos non légal) déterminé par l’entreprise. Cette distinction est extrêmement importante pour le calcul des salaires majorés. Si l’employé travaille pendant le jour de repos légal, il est considéré comme du “travail en jour de repos” et nécessite une majoration salariale d’au moins 35%. En revanche, si l’employé travaille pendant le jour de repos prévu, toute heure travaillée au-delà des 40 heures légales de la semaine est considérée comme du “travail supplémentaire” et nécessite une majoration salariale d’au moins 25%. Par conséquent, il est essentiel de définir clairement dans le règlement intérieur de l’entreprise quel jour de la semaine est considéré comme le jour de repos légal, tant du point de vue de la gestion du personnel que de la gestion des coûts.
Le travail au-delà des limites légales : les heures supplémentaires et le travail en jours fériés selon l’accord 36 en droit japonais
Les principes des heures de travail légales (8 heures par jour et 40 heures par semaine) et des jours de repos légaux établis par la Loi sur les normes du travail japonaise ne sont pas absolus. En suivant certaines procédures légales, il est exceptionnellement permis de faire travailler au-delà de ces limites. La base principale pour le travail en heures supplémentaires et les jours fériés est l’accord entre employeurs et employés selon l’article 36 de la Loi sur les normes du travail (communément appelé « accord 36 »). Cependant, en cas de désastre ou d’autres nécessités temporaires (article 33 de la Loi sur les normes du travail), il est exceptionnellement possible de travailler au-delà des limites avec une autorisation ou une notification postérieure.
Faire travailler les employés au-delà des heures légales de travail ou pendant les jours de repos légaux sans conclure un accord 36 est illégal, même si les travailleurs sont d’accord, et cela peut entraîner des sanctions. Pour qu’un accord 36 soit valablement établi, il faut d’abord conclure un accord écrit avec le syndicat représentant la majorité des travailleurs de l’entreprise ou, en l’absence d’un tel syndicat, avec un représentant de la majorité des travailleurs. Ensuite, et c’est la procédure la plus importante, l’accord conclu doit être notifié au directeur de l’inspection des normes du travail compétent. Cette notification est une condition requise pour que l’accord 36 prenne effet légalement, et le travail en heures supplémentaires et les jours fériés ne sont possibles qu’après avoir conclu l’accord 36 et notifié l’accord au directeur de l’inspection des normes du travail compétent.
Même en cas de conclusion d’un accord 36, le travail en heures supplémentaires n’est pas illimité. La loi impose des limites strictes sur les heures supplémentaires. En principe, la limite des heures supplémentaires est de 45 heures par mois et de 360 heures par an.
Cependant, en cas de circonstances spéciales temporaires, telles qu’une augmentation imprévisible du volume de travail, il est possible de conclure un « accord 36 avec clause spéciale » qui permet de dépasser ces limites. Ces « circonstances spéciales temporaires » ne peuvent être justifiées par des raisons abstraites telles que « lorsque nécessaire pour les affaires », mais doivent être concrètes et temporaires, comme des changements de spécifications imprévus ou la gestion de réclamations à grande échelle.
Même en appliquant une clause spéciale, la loi établit des limites absolues qui ne peuvent être dépassées sous peine de sanctions.
- Les heures supplémentaires ne doivent pas dépasser 720 heures par an.
- La somme des heures supplémentaires et du travail en jours fériés doit être inférieure à 100 heures par mois.
- La somme des heures supplémentaires et du travail en jours fériés, en moyenne sur des périodes de 2, 3, 4, 5 ou 6 mois, ne doit pas dépasser 80 heures par mois.
- Il est possible de dépasser 45 heures d’heures supplémentaires par mois seulement pendant 6 mois dans l’année.
En particulier, la troisième limite, celle de « 80 heures en moyenne sur plusieurs mois », fonctionne comme un mécanisme puissant pour inciter les entreprises à réduire le travail en heures supplémentaires de manière continue. Par exemple, si la somme des heures supplémentaires et du travail en jours fériés atteint 99 heures un mois (juste en dessous de la limite de 100 heures par mois), le total pour le mois suivant ne peut excéder 61 heures ((99 heures + 61 heures) ÷ 2 mois = 80 heures). Ainsi, si un mois connaît une augmentation temporaire des heures de travail, il faudra ensuite réduire considérablement les heures de travail les mois suivants, obligeant les entreprises à non seulement enregistrer les heures de travail, mais aussi à gérer de manière planifiée les heures de travail futures.
Coûts monétaires : la majoration salariale sous le droit japonais
Les entreprises ont l’obligation de payer une majoration salariale (prime) au-delà du salaire habituel pour le travail effectué au-delà des heures légales de travail, pendant les jours fériés légaux ou pendant les heures de nuit. Cette obligation est définie à l’article 37 de la Loi sur les normes du travail au Japon et a un impact direct sur les finances des entreprises.
Le taux de la majoration salariale varie selon le type de travail effectué.
- Heures supplémentaires : pour le travail effectué au-delà des heures de travail légales (8 heures par jour ou 40 heures par semaine), une majoration salariale calculée à un taux d’au moins 25% du salaire habituel doit être payée.
- Heures supplémentaires au-delà de 60 heures par mois : pour la partie des heures supplémentaires dépassant 60 heures par mois, le taux de majoration est porté à au moins 50%. Cette réglementation s’applique à toutes les entreprises, y compris les PME, à partir du 1er avril 2023.
- Travail le jour férié : lorsqu’un travail est effectué pendant un jour férié légal défini à l’article 35 de la Loi sur les normes du travail au Japon, une majoration salariale d’au moins 35% est requise. Cela se distingue du travail effectué pendant les jours de repos prévus (jours fériés non légaux).
- Travail de nuit : pour le travail effectué entre 22 heures et 5 heures du matin, une majoration salariale d’au moins 25% (indemnité de nuit) doit être payée.
Ces taux de majoration sont cumulatifs. Par exemple, si un travail est effectué pendant les heures de nuit en plus des heures supplémentaires, le taux de majoration pour les heures supplémentaires de 25% et celui pour le travail de nuit de 25% sont additionnés, ce qui nécessite une majoration salariale totale d’au moins 50%. De même, pour le travail effectué pendant un jour férié et pendant les heures de nuit, le taux de majoration est d’au moins 60%, soit la somme de 35% pour le travail le jour férié et de 25% pour le travail de nuit.
La base de calcul de ces majorations salariales est le salaire habituel des heures de travail ou des jours de travail de l’employé. Cependant, certains types de salaires définis à l’article 21 du Règlement d’application de la Loi sur les normes du travail au Japon peuvent être exclus de ce salaire de base. Les salaires qui peuvent être exclus sont limités à ceux versés en fonction des circonstances personnelles du travailleur, et incluent spécifiquement les éléments suivants :
- Allocation familiale
- Indemnité de transport
- Allocation de séparation
- Allocation pour l’éducation des enfants
- Allocation de logement
- Salaire versé de manière ponctuelle
- Salaire versé pour des périodes dépassant un mois (comme les bonus)
Cependant, la question de savoir si ces allocations peuvent être exclues ou non est déterminée par leur substance et non par leur nom. Par exemple, même si elle est appelée “allocation de logement”, si un montant uniforme est versé à tous les employés, cela est considéré comme indépendant des circonstances personnelles et ne peut pas être exclu du salaire de base.
Ci-dessous, un résumé des taux de majoration salariale :
| Type de travail | Taux de majoration (minimum) |
| Heures supplémentaires (au-delà des heures légales) | 25% ou plus |
| Heures supplémentaires (partie dépassant 60 heures par mois) | 50% ou plus |
| Travail le jour férié (travail pendant un jour férié légal) | 35% ou plus |
| Travail de nuit (22h à 5h) | 25% ou plus |
| Heures supplémentaires + Travail de nuit | 50% ou plus (25%+25%) |
| Travail le jour férié + Travail de nuit | 60% ou plus (35%+25%) |
| Heures supplémentaires au-delà de 60 heures par mois + Travail de nuit | 75% ou plus (50%+25%) |
Cette majoration salariale, en particulier le taux élevé de 50% pour le travail dépassant 60 heures par mois, reflète fortement une intention politique visant non seulement à établir une règle de calcul des salaires, mais aussi à inciter économiquement les entreprises à limiter les heures de travail prolongées et à protéger la santé des travailleurs.
Une exception importante : le « cadre dirigeant » sous le droit du travail japonais
Les réglementations strictes concernant les heures de travail, les pauses et les jours de repos que nous avons évoquées jusqu’à présent comportent une exception importante établie par l’article 41 de la Loi sur les normes du travail japonaise. Cette disposition stipule que les règles relatives aux heures de travail, aux pauses et aux jours de repos ne s’appliquent pas aux « personnes occupant un poste de supervision ou de gestion, quel que soit le type d’entreprise » (ci-après dénommées « cadres dirigeants »). Par conséquent, les entreprises ne sont pas tenues de payer des salaires majorés pour les heures supplémentaires ou le travail effectué pendant les jours de repos aux employés qui sont considérés comme des cadres dirigeants.
Cependant, la détermination de l’applicabilité du statut de cadre dirigeant ne se base pas formellement sur le titre de poste conféré par l’entreprise (comme « chef de département » ou « chef de section »), mais est strictement jugée en fonction de la réalité des fonctions, des responsabilités et des pouvoirs de l’employé, ainsi que de ses conditions de travail. Les tribunaux japonais tendent à interpréter cette exception de manière très limitée et ne l’admettent pas facilement. À travers l’interprétation administrative et de nombreux précédents judiciaires, il est établi qu’un employé doit satisfaire à trois critères pour être reconnu comme cadre dirigeant :
- Des fonctions, responsabilités et pouvoirs importants alignés avec ceux des dirigeants : l’employé doit détenir des pouvoirs significatifs dans la gestion du personnel de l’entreprise, tels que le recrutement, le licenciement, l’évaluation du personnel et la détermination des conditions de travail. Il ne suffit pas d’avoir des subordonnés ; il faut pouvoir prendre des décisions politiques pour son département avec une autorité comparable à celle des dirigeants.
- Un mode de travail exempt de gestion stricte des heures de travail : l’employé doit avoir une grande latitude concernant ses heures d’arrivée et de départ ainsi que la manière d’exécuter ses tâches. Si l’entreprise contrôle strictement les heures d’arrivée et de départ, ou si les retards ou les départs anticipés entraînent une réduction de salaire, l’employé ne sera pas considéré comme un cadre dirigeant. Il est essentiel d’être en mesure d’ajuster ses heures de travail de manière flexible en fonction des besoins de gestion.
- Une rémunération et des avantages correspondant à la position : le salaire, y compris le salaire de base et les indemnités de fonction, doit être avantageux par rapport à celui des employés ordinaires et correspondre à l’importance des responsabilités. Si le traitement n’est pas suffisamment élevé pour compenser l’absence de paiement des heures supplémentaires, cela peut être un facteur décisif pour nier le statut de cadre dirigeant.
Un exemple emblématique de cette interprétation stricte est l’affaire McDonald’s Japon (jugement du Tribunal de district de Tokyo du 28 janvier 2008). Dans cette affaire, le tribunal a jugé que le gérant d’un restaurant de hamburgers, bien qu’il disposât de certains pouvoirs en matière de gestion du magasin, n’était pas impliqué dans la prise de décision concernant la politique de gestion de l’entreprise dans son ensemble, et que sa latitude en matière d’heures de travail était limitée, notamment en raison de la nécessité de prendre des quarts de travail en cas de pénurie de personnel, et que sa rémunération n’était pas suffisante pour être considérée comme celle d’un cadre dirigeant.
Ainsi, l’exception des cadres dirigeants est l’un des domaines les plus susceptibles de conflits dans le droit du travail japonais. Les soi-disant « cadres dirigeants de nom seulement », qui reçoivent un titre de gestion sans être réellement exemptés du paiement des heures supplémentaires, ne sont pas légalement reconnus et peuvent entraîner un risque important de devoir payer ultérieurement des salaires impayés considérables.
Il convient de noter que même si un employé est légitimement reconnu comme un cadre dirigeant, l’obligation de payer un salaire majoré pour le travail de nuit (de 22 heures à 5 heures du matin) n’est pas levée. De plus, le droit de prendre des congés payés annuels est garanti de la même manière que pour les autres travailleurs.
Résumé
Tel que décrit dans cet article, la réglementation des heures de travail et des jours de repos en vertu du droit du travail japonais constitue l’épine dorsale de la gestion du personnel des entreprises et est extrêmement stricte. Les « heures de travail » légales sont déterminées non pas par contrat, mais par la réalité objective, et sont soumises à une limite supérieure de « 8 heures par jour et 40 heures par semaine ». Le travail en heures supplémentaires ou pendant les jours de repos au-delà de cette limite n’est possible qu’avec un accord de 36 (Sanroku) convenablement conclu et déclaré, et même dans ce cas, il ne peut dépasser le plafond absolu fixé par la loi. De plus, le paiement des salaires pour ces heures de travail est soumis à des taux majorés définis par la loi. Bien qu’il existe une exception pour les « employés en position de gestion et de supervision », son champ d’application est interprété de manière très restrictive par la jurisprudence, et son application imprudente comporte un grand risque juridique. Comprendre et respecter précisément ces réglementations est un devoir fondamental pour mener des affaires au Japon et est essentiel du point de vue de la gestion de la conformité.
Le cabinet d’avocats Monolith possède une vaste expérience dans le conseil juridique et la gestion des conflits liés aux heures de travail et aux jours de repos, sujets traités dans cet article, pour de nombreux clients au Japon. Notre cabinet compte plusieurs experts qui, en plus d’être qualifiés comme avocats au Japon, possèdent également des qualifications d’avocats étrangers et sont anglophones, ce qui nous permet de répondre aux défis spécifiques rencontrés par les entreprises qui se développent à l’international. Nous offrons un soutien précis et pratique pour toutes vos questions concernant les réglementations complexes du droit du travail japonais, y compris l’établissement de systèmes de gestion des heures de travail, l’application appropriée des accords de 36 (Sanroku) et l’évaluation de la pertinence des employés en position de gestion et de supervision.
Category: General Corporate