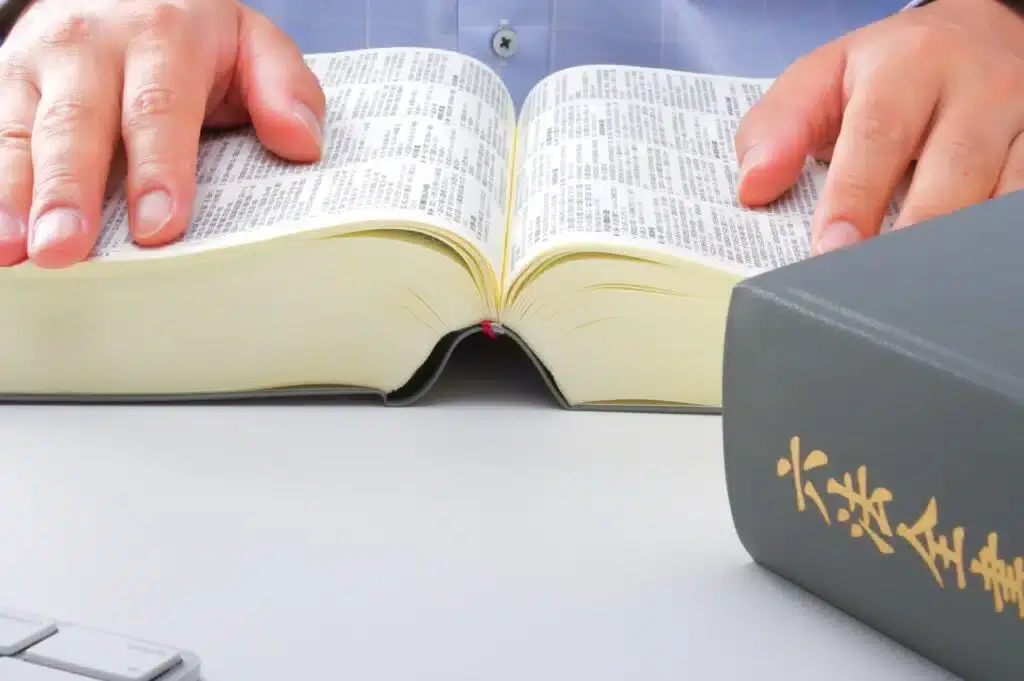【Juin de l'ère Reiwa 7 (2025)】Qu'est-ce que la nouvelle peine de "détention" créée par la réforme du Code pénal ? Explication de la signification de la réforme et des quatre points clés.

En juin de l’ère Reiwa 7 (2025), les peines de prison longtemps établies, telles que la peine d’emprisonnement et la peine de réclusion, seront abolies et remplacées par une nouvelle forme de sanction pénale appelée « peine de détention ». À partir de juin, les peines d’emprisonnement et de réclusion seront unifiées en une seule peine de détention.
Les dispositions pénales traditionnelles ont été établies il y a plus de cent ans et, au fil des années, la nature et le rôle des sanctions pénales ont été réexaminés. Cette réforme du Code pénal marque un tournant majeur dans la politique criminelle.
Cet article ne se contente pas de présenter le contenu de cette réforme, mais explique également en détail son contexte et sa signification.
Qu’est-ce que la peine de détention ? Différences avec l’emprisonnement et la réclusion sous le droit japonais

La « peine de détention » est une peine intégrée dans le projet de réforme du Code pénal présenté par le ministère de la Justice au Parlement en mars de l’année Reiwa 4 (2022). Cette réforme modifie le système des « peines privatives de liberté ».
Les « peines privatives de liberté » sont des sanctions pénales qui privent une personne de sa liberté et comprennent actuellement trois catégories : l’emprisonnement, la réclusion et la détention. Avec cette réforme, la distinction entre emprisonnement et réclusion sera supprimée, et toutes deux seront unifiées sous la peine de détention. Cela réalisera ce qu’on appelle « l’unification des peines privatives de liberté ».
Article 9 du Code pénal avant la réforme (Types de peines)
« Les peines principales sont la peine de mort, l’emprisonnement, la réclusion, l’amende, la détention et la confiscation en tant que peine complémentaire. »
↓
Article 9 du Code pénal réformé (Types de peines)
« Les peines principales sont la peine de mort, la peine de détention, l’amende, la détention et la confiscation en tant que peine complémentaire. »
Auparavant, pour les peines privatives de liberté, l’emprisonnement impliquait un travail pénitentiaire obligatoire, tandis que la réclusion ne rendait le travail pénitentiaire que facultatif. Cependant, dans la pratique, « la plupart des personnes condamnées à la réclusion participent à des travaux sur demande (conformément à l’article 93 de la loi sur le traitement des établissements pénitentiaires et des détenus), rendant la distinction entre emprisonnement et réclusion basée sur la présence ou l’absence de travail prescrite sans signification » (Kenji Takeuchi et Takeshi Honjo, “Criminal Policy Studies”).
En revanche, avec la peine de détention, la décision d’effectuer ou non un travail pénitentiaire sera prise en fonction des caractéristiques individuelles du détenu. Au lieu de rendre le travail pénitentiaire obligatoire, un accent particulier sera mis sur l’orientation et l’amélioration pour prévenir la récidive.
Dans le Code pénal réformé, l’article 13 (Réclusion) du Code pénal précédent a été supprimé, l’article 12, paragraphes 1 et 2, a été révisé, et un nouveau paragraphe 3 a été ajouté.
Article 12, paragraphe 2 du Code pénal avant la réforme
« L’emprisonnement consiste à détenir dans un établissement pénitentiaire et à effectuer un travail prescrit. »
Article 13, paragraphe 2 du Code pénal avant la réforme [Supprimé dans la réforme]
« La réclusion consiste à détenir dans un établissement pénitentiaire. »
↓
Article 12, paragraphe 2 du Code pénal réformé
« La peine de détention consiste à détenir dans un établissement pénitentiaire. »
Article 12, paragraphe 3 du Code pénal réformé [Nouveau par la réforme]
« À ceux qui sont condamnés à la peine de détention, il est possible de faire effectuer le travail nécessaire ou de fournir l’orientation nécessaire pour leur amélioration et réhabilitation. »
Avec la création de la peine de détention, le travail n’est plus considéré comme un moyen d’infliger de la souffrance aux détenus, mais comme un moyen de favoriser leur amélioration et leur réintégration sociale, et le travail ainsi que l’orientation et l’enseignement amélioratifs sont désormais considérés comme des mesures de traitement de même nature et de valeur égale dans le Code pénal.
Historique de l’unification des peines privatives de liberté sous le droit japonais
Le débat sur l’abolition de la distinction entre les peines d’emprisonnement et de réclusion, et l’unification des peines privatives de liberté, existe depuis l’avant-guerre. Lors de la révision complète du Code pénal dans les années 1960, cette question a été abordée de front, mais les tentatives ont finalement échoué.
Cependant, la récente réforme du Code pénal qui a introduit la peine de détention s’est déroulée sans grande opposition. Pourquoi donc ? Examinons le contexte de cette réforme.
Les quatre points clés derrière la réforme du Code pénal japonais
Le Ministère de la Justice du Japon justifie cette réforme par la nécessité “d’améliorer encore davantage le traitement des détenus dans les établissements pénitentiaires”. (Source : Ministère de la Justice du Japon, “Raisons de la réforme partielle du Code pénal et d’autres lois”[ja])
Cette réforme s’appuie sur plusieurs contextes.
La diminution de la nécessité de distinguer entre emprisonnement et réclusion sous le droit pénal japonais
Selon le Livre blanc sur la criminalité de l’année Reiwa 6 (2024), il y avait 14 033 personnes condamnées à de l’emprisonnement (99,6 %), 49 à de la réclusion (0,3 %) et 3 à de la détention (0,0 %). De plus, parmi les personnes condamnées à la réclusion, 81,8 % étaient engagées dans des travaux (en date de fin mars de l’année Reiwa 6 (2024), d’après le Livre blanc sur la criminalité de l’année Reiwa 6[ja]).
Comme le montrent ces données, la distinction entre emprisonnement et réclusion perd de son importance dans le système pénal japonais.
Demandes issues du milieu carcéral au Japon

Il est concevable que parmi les personnes âgées ou handicapées, certaines trouvent difficile d’effectuer des travaux. Cependant, selon le Code pénal japonais, les détenus condamnés à des peines de prison sont obligés de travailler, ce qui a conduit à une situation où des travaux sont créés de force et les détenus sont contraints de les exécuter.
De plus, pour les détenus qui ont des difficultés à vivre en société en raison d’un manque d’éducation, il serait peut-être préférable de fournir un enseignement visant à améliorer leur niveau d’études plutôt que de les faire travailler. Cependant, comme le travail est obligatoire, il n’est pas possible de consacrer suffisamment de temps à l’enseignement pour l’amélioration des compétences académiques.
L’obligation de travail imposée aux détenus est pointée du doigt comme un problème pour la rééducation et la réinsertion sociale des prisonniers.
Les initiatives du gouvernement japonais pour la prévention de la récidive
Les peines traditionnelles avaient une forte connotation de “punition”, et il a été souligné que le soutien à la réhabilitation et à la réintégration sociale des détenus était insuffisant. De plus, les détenus étaient traditionnellement classés en groupes en fonction de leurs tendances criminelles, sans toujours accorder l’importance nécessaire au crime commis ou à l’âge, entre autres facteurs.
Dans ce contexte, le gouvernement japonais a adopté une politique visant à renforcer le traitement efficace basé sur des recherches empiriques et des preuves, adapté aux caractéristiques individuelles de chaque sujet. Un objectif chiffré a été établi pour réduire de 20 % le taux de réincarcération des détenus libérés dans les deux ans, sur une période de dix ans (plan global pour la prévention de la récidive de l’année Heisei 24 (2012)).
Dans le cadre de ces mesures, l’acquisition de compétences en communication et de bonnes manières professionnelles dans les établissements correctionnels, à travers des conseils et des formations, a été intégrée dans le premier plan de promotion de la prévention de la récidive.
Prise en charge des jeunes délinquants sous le droit japonais
Dans le contexte susmentionné, un facteur direct a déclenché la création de la peine de détention. Il s’agit des débats relatifs à l’abaissement de l’âge d’application de la loi sur les mineurs.
Si l’âge d’application de la loi sur les mineurs est abaissé à moins de 18 ans, les individus âgés de 18 et 19 ans ne seront plus couverts par cette loi et seront donc susceptibles de recevoir des sanctions pénales. Cependant, les procédures basées sur la loi sur les mineurs existante permettent une approche flexible adaptée aux caractéristiques des jeunes, et sont reconnues pour leur efficacité dans l’éducation corrective des jeunes et la prévention de la récidive. Par conséquent, si des sanctions pénales doivent être imposées aux 18 et 19 ans, il est nécessaire de revoir le contenu et l’exécution de ces sanctions, et par extension, de revoir le traitement de tous les détenus. Par exemple, les jeunes de 18 et 19 ans sont généralement des lycéens ou des étudiants universitaires, mais s’ils sont soumis à des sanctions pénales, l’obligation de travail ne leur permet pas de consacrer suffisamment de temps à l’amélioration de leur éducation.
Dans ce contexte, le Comité de législation pénale et de la loi sur les mineurs du Conseil de la législation a soumis une recommandation au ministre de la Justice, qui inclut l’unification de la peine d’emprisonnement et de la détention en une nouvelle peine de liberté unique.
Réponse à l’introduction de la peine de détention sous le droit japonais

La peine de détention, créée dans ce contexte, commence à être clairement définie. Selon les rapports, les détenus seront classés dans l’un des 24 programmes de traitement correctionnel, tels que le traitement pour mineurs, le traitement pour jeunes adultes, le bien-être pour les personnes âgées, ou le soutien social pour ceux souffrant de maladies mentales, entre autres. Il semble que des traitements individualisés seront administrés en fonction des caractéristiques de chaque détenu.
Pour faire face à l’introduction de la peine de détention, les prisons et autres établissements pénaux accélèrent leurs préparatifs, mais ils rencontrent également des défis sur le terrain. Par exemple, il est généralement prévu de séparer les détenus en fonction du type de peine. Avec l’introduction de la peine de détention, les prisons devront gérer la cohabitation des détenus sous peine de détention et ceux sous peine d’emprisonnement, nécessitant la séparation de leurs cellules. Cela implique non seulement la nécessité d’un personnel supplémentaire, mais aussi des préoccupations concernant le manque d’espace physique.
Résumé : En cas d’affaire pénale, consultez un avocat
L’introduction de la peine de détention à partir du 1er juin 2025 (Reiwa 7) marque un tournant majeur dans le système de justice pénale du Japon. Cette réforme vise à mettre l’accent sur la réhabilitation des détenus et leur réintégration dans la société, tout en assurant la sécurité de la communauté par la prévention de la récidive.
Cependant, en cas d’implication dans une affaire pénale, la meilleure stratégie est de faire appel à un avocat spécialisé. Si vous êtes arrêté dans le cadre d’une affaire pénale, il est possible de ne pas avoir d’avocat avant ou après l’inculpation dans le cas d’une défense volontaire. Néanmoins, choisir de ne pas être représenté par un avocat peut être très préjudiciable pour le suspect ou l’accusé, il est donc conseillé de désigner un avocat.
Même si vous n’avez pas les moyens financiers, il existe des dispositifs tels que le « système d’assistance à la défense des suspects pénaux » ou le « défenseur commis d’office » qui peuvent être utilisés. Si vous devenez suspect ou accusé dans une affaire pénale, envisagez sérieusement de recourir à ces systèmes.
Présentation des mesures proposées par notre cabinet
Le cabinet d’avocats Monolith se distingue par son expertise de haut niveau dans les domaines de l’IT, et plus particulièrement du droit de l’internet au Japon. Nous accompagnons une clientèle variée, allant des entreprises cotées sur le marché Prime de la Bourse de Tokyo aux entreprises en phase de démarrage, en comprenant en profondeur leur modèle d’affaires et leur secteur d’activité pour identifier les risques juridiques potentiels et assurer la conformité de leurs opérations commerciales. Vous trouverez plus de détails dans l’article ci-dessous.
Domaines d’intervention du cabinet Monolith : Droit des entreprises IT et start-ups[ja]
Category: General Corporate
Tag: General CorporateIPO