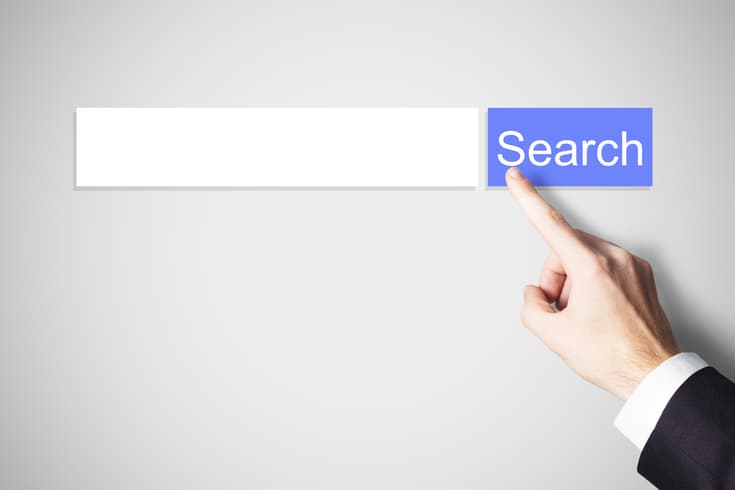La republication (retweet) d'images postées sans autorisation constitue-t-elle une violation du droit d'auteur ?
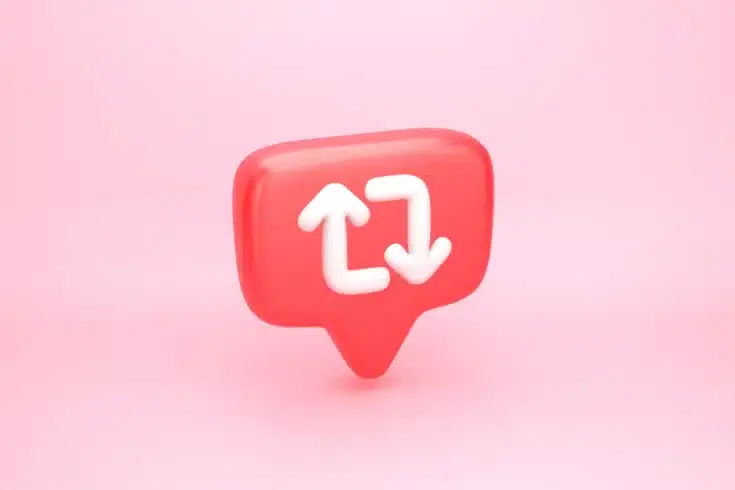
Les réseaux sociaux (SNS) sont devenus un outil de communication essentiel non seulement pour les individus mais aussi pour les entreprises. La diffusion d’informations à l’aide d’images attrayantes est efficace pour les relations publiques et les activités promotionnelles. Cependant, si ces images utilisent sans autorisation des œuvres protégées par le droit d’auteur, il existe un risque non intentionnel de violation des droits d’auteur. En particulier, les retweets ou partages imprudents par les employés peuvent entraîner une situation où la confiance dans l’entreprise est compromise.
Dans cet article, nous aborderons une question cruciale : “Une entreprise peut-elle être tenue responsable de violation du droit d’auteur si elle diffuse des images postées sans autorisation ?” Nous expliquerons ce point en nous appuyant sur des cas réels et des précédents judiciaires sous le droit japonais.
La relation entre la diffusion sur les réseaux sociaux et le droit d’auteur au Japon
Les réseaux sociaux sont un outil de communication essentiel pour les individus et les entreprises dans notre monde moderne où l’information se propage en un clin d’œil. Cependant, en raison de leur grande capacité de diffusion, ils sont également une source fréquente de problèmes liés au droit d’auteur. Les œuvres telles que les images et les vidéos sont particulièrement susceptibles d’être copiées et republiées facilement, se répandant souvent sans le consentement des détenteurs de droits.
La loi sur le droit d’auteur au Japon accorde aux créateurs de ces œuvres divers droits et interdit les actes qui portent atteinte à ces droits. Il est important de noter que la violation du droit d’auteur peut se produire même en l’absence d’intention délibérée, y compris par négligence ou par ignorance.
Quels sont donc les aspects légaux spécifiques de l’acte de “diffusion” sur les réseaux sociaux ? Les droits les plus couramment concernés sont le “droit de reproduction” et le “droit de communication au public”.
Le droit de reproduction est le droit de copier ou d’imprimer une œuvre. L’utilisation de fonctions telles que le retweet ou le partage pour afficher une image sur son propre compte implique une reproduction temporaire de l’œuvre sous forme de données en cache pour l’affichage sur l’écran d’un terminal informatique, ce qui peut constituer une violation de ce droit de reproduction.
Le droit de communication au public est le droit de transmettre une œuvre au public via des lignes de communication telles qu’Internet, ou de la rendre accessible pour réception. En retweetant ou partageant une image, rendant ainsi celle-ci visible par un nombre indéterminé de personnes, comme ses abonnés, on peut potentiellement toucher au droit de communication au public.
Article connexe : La publication de photos sans consentement et le droit d’auteur au Japon[ja]
Le cas des tweets et retweets sur Twitter (actuellement X)

Sur Internet et les réseaux sociaux, le téléchargement non autorisé d’œuvres protégées par le droit d’auteur constitue une violation de la loi sur le droit d’auteur. Mais qu’en est-il du retweet d’un tweet contenant une image téléchargée sans autorisation ?
Il existe un précédent judiciaire de la Cour suprême qui a statué que même le retweet d’un tweet avec image d’autrui, conformément aux spécifications de Twitter (actuellement X), peut constituer une violation du droit d’auteur.
Dans cette affaire, le plaignant était un photographe professionnel. Le plaignant avait ajouté les mots « Ⓒ (nom de l’auteur) » dans le coin d’une photo de muguet et avait publié cette image sur son propre site web. Il a demandé à Twitter, qui exploitait le service à l’époque (Twitter Japan Inc., la filiale japonaise, et Twitter Inc., le siège social), de divulguer les informations de l’émetteur après que la photo de muguet a été téléchargée illégalement (les noms des sociétés, etc., sont ceux de l’époque).
Un individu non identifié A avait téléchargé l’image de la photo en question sans l’autorisation du plaignant pour l’utiliser comme image de profil. En conséquence, le fichier image a été automatiquement sauvegardé et affiché sur l’URL de sauvegarde de l’image de profil de Twitter, et la photo en question a commencé à apparaître sur la timeline de A.
Un individu non identifié B avait tweeté l’image de la photo en question sans l’autorisation du plaignant depuis son propre compte. Cela a entraîné la sauvegarde et l’affichage automatiques du fichier image sur l’URL de sauvegarde de l’image du tweet de Twitter, et la photo en question a commencé à apparaître sur l’URL affichant le tweet en question et sur la timeline du compte de B.
Des individus non identifiés CDE ont chacun retweeté le tweet de B, ce qui a fait apparaître la photo en question sur leurs timelines respectives.
Le plaignant a soutenu que l’affichage de la photo par les comptes A et B constituait une violation du droit de communication au public (article 23, paragraphe 1 de la loi sur le droit d’auteur). Twitter n’a pas contesté que le fait de définir l’image comme image de profil ou de tweeter l’image elle-même sans autorisation constituait une violation du droit de communication au public. La question litigieuse dans cette affaire était le retweet par CDE. Il a été contesté si le retweet, qui a affiché la photo en question, a violé les droits d’auteur du plaignant ou non.
Article connexe : La nature de l’œuvre et l’auteur dans la publication de photos[ja]
Les revendications du plaignant et du défendeur
Le plaignant a revendiqué la violation :
- du droit de communication au public,
- du droit au respect de l’intégrité de l’œuvre,
- du droit de paternité sur l’œuvre,
- et du droit au respect de la réputation et du prestige.
Examinons chacun de ces points individuellement.
Le plaignant a soutenu que non seulement ceux qui postent des tweets avec images, mais aussi ceux qui retweetent ces tweets, commettent une violation des droits d’auteur, y compris le droit de communication au public, en affichant des tweets avec images reproduits sans autorisation sur leur timeline.
De plus, le plaignant a affirmé que le recadrage automatique des images dans les tweets lorsqu’ils sont retweetés (ce qu’on appelle les “liens inline”) constitue une violation du droit au respect de l’intégrité de l’œuvre (Article 20, paragraphe 1 de la loi sur le droit d’auteur), qui est le droit de ne pas avoir son œuvre modifiée contre sa volonté.
En outre, le plaignant a revendiqué une violation du droit de paternité sur l’œuvre, car le recadrage rendait son nom méconnaissable.
Le plaignant a également soutenu que l’acte de retweeter donnait aux spectateurs l’impression erronée que la photographie du plaignant était une œuvre de faible valeur qui pouvait être utilisée sans autorisation, ce qui constitue une violation du droit au respect de la réputation et du prestige (Article 113, paragraphe 6 de la loi sur le droit d’auteur).
En réponse, Twitter a soutenu que les retweeteurs ne transmettent pas eux-mêmes les données d’image (photo) et ne font que transmettre des données sans rapport avec la photo, donc il n’y a pas de violation du droit de communication au public.
Twitter a également réfuté l’affirmation du plaignant selon laquelle le recadrage automatique constitue une violation des droits moraux de l’auteur, en avançant les arguments suivants :
- Étant donné que le recadrage est effectué sur l’ordinateur de l’utilisateur Internet qui est le spectateur, en raison des spécifications de Twitter, l’agent du recadrage n’est pas le retweeteur mais l’utilisateur Internet, et donc il n’y a pas de violation du droit au respect de l’intégrité de l’œuvre ni du droit de paternité sur l’œuvre.
- Le recadrage est effectué automatiquement et mécaniquement par le système de Twitter pour afficher naturellement plusieurs photos dans un espace d’écran limité, ce qui constitue une modification “inévitable” (Article 20, paragraphe 2, point 4 de la loi sur le droit d’auteur) et ne viole donc pas le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre.
- Il n’est pas envisageable que le retweet d’un post entraîne une baisse de la réputation et du prestige objectifs du plaignant, donc le droit au respect de la réputation et du prestige n’est pas établi.
Article connexe : Qu’est-ce que les droits moraux de l’auteur et la protection de la réputation ou du prestige ?[ja]
Décision du Tribunal de district de Tokyo : la demande du plaignant n’est pas reconnue
En première instance, le Tribunal de district de Tokyo a évalué le retweet effectué par CDE comme suit :
- L’acte de retweeter crée automatiquement un lien inline vers l’URL de la timeline concernée, qui à son tour lie à l’URL de l’image originale, entraînant l’envoi direct des données du fichier image aux appareils des utilisateurs, tels que les ordinateurs.
- Aucune donnée d’information en circulation n’est transmise à chaque URL, et il n’y a pas non plus de transmission de ces données depuis l’URL vers les appareils des utilisateurs ; par conséquent, l’acte de retweeter en question ne constitue pas en soi une transmission de ces données, ni ne rend une telle transmission possible.
Sur la base de ces éléments, le tribunal a jugé que cela ne relevait pas d’une transmission au public. De plus, étant donné que le mécanisme de retweet n’altère pas non plus les fichiers d’images, il n’y a pas d’atteinte au droit de préservation de l’intégrité de l’œuvre, et il ne peut être considéré qu’il y ait eu offre ou présentation de la photo en question au public de la part des personnes ayant retweeté, donc il n’y a pas non plus d’atteinte au droit de divulgation du nom.
Le plaignant avait soutenu que la transmission des fichiers d’images de la photo en question, du fait du retweet, depuis l’URL de l’information en circulation vers l’ordinateur client, constituait une transmission automatique au public, et que les personnes ayant retweeté devraient être considérées comme les auteurs de cette transmission, faisant ainsi de l’acte de retweeter une violation du droit de transmission au public.
Cependant, puisque c’est B qui a téléchargé le fichier d’image de la photo sur le serveur de Twitter et a créé une situation où cette image pouvait être transmise au public, il a été jugé que B devrait être considéré comme l’auteur de la transmission en question. Par conséquent, le tribunal a ordonné la divulgation des informations de l’émetteur pour A et B, mais n’a pas admis la divulgation de l’adresse e-mail correspondante pour CDE (décision du Tribunal de district de Tokyo du 15 septembre 2016 (Heisei 28)).
Mécontent de cette décision, le plaignant a fait appel.
Décision de la Cour d’appel de la propriété intellectuelle : reconnaissance partielle des demandes du plaignant

La Cour d’appel de la propriété intellectuelle, en deuxième instance, a jugé qu’il n’était pas possible de considérer les auteurs des retweets en question comme les principaux responsables de la transmission automatique au public, et qu’il était difficile d’affirmer que l’acte de retweet avait facilité la transmission automatique au public. Par conséquent, elle a refusé de reconnaître les auteurs des retweets comme complices dans l’infraction au droit de transmission au public.
De plus, la Cour a estimé que, puisque seule la donnée de l’œuvre photographique en question était transmise, il n’était pas possible de dire que les données de l’œuvre avaient été reproduites par le retweet, et a donc également rejeté l’accusation de violation du droit de reproduction. En outre, comme l’infraction au droit de communication au public n’a pas été reconnue, il n’y avait pas de place pour reconnaître une complicité dans cette infraction, et la Cour a rendu un jugement similaire à celui de première instance.
En revanche, la Cour a examiné la violation des droits moraux de l’auteur. Concernant le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre, elle a jugé que l’image en question, qui exprime de manière créative des pensées ou des sentiments et appartient au domaine de la littérature, de la science, de l’art ou de la musique, pouvait être considérée comme une œuvre au sens de la loi sur le droit d’auteur. Cependant, comme l’image a été modifiée en termes de position et de taille en raison de son affichage sur le compte CDE suite au retweet, elle a été reconnue comme ayant été altérée par les auteurs des retweets, constituant ainsi une violation du droit au respect de l’intégrité de l’œuvre. De plus, comme le nom du photographe professionnel, l’appelant, n’était plus affiché lors de la présentation, la Cour a jugé que l’appelant avait vu son droit à la mention de son nom sur l’œuvre présentée au public ou exposée violé par les auteurs des retweets.
La Cour d’appel de la propriété intellectuelle a également examiné l’argument des défendeurs selon lequel les modifications résultant des retweets relevaient des “modifications inévitables” prévues à l’article 20, paragraphe 4, de la loi sur le droit d’auteur. Cependant, elle a jugé qu’il n’était pas possible de considérer les modifications accompagnant un acte consistant à retweeter sans autorisation une image photographique sur le compte 2, qui avait été tweetée sans l’autorisation de l’appelant, comme des “modifications inévitables”.
Quant au droit au respect de la réputation, la Cour ne l’a pas reconnu. Elle a estimé que le simple fait que la photographie en question soit affichée avec des personnages de Sanrio ou de Disney ne donnait pas immédiatement l’impression qu’il s’agissait d’une œuvre de faible valeur dont l’utilisation non autorisée serait acceptable ou d’une œuvre de piètre qualité.
En conséquence, Twitter a également été ordonné de divulguer les adresses e-mail des détenteurs des comptes A, B et CDE (Cour d’appel de la propriété intellectuelle, 25 avril 2018 (Heisei 30)).
Insatisfait de cette décision, Twitter a fait appel et, suite à l’acceptation de sa demande de pourvoi, l’affaire sera soumise à l’examen de la Cour suprême.
Décision de la Cour suprême : Reconnaissance de l’atteinte au droit à l’indication du nom sous le droit japonais
La Cour suprême du Japon a décidé de ne juger que sur l’atteinte au droit à l’indication du nom, excluant du pourvoi les motifs liés à l’atteinte au droit au respect de l’intégrité de l’œuvre.
La partie Twitter a argumenté que les auteurs de chaque retweet n’avaient pas utilisé une œuvre violant le droit d’auteur, car ils n’avaient pas “fourni ni présenté l’œuvre au public” selon l’article 19, paragraphe 1, de la loi japonaise sur le droit d’auteur. De plus, les utilisateurs consultant les pages web concernées pouvaient, en cliquant sur les images affichées dans les articles retweetés, voir l’image originale avec la partie indiquant le nom, ce qui signifie que les auteurs des retweets avaient indiqué le nom de l’auteur “conformément à ce qui avait déjà été indiqué par l’auteur” (selon le même article, paragraphe 2). Par conséquent, Twitter a soutenu que l’interprétation et l’application de la loi sur le droit d’auteur par le tribunal de première instance, qui avait reconnu une atteinte au droit à l’indication du nom dans chaque retweet, étaient erronées.
En réponse, la Cour suprême a reconnu l’atteinte au droit à l’indication du nom et a rejeté le pourvoi.
Elle a justifié sa décision en se basant sur deux points principaux :
- Le fait que l’on puisse voir l’image originale avec la partie indiquant le nom en cliquant sur l’image affichée ne change pas le fait que cette indication se trouve sur une page web distincte de celle où l’image est affichée ;
- Les utilisateurs consultant les pages web ne verront pas l’indication du nom de l’auteur à moins de cliquer sur l’image affichée, et il n’y a aucune raison de penser que les utilisateurs cliquent habituellement sur ces images.
Par conséquent, le simple fait de pouvoir voir l’image originale avec la partie indiquant le nom en cliquant sur l’image affichée dans l’article retweeté ne signifie pas que les auteurs des retweets ont indiqué le nom de l’auteur.
Ainsi, la décision de la Cour d’appel pour la propriété intellectuelle, qui avait confirmé que les retweets pouvaient constituer une atteinte aux droits moraux de l’auteur, est devenue définitive. Il en résulte que même en retweetant une image selon les spécifications de Twitter, les informations de l’émetteur peuvent être divulguées suite à une demande de divulgation d’informations (Décision de la Cour suprême du 21 juillet de l’ère Reiwa 2 (2020) lien[ja]).
Bien que la Cour suprême ait exclu du pourvoi les motifs liés au droit au respect de l’intégrité de l’œuvre et n’ait jugé que sur l’atteinte au droit à l’indication du nom, le fait que l’atteinte à ce dernier droit soit reconnue suffit pour admettre une violation des droits. Il se peut que la Cour n’ait pas jugé nécessaire de se prononcer sur le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre.
Cependant, la Cour d’appel pour la propriété intellectuelle avait jugé que “l’action de recadrage constitue une atteinte au droit au respect de l’intégrité de l’œuvre”, et la Cour suprême n’a pas infirmé cette décision. Il est donc possible de considérer que les principes énoncés par la Cour suprême concernant le droit à l’indication du nom s’appliquent également au droit au respect de l’intégrité de l’œuvre.
Résumé : Consultez un avocat pour les infractions au droit d’auteur sur les réseaux sociaux
Cet article a expliqué les risques liés à la diffusion non autorisée d’images et aux infractions au droit d’auteur sur les réseaux sociaux. En particulier, le jugement de la Cour suprême du 21 juillet de l’ère Reiwa 2 (2020) a clairement indiqué que les actes de retweet peuvent constituer une violation du droit d’auteur, ce qui nécessite une attention particulière lors de la diffusion d’informations.
Le droit d’auteur est complexe et les décisions varient selon les cas individuels. Même si vous ne saviez pas, cela ne vous exonère pas nécessairement de responsabilité. Si vous avez des inquiétudes concernant une possible infraction au droit d’auteur dans l’utilisation des réseaux sociaux par votre entreprise, ou si vous êtes impliqué dans un litige lié au droit d’auteur, il est conseillé de consulter rapidement un avocat.
Article connexe : La capture d’écran sur Twitter constitue-t-elle une infraction au droit d’auteur ? Explication d’un jugement de l’ère Reiwa 5 (2023)[ja]
Présentation des mesures proposées par notre cabinet
Le cabinet d’avocats Monolith combine une expertise approfondie en IT, et plus particulièrement dans le domaine d’Internet, avec une solide expérience juridique. Ces dernières années, les infractions aux droits d’auteur sur Internet ont suscité une attention considérable. Notre cabinet dispose d’une équipe spécialisée, composée d’avocats expérimentés, qui élabore des stratégies pour faire face à ces enjeux. Pour plus de détails, veuillez consulter l’article ci-dessous.
Domaines d’expertise du cabinet Monolith : Services juridiques en IT et propriété intellectuelle pour diverses entreprises[ja]
Category: Internet