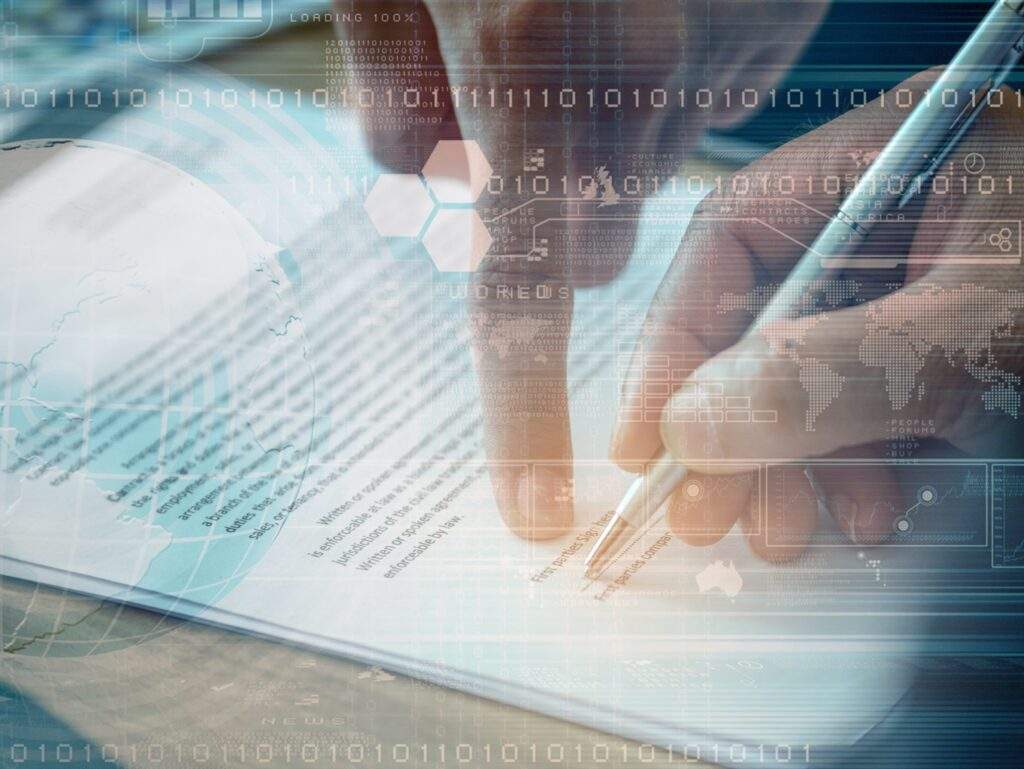La fin du contrat de travail dans le droit du travail japonais : Analyse juridique de la résiliation amiable basée sur la demande du travailleur et de la démission.

La fin d’un contrat de travail est un événement courant dans la gestion d’une entreprise. En particulier, les situations où la relation de travail se termine à l’initiative de l’employé sont fréquentes. Cependant, la nature juridique de cette fin de contrat, qu’il s’agisse d’une “résiliation d’un commun accord” ou d’une “démission”, entraîne des conséquences juridiques significatives, notamment en ce qui concerne le moment où la fin du contrat prend effet et la possibilité de rétracter une démission une fois qu’elle a été soumise. Sans une compréhension précise de cette distinction, une entreprise pourrait par exemple se retrouver dans une situation imprévue de conflit juridique si un employé retire sa démission après que l’entreprise ait embauché un remplaçant, en affirmant que son contrat de travail est toujours en vigueur. La fin d’un contrat de travail n’est pas seulement une question de procédure, mais un enjeu juridique crucial lié aux obligations légales de l’entreprise et à la gestion des risques. Dans cet article, nous examinerons en détail, à partir d’un point de vue spécialisé et en nous basant sur des lois et des cas de jurisprudence spécifiques, les deux types de fin de contrat de travail initiés par l’employé sous le droit du travail japonais : la “résiliation d’un commun accord” et la “démission”, leurs exigences légales, leurs effets, ainsi que les règles concernant la rétractation d’une déclaration d’intention. Notre objectif est d’aider à réaliser une gestion stable et juridiquement appropriée des ressources humaines et du travail.
Les types juridiques de fin de contrat de travail : la rupture conventionnelle et la démission en droit japonais
La fin d’un contrat de travail à l’initiative du salarié est juridiquement classifiée en deux types principaux au Japon : la “rupture conventionnelle” et la “démission”. Bien que ces deux mécanismes partagent le point commun de mettre fin au contrat de travail, leur nature juridique et leurs conditions de formation diffèrent fondamentalement.
La rupture conventionnelle est un contrat par lequel le salarié et l’employeur conviennent d’un commun accord de mettre fin au contrat de travail à une date future. Elle est constituée par la concordance de deux manifestations de volonté : la “proposition” de l’une des parties et l'”acceptation” de l’autre. Dans la pratique, l’acte de soumettre une “demande de démission” par le salarié est souvent interprété comme la “proposition” de rupture conventionnelle. Ce n’est qu’avec l’acceptation de l’employeur que l’accord de fin de contrat est établi.
En revanche, la démission est l’acte par lequel le salarié met fin unilatéralement au contrat de travail. Également appelée “démission volontaire”, elle ne nécessite pas l’acceptation de l’employeur. Dès que la manifestation de volonté de résilier le contrat par le salarié parvient à l’employeur et après l’écoulement d’une période déterminée par la loi, l’effet de fin de contrat se produit automatiquement.
Le problème pratique survient lorsque les documents soumis par le salarié, tels que les “avis de démission” ou les “demandes de démission”, ne sont pas clairement identifiés comme une “proposition de rupture conventionnelle” ou une “manifestation de volonté de démission” sur le plan juridique. Cette distinction est extrêmement importante car la possibilité de rétracter une manifestation de volonté dépend de l’interprétation de sa nature juridique. Les tribunaux japonais, en tenant compte du fait que la position du salarié constitue la base de sa vie, adoptent une attitude prudente dans l’interprétation des manifestations de volonté des salariés. En conséquence, tant que l’intention du salarié de démissionner n’est pas objectivement évidente comme étant une volonté définitive de mettre fin au contrat de travail, indépendamment de la réponse de l’employeur, les tribunaux ont tendance à interpréter cette manifestation de volonté non pas comme une “démission”, mais comme une “proposition de rupture conventionnelle” susceptible de rétractation. Cette tendance dans les décisions judiciaires représente un facteur de risque important pour l’employeur. Lorsqu’un salarié manifeste son intention de démissionner, si l’employeur interprète cela à tort comme une démission définitive et commence les procédures de recrutement d’un successeur ou annonce la démission en interne, il pourrait se retrouver dans une situation où un contrat de travail juridiquement valide existe en double si le salarié rétracte ensuite son intention, nécessitant ainsi une approche prudente.
Les règles de démission dans les contrats de travail à durée indéterminée sous le droit du travail japonais
En droit du travail japonais, les travailleurs liés par un contrat de travail à durée indéterminée, à l’instar des employés permanents, peuvent en principe demander la résiliation de leur contrat de travail à tout moment. Ce droit est fondé sur l’article 627, paragraphe 1 du Code civil japonais.
Selon cette disposition, “lorsque la durée de l’emploi n’a pas été fixée par les parties, chacune d’elles peut demander la résiliation à tout moment. Dans ce cas, l’emploi prend fin deux semaines après la demande de résiliation.” Cela est connu sous le nom de “liberté de résiliation” et signifie que le contrat de travail prend légalement fin deux semaines après que le travailleur a exprimé son intention de démissionner, que l’employeur l’accepte ou non. Cette période de deux semaines commence le lendemain de la demande de résiliation.
Dans la pratique, de nombreuses entreprises stipulent dans leur règlement intérieur que “les personnes souhaitant démissionner doivent en faire la demande au moins un mois avant la date prévue de leur départ”, fixant ainsi un délai de préavis plus long que les deux semaines prévues par le Code civil japonais. Il se pose alors la question de savoir quelle disposition prévaut entre le règlement intérieur de l’entreprise et le Code civil japonais. Sur ce point, les opinions divergent dans la doctrine et la jurisprudence quant à savoir si l’article 627 du Code civil japonais est une disposition impérative qui ne peut être écartée par un accord particulier entre les parties. Cependant, il est généralement admis qu’une disposition du règlement intérieur imposant une obligation de préavis de longue durée qui restreint indûment la liberté de démission du travailleur est contraire aux bonnes mœurs (article 90 du Code civil japonais) et est susceptible d’être jugée invalide. Il existe des précédents judiciaires où l’article 627 du Code civil japonais a été interprété comme une loi impérative, et où il a été décidé que la démission prenait effet deux semaines après la demande du travailleur, indépendamment des dispositions du règlement intérieur (affaire Takano Meriyasu, jugement du Tribunal de district de Tokyo du 29 octobre 1976). Par conséquent, bien qu’il soit possible pour une entreprise de fixer un délai de préavis d’environ un mois dans son règlement intérieur pour des raisons de nécessité rationnelle telles que la passation des tâches, il est important de comprendre qu’il serait difficile de légalement empêcher un travailleur de démissionner deux semaines après sa demande, conformément à l’article 627 du Code civil japonais.
Les règles de démission dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée sous le droit japonais
Dans le cas d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD), comme pour les employés contractuels, la démission d’un travailleur en cours de contrat est soumise à des restrictions plus strictes que dans le cas d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Un CDD est conclu sur la base que les deux parties respectent la période contractuelle convenue, et en principe, une résiliation unilatérale n’est pas autorisée.
Ce principe est établi par l’article 628 du Code civil japonais. Cet article stipule que “même si une période d’emploi a été fixée, si des circonstances inévitables surviennent, chaque partie peut résilier immédiatement le contrat.” En d’autres termes, pour qu’un travailleur sous CDD puisse démissionner en cours de contrat, il est nécessaire qu’il y ait des “circonstances inévitables”.
La question de savoir si une situation correspond à des “circonstances inévitables” est jugée au cas par cas, mais généralement, les cas suivants peuvent être envisagés :
- Si, en raison d’une maladie grave ou d’une blessure du travailleur lui-même, il devient impossible ou extrêmement difficile de fournir le travail.
- Si, en raison de circonstances familiales telles que les soins à un membre de la famille, la continuation de l’emploi devient objectivement difficile.
- Si le salaire n’est pas payé ou si les conditions de travail réelles diffèrent considérablement de celles qui ont été explicitement convenues lors de l’embauche (ceci est également reconnu comme un droit de résiliation immédiate en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la Loi japonaise sur les normes du travail).
- Si les activités de l’employeur violent la législation.
Cependant, il existe une exception importante à ce principe strict. L’article 137 de la Loi japonaise sur les normes du travail stipule que pour les travailleurs ayant conclu un CDD de plus d’un an, “après l’expiration d’un an à compter du premier jour de la période du contrat de travail, ils peuvent démissionner à tout moment en en faisant la demande à l’employeur”. Cette disposition permet, par exemple, à un travailleur sous un contrat de trois ans, après l’expiration d’un an depuis le début du contrat, de démissionner librement à tout moment, même en l’absence de “circonstances inévitables”. Cette exception est conçue pour prévenir la contrainte prolongée des travailleurs et représente une contrainte légale que les employeurs doivent impérativement reconnaître lorsqu’ils planifient la sécurisation des ressources humaines par des contrats à durée déterminée de plusieurs années.
Retrait d’une déclaration d’intention : Possibilité de rétracter une démission sous le droit japonais
Dans la pratique, les cas où un employé tente de rétracter une déclaration d’intention de démissionner, une fois soumise, sont souvent source de conflits. La possibilité de rétracter une telle déclaration est directement liée à la distinction entre la “démission” et la “demande de résiliation amiable” mentionnée précédemment.
La déclaration d’intention de “démission”, qui est un avis de résiliation unilatéral de la part de l’employé, prend effet dès qu’elle est reçue par l’employeur et, en principe, ne peut pas être rétractée unilatéralement par l’employé. En revanche, une déclaration d’intention de démission faite en tant que “demande de résiliation amiable” du contrat de travail peut être librement rétractée par l’employé jusqu’à ce que l’employeur exprime son consentement à l’accepter.
Le point le plus crucial ici est de déterminer quand et comment le “consentement de l’employeur” prend effet légalement. Si le consentement est reconnu comme établi, l’employé ne peut plus rétracter sa demande et la résiliation amiable du contrat de travail est confirmée. À cet égard, il existe deux cas de jurisprudence contrastés de la Cour suprême et des tribunaux de première instance.
Le premier est l’affaire Ōkuma Tekkōsho (arrêt de la Cour suprême du 18 septembre 1987 (1987)). Dans cette affaire, un employé a soumis une demande de démission au directeur des ressources humaines, qui l’a acceptée. L’employé a tenté de la rétracter le lendemain, mais le tribunal a jugé que le directeur des ressources humaines avait effectivement le pouvoir d’approuver la démission de l’employé. Dès que le directeur des ressources humaines ayant l’autorité a accepté la demande de démission, il a été jugé que l’expression de consentement de l’employeur avait eu lieu et que la résiliation amiable du contrat de travail avait été établie. En conséquence, la tentative de rétractation de l’employé le jour suivant a été jugée invalide.
Le second est l’affaire Hakutō Gakuin (jugement du Tribunal de district d’Osaka du 29 août 1997 (1997)). Dans cette affaire, un enseignant d’une école privée a soumis une demande de démission au directeur, mais l’a rétractée par téléphone quelques heures plus tard. Dans cette institution scolaire, le pouvoir final de décision concernant l’embauche et le licenciement du personnel éducatif résidait chez le président du conseil d’administration. Le tribunal a jugé que la rétractation était valide car elle avait été faite avant que l’expression de consentement du président du conseil d’administration, qui avait le pouvoir final de consentement, n’atteigne l’enseignant.
Ces cas de jurisprudence montrent que le succès ou l’échec d’une démission est étroitement lié à la structure de répartition des pouvoirs au sein de l’entreprise. Selon que la personne qui accepte la demande de démission est simplement un récepteur ou détient le pouvoir de décision du consentement, le moment de l’établissement de la résiliation amiable peut varier. Cette situation, qui manque de stabilité juridique, représente un risque important pour l’employeur. Par conséquent, il est extrêmement efficace, du point de vue de la prévention des conflits, que l’entreprise définisse clairement dans son règlement de travail ou autre, que “la soumission d’une demande de démission est traitée comme une demande de résiliation amiable et que la résiliation amiable est établie lorsque l’employé reçoit une notification écrite de consentement au nom du directeur des ressources humaines”. Cela permet de clarifier le moment où le consentement prend effet et de limiter la période pendant laquelle l’employé peut rétracter sa demande à une durée prévisible.
Tableau comparatif : Différences légales entre la résiliation amiable et la démission au Japon
Nous avons résumé ci-dessous les différences légales entre la résiliation amiable et la démission que nous avons expliquées jusqu’à présent.
| Aspect légal | Résiliation amiable | Démission |
| Base légale | Principe de liberté contractuelle dans le Code civil japonais | Article 627 (contrat à durée indéterminée) / Article 628 (contrat à durée déterminée) du Code civil japonais |
| Conditions de validité | Demande du travailleur et acceptation de l’employeur | Déclaration unilatérale du travailleur |
| Consentement de l’employeur | Requis | Non requis |
| Date d’effet | Le jour de l’accord entre employeur et employé | Deux semaines après la demande (principe du contrat à durée indéterminée) |
| Rétractation de la déclaration | Possible avant l’acceptation de l’employeur | En principe impossible après réception |
Les obligations légales après la fin d’un contrat de travail au Japon
Après la fin d’un contrat de travail, l’employeur est soumis à certaines obligations légales au Japon. Les plus importantes concernent le paiement des salaires et la gestion des obligations de confidentialité.
Paiement des salaires
L’article 23 de la Loi japonaise sur les normes du travail stipule des règles strictes concernant la restitution des biens et des salaires lors de la démission d’un employé. Selon cet article, l’employeur doit, sur demande de l’employé démissionnaire, payer les salaires dans les 7 jours suivant la demande et restituer tous les biens, quels que soient leur nature ou leur appellation, appartenant aux droits de l’employé. Cette obligation prime sur la date habituelle de paiement des salaires fixée par l’entreprise. Autrement dit, si un employé démissionnaire demande le paiement avant la date de paie habituelle, l’entreprise a l’obligation légale de répondre dans les 7 jours. En cas de non-respect de cette disposition, une amende pouvant aller jusqu’à 300 000 yens peut être imposée. Par conséquent, les départements comptables et des ressources humaines doivent mettre en place un système permettant un règlement rapide des salaires des employés démissionnaires.
Obligation de confidentialité
Pendant son emploi, un travailleur est tenu, en vertu du principe de bonne foi et de loyauté associé au contrat de travail (article 3, paragraphe 4 de la Loi japonaise sur les contrats de travail), de préserver les secrets commerciaux de l’employeur. Cependant, cette obligation basée sur le principe de bonne foi s’affaiblit considérablement avec la fin du contrat de travail.
Par conséquent, pour imposer une obligation de confidentialité sur des informations spécifiques après la démission, il est essentiel d’établir des règles claires dans le règlement intérieur ou de conclure un accord de confidentialité individuel au moment de la démission. Avec un tel accord écrit, il est possible de protéger une gamme d’informations plus large que celle définie comme “secrets d’affaires” par la Loi japonaise sur la prévention de la concurrence déloyale, permettant ainsi de mettre en œuvre des mesures plus efficaces contre les fuites d’informations. En particulier, il est indispensable de convenir clairement d’une obligation de confidentialité après la démission pour les employés qui avaient accès à des informations telles que les données clients, les informations techniques et les stratégies de gestion, qui sont des sources de compétitivité pour l’entreprise.
Résumé
Tel que détaillé dans cet article, la fin d’un contrat de travail à l’initiative du travailleur au Japon suit deux voies juridiques distinctes : la “résiliation d’un commun accord” et la “démission”. Cette distinction n’est pas qu’une classification académique, elle est directement liée à des questions pratiques extrêmement importantes telles que l’effet de la démission, la période de préavis et, surtout, la possibilité de rétracter une déclaration d’intention de démission. En particulier, l’ambiguïté dans l’interprétation de la volonté du travailleur et les conflits concernant la rétractation peuvent entraîner des perturbations imprévues dans la gestion stable d’une entreprise. Pour gérer efficacement ces risques, il est essentiel de comprendre précisément les différences juridiques et de définir clairement les procédures internes de l’entreprise, de l’acceptation à l’approbation d’une demande de démission.
Le cabinet d’avocats Monolith possède une connaissance approfondie et une vaste expérience pratique du complexe système juridique du travail au Japon. Nous avons fourni des conseils juridiques à une clientèle diversifiée au Japon, couvrant tous les aspects des contrats de travail, de leur établissement à leur conclusion. En particulier, nous avons une solide expérience dans les problèmes juridiques liés à la démission des employés, comme ceux traités dans cet article. De plus, notre cabinet compte plusieurs avocats qualifiés dans des juridictions étrangères et anglophones, ce qui nous permet de répondre précisément aux besoins spécifiques des entreprises étrangères opérant au Japon. Nous offrons un soutien juridique optimal adapté à la situation de votre entreprise, y compris la création et la révision de règlements internes, la gestion de cas de démission individuels et l’élaboration de stratégies de prévention des conflits.
Category: General Corporate