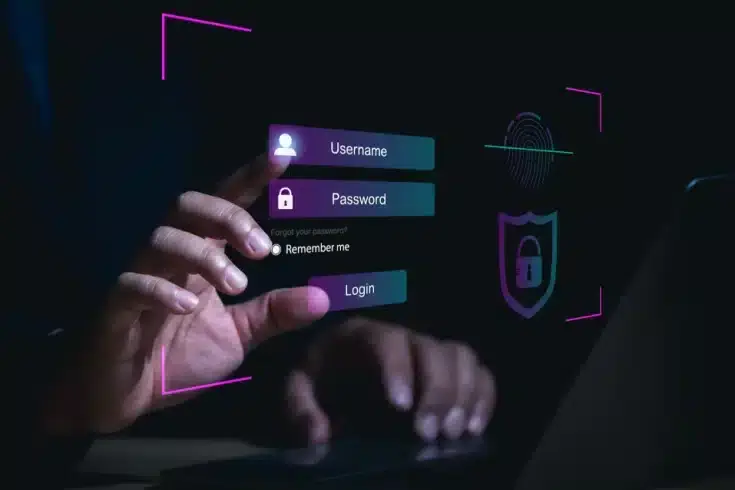Le cadre juridique de l'ordre d'entreprise dans le droit du travail japonais : règlement de service, protection des lanceurs d'alerte et efficacité des sanctions disciplinaires.

Pour assurer une conduite fluide des activités d’entreprise et une croissance durable, il est essentiel de maintenir un ordre interne clair et équitable. Cependant, l’ordre d’entreprise au Japon n’est pas simplement établi par des coutumes ou des directives unilatérales de la direction, mais est strictement réglementé par un cadre juridique fondé sur les contrats de travail. Comprendre et respecter précisément ce cadre juridique est l’un des défis les plus importants pour la gestion d’une entreprise, afin de prévenir les conflits de travail potentiels et de construire des relations de travail saines. En particulier, trois éléments sont au cœur de l’ordre d’entreprise : le “règlement de service” qui définit spécifiquement le code de conduite des employés, le “système de protection des lanceurs d’alerte” qui encourage l’auto-épuration de l’organisation, et les “sanctions disciplinaires” pour les infractions à l’ordre. Ces systèmes sont régis en détail par des lois japonaises telles que la loi sur les contrats de travail, la loi sur les normes du travail et la loi sur la protection des lanceurs d’alerte, et leur mise en œuvre nécessite la plus grande attention. Cet article se concentre sur ces trois thèmes importants et explique les exigences légales et les points de pratique que les entreprises doivent respecter, en s’appuyant sur des lois spécifiques et des cas de jurisprudence. L’objectif est d’aider les dirigeants d’entreprise et les responsables juridiques à gérer les risques juridiques de manière appropriée et à réaliser une gestion organisationnelle efficace et légale.
Les fondements juridiques de l’ordre d’entreprise au Japon
Au Japon, le droit des entreprises d’exiger et de maintenir un certain ordre vis-à-vis de leurs employés trouve sa source dans le contrat de travail conclu entre l’employeur et le travailleur. Cette relation n’est pas simplement une relation de commandement, mais est établie comme une relation contractuelle basée sur l’accord de parties juridiquement égales.
La relation centrée sur le contrat de travail
L’article 6 de la loi japonaise sur les contrats de travail (Japanese Labor Contract Act) stipule que le contrat de travail est établi “par l’accord entre le travailleur qui fournit son travail à l’employeur et l’employeur qui paie en retour un salaire”. Sur la base de cet accord, le travailleur a l’obligation de fournir sa force de travail, tandis que l’employeur a l’obligation de payer un salaire. Les obligations du travailleur ne se limitent pas à l’exécution des tâches spécifiées. Le contrat implique également des obligations plus larges, telles que la préservation des biens de l’entreprise, la coopération au bon déroulement des opérations et la prise en compte des intérêts de l’entreprise dans son ensemble. L’obligation de respecter l’ordre de l’entreprise est reconnue juridiquement comme l’une de ces obligations accessoires inhérentes au contrat de travail. En d’autres termes, le respect des règles de l’entreprise par les employés est interprété comme une responsabilité fondamentale dans l’exécution du contenu du contrat.
Les principes de “bonne foi et loyauté” et “d’interdiction de l’abus de droit”
Les principes qui régissent plus spécifiquement cette relation contractuelle sont énoncés à l’article 3 de la loi japonaise sur les contrats de travail. Le paragraphe 4 de cet article établit le principe de “bonne foi et loyauté”, stipulant que “le travailleur et l’employeur doivent respecter le contrat de travail et exercer leurs droits et remplir leurs obligations avec bonne foi et loyauté”. Une violation de l’ordre de l’entreprise par un employé peut être évaluée comme une action contraire à ce principe de bonne foi et loyauté.
D’autre part, le paragraphe 5 de ce même article établit le principe “d’interdiction de l’abus de droit”, stipulant que “le travailleur et l’employeur ne doivent pas abuser des droits découlant du contrat de travail lors de leur exercice”. Ce principe constitue une contrainte juridique importante sur l’exercice du pouvoir par l’employeur. Si l’exercice de droits tels que le pouvoir disciplinaire, utilisé pour maintenir l’ordre de l’entreprise, est jugé inapproprié dans son objectif ou ses moyens, il peut être légalement invalidé comme un abus de droit.
Ainsi, l’ordre d’entreprise dans le droit du travail japonais repose sur une structure équilibrée, où l’ordre est fondé sur la relation réciproque du contrat de travail, les obligations de conformité des employés sont établies par le principe de bonne foi et loyauté, et l’exercice du pouvoir par l’employeur est strictement limité par le principe d’interdiction de l’abus de droit. Comprendre ces obligations juridiques bilatérales est la première étape pour aborder les problèmes liés à l’ordre d’entreprise.
Établissement des règles : Règlement intérieur et règles d’emploi sous le droit japonais
Pour présenter de manière concrète et claire l’ordre d’entreprise aux employés et exiger leur conformité, le document juridique le plus important est le “règlement d’emploi”. Au sein de celui-ci, les “règlements intérieurs” sont spécifiquement axés sur les codes de conduite des employés.
Le rôle central des règles d’emploi
L’article 89 de la Loi sur les normes du travail japonaise oblige les employeurs qui emploient en permanence plus de dix travailleurs à établir des règles d’emploi et à les soumettre au directeur de l’inspection du travail compétent. Ces règles d’emploi doivent contenir des “éléments de contenu absolument nécessaires” tels que les heures de début et de fin de travail, ainsi que les salaires, et des “éléments de contenu relativement nécessaires” qui doivent être inclus si des règles sont établies. Les dispositions relatives aux sanctions contre les employés, c’est-à-dire la discipline, font partie de ces éléments de contenu relativement nécessaires, et pour qu’une entreprise puisse prendre des mesures disciplinaires, il est essentiel que les motifs et les types de sanctions soient clairement indiqués dans les règles d’emploi.
La place des règlements intérieurs
Les règlements intérieurs définissent spécifiquement la discipline que les employés doivent respecter dans leur travail, tels que l’obligation de se consacrer à leur emploi, le devoir de confidentialité, l’utilisation appropriée des installations et du matériel de l’entreprise, et l’interdiction du harcèlement. Légalement, ces règlements intérieurs sont traités comme une partie des règles d’emploi. Les entreprises peuvent soit inclure un chapitre intitulé “discipline de service” dans les règles d’emploi, soit créer un document séparé appelé “règlement intérieur”. Dans le second cas, le règlement est légalement considéré comme faisant partie intégrante des règles d’emploi, donc la création ou la modification de celui-ci nécessite de suivre les mêmes procédures légales que pour les règles d’emploi.
Procédures obligatoires pour la création et la modification
Lors de la création ou de la modification des règles d’emploi (y compris les règlements intérieurs), il est nécessaire de respecter les procédures strictes établies par la Loi sur les normes du travail du Japon. L’employeur doit d’abord consulter l’opinion du syndicat des travailleurs, s’il en existe un représentant la majorité des travailleurs, ou sinon celle des représentants de la majorité des travailleurs, et rédiger un document écrit reflétant cette opinion (avis). La loi exige seulement la “consultation” des opinions et non l’obtention du “consentement” des représentants. Cependant, cette procédure de consultation est obligatoire et si elle n’est pas respectée, l’inspection du travail peut décider de ne pas accepter le dépôt des règles d’emploi.
Ensuite, les règles d’emploi créées ou modifiées, accompagnées de l’avis, doivent être soumises à l’inspection du travail compétente, puis portées à la connaissance de tous les employés par des moyens tels que l’affichage dans un lieu visible de l’entreprise, la remise de documents écrits ou la publication sur l’intranet. Si cette obligation de notification est négligée, même si les règles d’emploi sont légalement établies, l’entreprise pourrait se voir incapable de faire valoir ses droits sur la base de leur contenu (par exemple, pour mettre en œuvre une sanction disciplinaire). Ces procédures ne sont pas de simples formalités, mais des exigences fondamentales pour conférer une efficacité juridique aux règles d’emploi.
Protection de l’intégrité : le système de protection des lanceurs d’alerte au Japon
Le maintien de l’ordre au sein des entreprises ne se limite pas à faire respecter les règles internes, mais englobe également la capacité à détecter et corriger les actes répréhensibles en interne. C’est dans ce cadre que s’inscrit la « Loi sur la protection des lanceurs d’alerte » du Japon, qui soutient légalement cette fonction d’auto-épuration.
Aperçu de la Loi sur la protection des lanceurs d’alerte
Cette loi vise à protéger les travailleurs et autres personnes qui signalent des actes illégaux, tels que des violations de la législation, survenus au sein de leur lieu de travail à des entités désignées, sans intention malveillante. Plus précisément, elle interdit clairement aux entreprises de prendre des mesures défavorables telles que la rétrogradation, la réduction de salaire ou tout autre traitement préjudiciable à l’encontre des travailleurs pour avoir effectué un signalement d’intérêt public. De telles mesures de représailles sont considérées comme nulles et non avenues en vertu de la loi.
Renforcement des obligations des entreprises suite à la réforme de 2022
La loi révisée sur la protection des lanceurs d’alerte, entrée en vigueur le 1er juin 2022, a considérablement renforcé les mesures que les entreprises doivent prendre. En particulier, pour les entreprises employant de manière permanente plus de 300 travailleurs, il est devenu une « obligation » légale de mettre en place un système pour répondre adéquatement aux signalements d’intérêt public en interne (pour les entreprises de moins de 300 employés, il s’agit d’une « obligation de faire des efforts »). Cette obligation de mise en place d’un système comprend spécifiquement l’installation d’un point de contact pour les signalements internes d’intérêt public, la désignation de « personnes chargées de traiter les signalements d’intérêt public » responsables de la réception des signalements, des enquêtes et des mesures correctives. De plus, ces personnes sont soumises à une stricte obligation de confidentialité concernant les informations permettant d’identifier les lanceurs d’alerte. En cas de divulgation de ces informations sans raison valable, les individus concernés peuvent être soumis à des sanctions pénales, notamment une amende pouvant aller jusqu’à 300 000 yens. Cette réforme a transformé le système de signalement interne d’une simple recommandation en une fonction de conformité obligatoire avec des responsabilités juridiques spécifiques.
Invalidité judiciaire des mesures de représailles
Les tribunaux appliquent rigoureusement l’interdiction de traitement défavorable envers les lanceurs d’alerte. Un exemple en est le jugement du tribunal de district de Yokohama en date du 14 avril 2022. Dans cette affaire, une entreprise exploitant des salles de pachinko avait commis des actes contraires à la législation japonaise sur les activités liées aux divertissements pour adultes. Des employés de l’entreprise ont signalé ces faits à la police, et en réponse, l’entreprise a rétrogradé ces employés et leur a imposé une réduction significative de salaire. Le tribunal a jugé que cette dénonciation à la police constituait un signalement d’intérêt public protégé par la Loi sur la protection des lanceurs d’alerte et que les mesures de rétrogradation et de réduction de salaire prises pour cette raison étaient contraires à la loi et donc invalides. Cette décision de justice montre clairement que même si une entreprise exerce des mesures de représailles en matière de personnel contre un lanceur d’alerte, le pouvoir judiciaire peut annuler leur effet.
Mise en œuvre des règles : Conditions de validité des sanctions disciplinaires sous le droit japonais
Pour maintenir l’ordre au sein de l’entreprise, l’employeur peut, conformément au règlement intérieur, infliger des sanctions disciplinaires aux employés qui enfreignent la discipline. Cependant, l’exercice de ce droit disciplinaire n’est pas illimité et est soumis à des conditions strictes établies par le droit du travail japonais.
Les types de sanctions disciplinaires sous le droit japonais
Il existe plusieurs types de sanctions disciplinaires, qui varient en fonction de leur gravité. Généralement, elles sont classées par ordre croissant de sévérité comme suit :
- Avertissement ou réprimande : Il s’agit d’une sanction où l’individu est sévèrement averti, oralement ou par écrit, en guise de mise en garde pour l’avenir. Dans le cas d’une réprimande, il est courant de demander la soumission d’un rapport explicatif.
- Réduction de salaire : En tant que mesure disciplinaire, une certaine somme est déduite du salaire normalement dû.
- Suspension de travail : Il s’agit d’une sanction interdisant temporairement le travail tout en maintenant le contrat de travail. Le salaire n’est pas versé pendant cette période.
- Rétrogradation : Cette sanction implique l’abaissement du poste ou du rang professionnel.
Des restrictions légales strictes concernant les sanctions de réduction de salaire sous le droit japonais
En particulier, en ce qui concerne les sanctions de réduction de salaire, l’article 91 de la Loi japonaise sur les normes du travail (Japanese Labor Standards Act) impose des limites strictes pour protéger la vie des travailleurs. Plus précisément, le montant de la réduction de salaire pour un seul incident ne peut excéder la moitié du salaire moyen journalier. De plus, même en cas de multiples infractions disciplinaires au cours d’une même période de paiement, le total des réductions de salaire ne doit pas dépasser 10% du montant total des salaires de cette période. Ces restrictions s’appliquent spécifiquement à la « réduction de salaire » en tant que mesure disciplinaire et ne s’appliquent pas directement à la non-paiement des salaires en cas de suspension de travail ou à la non-versement des indemnités de poste en cas de rétrogradation.
La théorie de l’abus du droit disciplinaire sous le droit japonais
Le principe juridique le plus important dans l’exercice du droit disciplinaire est la “théorie de l’abus du droit disciplinaire”, explicitement énoncée à l’article 15 de la loi japonaise sur les contrats de travail (Japanese Labor Contract Act). Elle stipule que “lorsqu’un employeur a le droit de discipliner un employé, si la discipline, compte tenu de la nature et de la manière de l’acte de l’employé ainsi que d’autres circonstances, manque de raisons objectivement rationnelles et n’est pas considérée comme appropriée selon les normes sociales, alors ce droit est abusé et la discipline est invalide”.
Cet article indique que pour qu’une sanction disciplinaire soit reconnue valide, elle doit satisfaire deux exigences essentielles :
- Objectivité et rationalité : L’acte de l’employé doit objectivement correspondre à un motif disciplinaire selon le règlement intérieur de l’entreprise. Il est nécessaire qu’il existe des preuves suffisantes pour étayer ce fait.
- Adéquation selon les normes sociales : La sévérité de la sanction doit être équilibrée par rapport à la nature, la manière, le résultat de l’acte en question, l’intention de l’employé, l’étendue du dommage causé, l’attitude de travail antérieure, l’historique disciplinaire et le degré de remords, entre autres circonstances.
Décisions judiciaires et jurisprudence sous le droit japonais
Les tribunaux japonais appliquent rigoureusement la doctrine de l’abus du droit disciplinaire, en se basant non pas sur le jugement subjectif de l’employeur, mais sur des critères objectifs pour déterminer la validité des sanctions.
Par exemple, dans le cas d’un maître de conférences d’une université qui a été suspendu de ses fonctions pendant six mois pour des actes de harcèlement (jugement du tribunal de district de Kanazawa du 25 janvier 2011 (Heisei 23)), le tribunal a reconnu certains comportements inappropriés de la part du maître de conférences, mais a jugé que ces actes n’étaient pas suffisamment graves pour justifier une suspension de six mois. De plus, compte tenu du fait que le maître de conférences n’avait pas d’antécédents disciplinaires et avait montré des signes de repentir, la sanction a été jugée disproportionnée et manquant de “proportionnalité selon les normes sociales”, ce qui a conduit à la conclusion que c’était un abus du droit disciplinaire et donc invalide.
En ce qui concerne les sanctions disciplinaires pour des actes commis dans la vie privée des employés, elles ne sont jugées valides que si l’acte a “un impact négatif considérable et objectivement évalué sur la réputation sociale de l’entreprise”. Par exemple, pour un crime mineur commis par un employé ordinaire, qui n’a pas été rapporté et est inconnu au sein de l’entreprise, il est probable qu’une sanction disciplinaire sévère soit jugée disproportionnée. En revanche, si une personne occupant un poste clé dans l’entreprise commet un crime grave largement rapporté par les médias, une sanction sévère peut être jugée appropriée car elle a gravement endommagé la réputation de l’entreprise. En fin de compte, la validité d’une sanction disciplinaire est déterminée en prenant en compte de manière globale les circonstances spécifiques de chaque cas.
Comprendre les caractéristiques et les contraintes légales de chaque type de sanction disciplinaire est extrêmement important lors de l’évaluation de leur validité. Ci-dessous, vous trouverez un tableau comparatif des principales sanctions disciplinaires.
| Type de sanction | Définition | Contraintes et caractéristiques légales |
| Avertissement/Réprimande | Attention sévère pour prévenir le futur. La réprimande peut impliquer la soumission d’un rapport d’explication. | La sanction disciplinaire la plus légère. L’enregistrement de la sanction peut influencer l’évaluation du personnel. |
| Réduction de salaire | Diminution d’une partie du salaire en tant que sanction. | Conformément à l’article 91 de la Loi japonaise sur les normes du travail, il existe des limites strictes. Le montant pour une fois ne peut excéder la moitié du salaire moyen journalier, et le total ne peut dépasser 10% du montant total du salaire pour une période de paiement. |
| Suspension de travail | Interdiction de travailler pendant une période déterminée, sans paiement de salaire pendant cette période. | La durée de la suspension doit être proportionnelle selon les normes sociales. Une suspension injustement longue peut être invalidée. |
| Rétrogradation | Diminution du poste ou du grade. | La rétrogradation en tant que sanction disciplinaire nécessite une base dans le règlement intérieur de l’entreprise. Elle entraîne une réduction des indemnités de poste, mais diffère d’une sanction de réduction de salaire. |
Résumé
La préservation de l’ordre au sein des entreprises au Japon repose sur un cadre juridique complexe qui comprend les obligations mutuelles des employeurs et des employés en vertu de la loi japonaise sur les contrats de travail, les procédures strictes des règlements de travail établis par la loi japonaise sur les normes du travail, ainsi qu’une surveillance rigoureuse par le pouvoir judiciaire des abus du droit disciplinaire. Pour réaliser une gestion organisationnelle efficace et légale, il est essentiel de comprendre précisément ces trois piliers. Premièrement, il faut établir et faire connaître les règlements de travail conformément aux procédures légales. Deuxièmement, il est nécessaire de construire un système de conformité conforme à la loi révisée sur la protection des lanceurs d’alerte, afin de protéger de manière fiable les dénonciateurs contre les représailles. Troisièmement, lors de l’application de sanctions disciplinaires, il convient d’examiner attentivement si les critères stricts d’« objectivité et de rationalité » et de « convenance selon les normes sociales » appliqués par les tribunaux japonais sont respectés. L’adhésion à ces exigences légales protège les entreprises des risques juridiques inutiles et constitue une base solide pour une croissance durable.
Le cabinet d’avocats Monolith possède une vaste expérience dans la gestion de problèmes complexes liés au droit du travail japonais pour une multitude de clients, tant nationaux qu’internationaux. Notre cabinet compte plusieurs avocats possédant des compétences diversifiées, y compris des avocats qualifiés à l’étranger et des anglophones, capables de fournir un soutien juridique complet sur les thèmes abordés dans cet article, notamment la création et la révision des règlements de travail, l’assistance à la mise en place de systèmes de conformité, et l’évaluation et le conseil sur les risques juridiques dans des cas disciplinaires spécifiques. Nous sommes déterminés à soutenir vigoureusement tous ceux qui cherchent à maintenir l’ordre au sein de leur entreprise tout en gérant les risques juridiques, en s’appuyant sur notre expertise et notre expérience.
Category: General Corporate