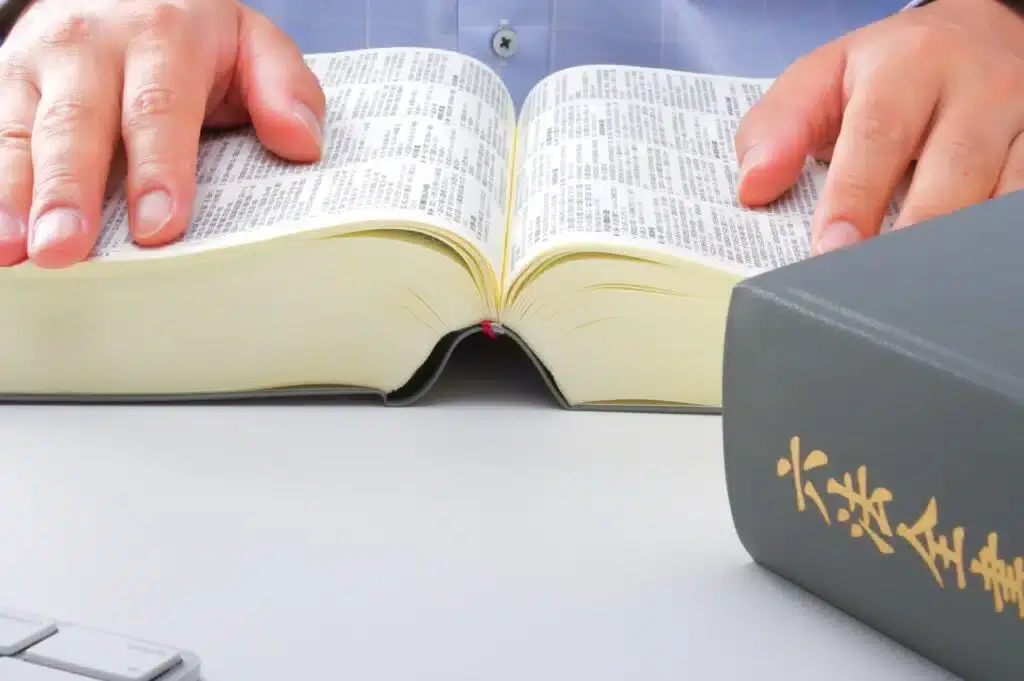Critères de détermination de la qualité de travailleur en droit du travail japonais : Explication de l'approche judiciaire concernant le champ d'application

Le système juridique du travail au Japon offre une protection substantielle aux « travailleurs ». Cependant, la question de savoir qui est considéré comme « travailleur » ne se détermine pas uniquement par le titre du contrat ou l’intention des parties. Les tribunaux japonais jugent la « nature du travailleur » en se basant sur la réalité des tâches effectuées plutôt que sur la forme du contrat. Une erreur dans cette évaluation peut exposer une entreprise à des risques juridiques imprévus. Par exemple, si une personne engagée sous un contrat de prestation de services est ultérieurement reconnue comme travailleur par un tribunal, l’entreprise pourrait se voir ordonner de payer rétroactivement des heures supplémentaires et des cotisations de sécurité sociale. Ce risque ne se limite pas à un fardeau financier. La reconnaissance de la qualité de travailleur peut ébranler le modèle d’affaires d’une entreprise, en particulier celles qui dépendent d’une main-d’œuvre flexible telle que les freelances ou les entrepreneurs individuels, constituant ainsi un risque majeur pour la gestion de l’entreprise. Cela est dû à l’application des réglementations strictes sur les heures de travail, les pauses et les jours de repos établies par la loi japonaise sur les normes du travail. Cet article détaille la définition d’un « travailleur » selon la loi japonaise sur les normes du travail et explique, à travers de nombreux exemples de jurisprudence, les critères utilisés par les tribunaux pour juger la « nature du travailleur ». Il est essentiel de comprendre cette question non seulement comme un défi de conformité, mais aussi comme un enjeu stratégique lié à la durabilité de l’entreprise.
La définition légale du « travailleur » selon le droit du travail japonais
Dans le système juridique du droit du travail au Japon, la définition de « travailleur » varie subtilement selon la loi qui en constitue la base. Comprendre ces différences est essentiel pour appréhender les risques avec précision.
Pour commencer, la Loi sur les normes du travail japonaise, qui établit les normes minimales pour les conditions de travail de chaque travailleur, définit dans son article 9 le « travailleur » comme « toute personne, quel que soit son métier, employée dans une entreprise ou un bureau et rémunérée ». Cette définition est un concept central communément utilisé dans de nombreuses lois du travail spécifiques, telles que la Loi sur la sécurité et l’hygiène du travail japonaise, qui vise à assurer la sécurité et la santé des travailleurs, et la Loi sur le salaire minimum japonaise, qui garantit un montant de salaire minimum. De même, l’article 2 de la Loi sur les contrats de travail japonaise adopte une définition presque identique à celle de la Loi sur les normes du travail, définissant ainsi les sujets de protection fondamentaux dans les relations individuelles de travail.
En revanche, la Loi sur les syndicats japonaise, qui garantit le droit à la liberté d’association et le droit à la négociation collective des travailleurs, inclut une gamme plus large de personnes dans son champ de protection. Son article 3 définit le « travailleur » comme « toute personne, quel que soit son métier, qui vit de son salaire, de ses émoluments ou de tout autre revenu équivalent ». Cette définition ne contient pas l’exigence d’être « employé » comme dans la Loi sur les normes du travail, et cible plus largement toute personne qui fournit des services en dépendant économiquement d’autrui.
Cette différence de définition entraîne d’importantes conséquences juridiques. Il est possible qu’une personne ne soit pas considérée comme un « travailleur » selon la Loi sur les normes du travail et que sa demande de paiement pour heures supplémentaires soit rejetée, mais qu’elle puisse être reconnue comme un « travailleur » selon la définition plus large de la Loi sur les syndicats. Dans ce cas, cette personne aurait le droit de former un syndicat et de demander une négociation collective avec l’entreprise. Par conséquent, les entreprises doivent gérer les relations de travail non seulement en tenant compte des risques liés à la Loi sur les normes du travail, mais aussi en considérant ceux associés à la Loi sur les syndicats, nécessitant ainsi une double perspective en matière de gestion du personnel.
Le cadre judiciaire de la détermination de la qualité de travailleur en droit japonais : une approche privilégiant la réalité sur la forme
Même si un contrat est explicitement intitulé “contrat de prestation de services” ou “contrat d’entreprise”, cela ne suffit pas à nier la qualité de travailleur. Les tribunaux japonais adoptent une position cohérente qui ne se limite pas aux éléments formels tels que le nom du contrat, mais qui se base sur la relation substantielle entre les parties, c’est-à-dire sur la réalité de la prestation de travail, pour déterminer la qualité de travailleur. Cette approche, qui met l’accent sur la réalité, est un principe essentiel pour empêcher les employeurs en position de force d’abuser des formes contractuelles afin d’échapper indûment à la protection offerte par le droit du travail.
Le fondement de ce cadre de jugement est le “Rapport du Comité d’Étude sur la Loi des Normes du Travail” publié en 1985 (ci-après, “Rapport de l’année Showa 60 (1985)”) par l’ancien Ministère du Travail. Bien que ce rapport ne soit pas une loi en soi, il a eu une influence considérable sur la jurisprudence et l’interprétation administrative subséquentes, et continue de fonctionner jusqu’à aujourd’hui comme un guide de facto pour la détermination de la qualité de travailleur.
Le Rapport de l’année Showa 60 (1985) organise les critères de jugement en deux niveaux principaux. Le premier concerne les critères relatifs à la “subordination à l’employeur”, qui constituent le cœur du jugement. Cela concrétise le texte de l’article 9 de la Loi des Normes du Travail, qui définit les travailleurs comme “ceux qui sont employés et rémunérés”, et se compose de deux aspects : “le travail sous direction et supervision” et “la rémunération pour le travail effectué”. Le second niveau comprend des éléments supplémentaires utilisés pour renforcer le jugement lorsque les critères principaux ne suffisent pas à trancher. La pérennité de ce cadre interprétatif stable sur de nombreuses années suggère que le système juridique japonais privilégie le développement progressif de l’interprétation par l’accumulation de jurisprudence plutôt que par des réformes législatives fréquentes. Par conséquent, comprendre le contenu de ce rapport historique est extrêmement important pour anticiper les décisions des tribunaux dans les conflits du travail contemporains.
Critères centraux de jugement : Les éléments spécifiques de la “subordination”
La “subordination” est le concept le plus important pour déterminer le statut de travailleur. Elle interroge la présence ou l’absence d’une relation de dépendance caractérisée par la fourniture de travail sous la direction et la supervision d’autrui, en échange d’une rémunération. Les tribunaux prennent en compte de manière globale plusieurs éléments pour juger de l’existence de la subordination.
Le travail sous direction et supervision en droit japonais
Le travail sous direction et supervision ne se limite pas simplement à recevoir des instructions pour des tâches. Il faut examiner de manière multidimensionnelle la spécificité des instructions, le degré de contrainte qu’elles imposent et l’étendue de la discrétion dans l’exécution du travail.
Liberté d’accepter ou de refuser des missions et instructions
Même si la liberté de refuser formellement des missions est stipulée dans le contrat, si la situation rend en réalité le refus impossible, cela tend à confirmer l’existence d’une relation de direction et de supervision. Par exemple, si le refus d’une mission entraîne une réduction significative ou l’arrêt complet du travail par la suite, cette “liberté” est considérée comme purement nominale. Dans la jurisprudence, les cas où les employés sont contraints de suivre un planning de travail et où des pénalités sont imposées pour absence non autorisée, la liberté de choix est considérée comme inexistante et la qualité de travailleur est fortement reconnue (Cour d’appel de Tokyo, 17 octobre 2018 (2018)). D’autre part, dans un cas où un chauffeur pouvait librement choisir entre “venir au travail”, “être en contact (disponible)” ou “prendre un jour de congé”, et où le refus de travail n’entraînait aucune pénalité, la liberté de choix a été reconnue et a constitué un élément pour nier la qualité de travailleur (Tribunal de district d’Osaka, 11 décembre 2020 (2020)).
Direction et supervision dans l’exécution du travail
Le degré de directives et de gestion spécifiques reçues pour la méthode d’exécution du travail est également un élément de jugement important. Si des instructions détaillées sont données non seulement sur l’objectif et le délai du travail, mais aussi sur le processus et les moyens pour y parvenir, la relation de direction et de supervision est renforcée. Par exemple, dans le cas d’un enseignant dans une école de langues qui était obligé de suivre les textes et manuels désignés par l’école et de participer à des formations régulières, une forte direction et supervision ont été reconnues (Cour d’appel de Nagoya, 23 octobre 2020 (2020)). En revanche, pour un enseignant à temps partiel dans une université, où, à part le programme général des cours, la définition du contenu spécifique des cours était laissée à la large discrétion de l’enseignant, la relation de direction et de supervision a été jugée faible (Tribunal de district de Tokyo, 28 mars 2022 (2022)).
Contraintes temporelles et spatiales
Le fait que le lieu et l’heure de travail soient spécifiés et que l’employeur gère la présence est un signe typique d’une relation de direction et de supervision. L’obligation de pointer avec une carte de temps, une gestion stricte des horaires de travail et l’obligation de soumettre des rapports d’activité détaillés renforcent les contraintes temporelles et spatiales. Même dans le cas du télétravail, si les heures de connexion et de déconnexion sont gérées ou si une présence en ligne constante est requise, il peut être jugé qu’il existe des contraintes. Dans le cas d’un programmeur de jeux vidéo qui était obligé de travailler dans les locaux de l’entreprise pour utiliser les équipements et de pointer avec une carte de temps, une forte contrainte a été reconnue, ce qui a conduit à confirmer la qualité de travailleur (Tribunal de district de Tokyo, 26 septembre 1997, affaire Tao Human Systems).
Substituabilité de la prestation de travail
La possibilité de remplacer la prestation de travail par une tierce personne, à la discrétion du prestataire, est également un élément de jugement. Si la personne peut utiliser des assistants ou des remplaçants à ses propres frais et responsabilité, cela suggère un caractère d’entrepreneur et tend à affaiblir la qualité de travailleur. À l’inverse, si la prestation de travail par la personne elle-même est strictement requise, quelle que soit la raison, cela est considéré comme un travail à caractère personnel, c’est-à-dire ayant la nature d’un contrat de travail, et renforce la qualité de travailleur. Bien que cette substituabilité ne soit pas en soi un élément décisif, elle joue un rôle de soutien dans l’évaluation de l’existence d’une relation de direction et de supervision.
La contrepartie du travail en matière de rémunération sous le droit japonais
Il est question de savoir si la rémunération possède la nature d’une contrepartie (= salaire) pour le travail fourni lui-même. La nature de la rémunération se détermine non pas par son appellation, mais par la réalité de son calcul et de son mode de paiement.
Lorsque la rémunération se paie sous forme de salaire horaire, journalier ou mensuel, en fonction de la durée du travail, elle est fortement considérée comme ayant la nature d’un salaire. De même, si la rémunération diminue en fonction du nombre de jours ou d’heures d’absence (selon le principe dit du “no work, no pay”) ou si une indemnité supplémentaire est versée pour les heures supplémentaires, cela indique fortement la contrepartie du travail de la rémunération. Dans le cas d’un comptable, le paiement d’un montant fixe chaque mois, indépendamment du volume de travail, et l’octroi de bonus ont conduit à la reconnaissance que la rémunération était la contrepartie du travail fourni sous supervision (jugement du Tribunal de district de Tokyo du 30 mars 2011 (2011)).
En revanche, lorsque la rémunération est entièrement déterminée par les résultats du travail, comme dans le cas d’un système de commission pure basé sur les ventes ou d’un paiement forfaitaire à l’achèvement d’un projet, elle a fortement la nature d’une contrepartie pour une transaction entre entrepreneurs, ce qui affaiblit l’élément de la qualité de travailleur. Cependant, même si la rémunération est basée sur un système de commission en apparence, des éléments tels qu’un salaire minimum garanti peuvent être pris en compte dans une direction affirmant la qualité de travailleur.
Éléments renforçant la qualification de travailleur
Même après avoir examiné les éléments centraux relatifs à la “subordination”, il peut arriver que la présence ou l’absence de la qualité de travailleur ne soit pas claire. Dans de tels cas limites, les tribunaux prennent en compte les éléments complémentaires suivants pour rendre un jugement global.
Présence ou absence de la qualité d’entrepreneur
Le degré auquel le prestataire de services possède la qualité d’un entrepreneur indépendant est un élément complémentaire particulièrement important. Cela est évalué du point de vue de savoir si le prestataire de services gère son entreprise à ses propres risques et périls.
Comme matériaux de jugement concrets, on considère d’abord si le prestataire possède et supporte à ses frais des machines, des outils, des véhicules, etc., essentiels à l’exécution de son travail. Par exemple, la possession de camions coûteux ou de machinerie lourde suggère fortement la qualité d’entrepreneur. Ensuite, il est également pris en compte si la rémunération est significativement plus élevée que le salaire d’un employé permanent d’une entreprise effectuant un travail similaire. Cette rémunération élevée est interprétée comme incluant une compensation pour les dépenses et les risques commerciaux assumés par l’entrepreneur, ce qui affaiblit la qualité de travailleur. D’autres facteurs, tels que la prise en charge personnelle des dommages liés au travail ou l’utilisation d’une enseigne commerciale propre pour les activités commerciales, sont également pris en compte dans l’évaluation de la qualité d’entrepreneur.
Degré d’exclusivité
Un haut degré de dépendance économique envers une entreprise particulière peut être un élément renforçant la qualité de travailleur. Le degré d’exclusivité est évalué sous deux aspects. L’un est de savoir si le contrat interdit de travailler pour d’autres entreprises ou si, en pratique, cela est difficile en termes de temps ou physiquement. Si une personne est fortement engagée par les tâches d’une entreprise particulière au point de ne pas pouvoir effectuer d’autres travaux, l’exclusivité est jugée élevée. L’autre aspect est la dimension de sécurité de revenu de la rémunération. Si la majeure partie du revenu dépend de la rémunération d’une entreprise particulière, une forte dépendance économique est reconnue, ce qui renforce la qualité de travailleur.
Autres éléments
En plus des éléments mentionnés ci-dessus, les circonstances objectives montrant comment les parties percevaient le prestataire de services sont également prises en compte. Plus précisément, il s’agit de savoir si la rémunération a fait l’objet d’une retenue à la source en tant que revenu salarial, si le prestataire a été inscrit à l’assurance travail (assurance accidents du travail et assurance emploi) et à l’assurance sociale (assurance santé et assurance pension de bien-être), ou si le règlement intérieur de l’entreprise lui a été appliqué. Ces faits peuvent indiquer que l’entreprise traitait cette personne en tant que travailleur, ce qui renforce le jugement affirmant la qualité de travailleur.
Directives de la Cour suprême du Japon : l’affaire du directeur de l’inspection du travail de Yokohama Minami
En tant que cas de référence pour les critères de détermination du statut de travailleur, le jugement rendu par la Cour suprême du Japon le 28 novembre 1996 (1996) dans l’affaire du directeur de l’inspection du travail de Yokohama Minami fournit des directives extrêmement importantes.
Cette affaire concernait un chauffeur qui, possédant son propre camion, était principalement engagé dans le transport de produits pour une entreprise de papeterie et qui, après avoir été blessé au travail, a demandé des prestations d’assurance pour accidents du travail. Le directeur de l’inspection du travail a refusé ces prestations au motif que le chauffeur n’était pas considéré comme un « travailleur », ce qui a conduit le chauffeur à intenter une action en justice pour faire annuler cette décision.
La Cour suprême du Japon a finalement nié le statut de travailleur de ce chauffeur. Le processus de jugement a appliqué de manière concrète le cadre décisionnel que nous avons décrit jusqu’à présent et est riche en enseignements.
Pour commencer, la Cour suprême a examiné les instructions données par l’entreprise et a jugé que les directives concernant les marchandises transportées, les destinations et les horaires de livraison étaient, de par la nature du travail de transport, des instructions naturellement nécessaires en tant que client et que cela ne pouvait pas être évalué comme un contrôle et une supervision concrets de l’exécution du travail.
Ensuite, en ce qui concerne la contrainte temporelle et spatiale, la Cour a souligné que le chauffeur, une fois une mission de transport terminée, n’était plus sous le contrôle de l’entreprise et pouvait utiliser son temps librement jusqu’à la prochaine mission, et que le degré de contrainte était bien plus souple que pour les employés ordinaires de l’entreprise, ce qui n’était pas suffisant pour être évalué comme étant sous supervision.
Et ce que la Cour suprême a particulièrement pris en compte, c’est l’élément de « nature entrepreneuriale ». Le chauffeur possédait un camion coûteux, assumait tous les frais tels que l’essence, les réparations et les assurances, et était rémunéré en fonction du volume de transport, sans retenue à la source comme pour un salaire. À partir de ces faits, la Cour a déterminé que le chauffeur agissait en tant qu’entrepreneur indépendant, exerçant ses activités de transport à ses propres risques et calculs, et a donc nié son statut de travailleur.
Ce jugement a clarifié que la détermination du statut de travailleur ne doit pas se baser sur des éléments spécifiques isolés, mais plutôt sur une évaluation globale de plusieurs facteurs tels que la relation de supervision, la contrainte, la nature de la rémunération et la nature entrepreneuriale. En particulier, il a été démontré que lorsque le prestataire de travail présente une nature entrepreneuriale significative, cela peut constituer un élément puissant pour nier le statut de travailleur, ce qui en fait un précédent judiciaire révolutionnaire.
Application aux formes de travail modernes : la nature de travailleur des gig workers
L’émergence des “gig workers”, qui acceptent des missions ponctuelles via des plateformes, pose de nouvelles questions au cadre traditionnel d’évaluation de la nature de travailleur. En particulier, les méthodes de travail des livreurs de services de livraison de nourriture, comme ceux d’Uber Eats, sont devenues un sujet de débat mondial.
Au Japon, l’union des livreurs d’Uber Eats, qui a demandé des négociations collectives avec la société opérante, a rencontré un problème lorsque la société a refusé de négocier en niant la nature de travailleur des livreurs. Dans cette affaire, la Commission du travail de Tokyo a décidé en 2022 (Reiwa 4) que les livreurs étaient des “travailleurs” au sens de la loi japonaise sur les syndicats, et a ordonné à la société de se conformer aux négociations collectives. Cette décision s’appuie sur le fait que les livreurs sont une force de travail essentielle à l’exécution des activités de la plateforme, que leur rémunération est en réalité déterminée unilatéralement par la société, et qu’ils sont effectivement dirigés et supervisés via l’application.
Cependant, il reste à déterminer si les gig workers peuvent bénéficier de la protection de la loi japonaise sur les normes du travail, telle que le paiement des heures supplémentaires ou le salaire minimum, car les décisions judiciaires ne sont pas encore établies et l’accumulation de jurisprudence est attendue. Dans un procès civil où un livreur a demandé des dommages-intérêts pour une suspension de compte injustifiée (équivalant à un licenciement de facto), le tribunal a évité un jugement direct sur la nature de travailleur, aboutissant à un règlement où la société a payé une somme pour résoudre l’affaire.
Ces évolutions montrent que les défis juridiques continuent quant à l’application des critères traditionnels de jugement, tels que la distribution et l’évaluation des tâches par algorithme constituant une “direction et supervision”, ou si les vélos et motos possédés par les livreurs peuvent être considérés comme des équipements coûteux indiquant une “nature d’entrepreneur”. Les entreprises doivent reconnaître que les contrats avec les gig workers peuvent impliquer à la fois le risque de négociations collectives selon la loi sur les syndicats et le risque d’être reconnus comme des travailleurs selon la loi sur les normes du travail à l’avenir.
Tableau comparatif des critères de qualification de travailleur sous le droit japonais
Lorsque nous résumons les critères de qualification de travailleur que nous avons expliqués jusqu’à présent, nous obtenons le tableau suivant. Ce tableau est une simplification destinée à indiquer une tendance dans la prise de décision et il est important de noter que l’évaluation réelle doit prendre en compte de manière globale les faits spécifiques de chaque cas.
| Critère de jugement | Circonstances favorisant la qualification de travailleur | Circonstances niant la qualification de travailleur |
| Liberté d’acceptation ou de refus | Il est de fait impossible de refuser les tâches assignées. Refuser entraîne des désavantages. | Liberté de choisir les tâches et de les refuser sans pénalité. |
| Direction et supervision de l’exécution du travail | Recevoir des instructions et une gestion détaillées sur le contenu et la méthode de travail (manuel, rapports périodiques, etc.). | Disposer d’une large marge de manœuvre dans la méthode d’exécution du travail (seuls les résultats sont spécifiés). |
| Contraintes temporelles et spatiales | Les heures et le lieu de travail sont spécifiés et la présence est contrôlée (carte de temps, système de rotation, etc.). | Aucune contrainte d’heures ou de lieu de travail, libre de décider selon son propre jugement. |
| Substituabilité | L’obligation de fournir le travail personnellement, sans possibilité de remplacement par un tiers. | Liberté de recourir à des assistants ou des remplaçants à sa propre discrétion et à ses frais. |
| Nature de la rémunération | Rémunération basée sur le temps de travail ou un salaire fixe, payée pour le temps de travail ou la prestation de travail elle-même. Déduction pour absence. | Rémunération basée sur les résultats du travail (commission pure, rémunération par projet). |
| Caractère entrepreneurial | L’entreprise fournit les machines, outils, matériaux et prend en charge les principaux frais. | Possession personnelle de machines et outils coûteux et prise en charge des frais (risque et calcul personnels). |
| Exclusivité | Le travail pour d’autres entreprises est interdit ou restreint par contrat ou de fait. Dépendance envers le revenu d’une seule entreprise. | Liberté de travailler pour d’autres entreprises et pratique effective du cumul d’emplois. |
Résumé
En droit du travail japonais, la qualification d’une personne en tant que « travailleur » ne repose pas sur la dénomination formelle du contrat, mais sur une évaluation globale de multiples facteurs basée sur la réalité de la prestation de travail. Au cœur de cette évaluation se trouve le concept de « subordination », qui examine la présence de supervision, les contraintes temporelles et spatiales, ainsi que la nature compensatoire de la rémunération pour le travail fourni. D’autres éléments complémentaires, tels que l’indépendance entrepreneuriale et l’exclusivité, sont également pris en compte pour aboutir à une conclusion sur chaque cas spécifique. Ce cadre d’évaluation, établi par la jurisprudence de la Cour suprême, fait face à de nouveaux défis interprétatifs avec l’émergence de formes de travail telles que le gig work, tout en maintenant sa structure fondamentale. Pour les dirigeants d’entreprise et les responsables juridiques, comprendre précisément ce concept juridique complexe et fluide et réviser régulièrement leur système de gestion du travail est essentiel pour éviter des risques juridiques et financiers imprévus et assurer une gestion durable de l’entreprise.
Le cabinet d’avocats Monolith fournit à de nombreux clients au Japon des conseils basés sur une riche expérience concernant les questions juridiques liées à la détermination du statut de travailleur, telles que traitées dans cet article. Notre cabinet compte plusieurs membres qui possèdent des qualifications d’avocat étranger et qui parlent anglais, nous permettant d’offrir un soutien juridique sans faille sur le complexe système juridique du travail japonais, avec une perspective internationale. Nous proposons des services spécialisés adaptés aux besoins de votre entreprise, y compris l’évaluation de la classification de la main-d’œuvre, la création et la révision de contrats, ainsi que la représentation dans les litiges connexes.
Category: General Corporate